Approche communautaire en Haïti : décryptage de la notion de « communautés » et recommandations
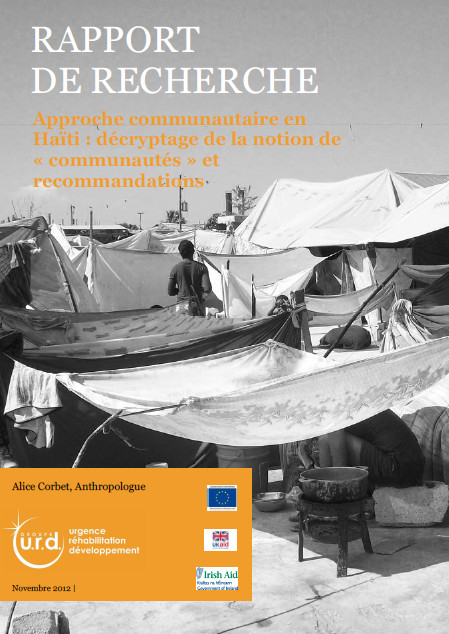 |
rapport Nov 2012 ; 56 pages
Aut. Alice Corbet
Ed. Groupe URD - Plaisians Groupe URD - Port-au-Prince
Téléchargeable sous format: PdF
Téléchargeable chez l'éditeur
Page de présentation d'un éditeur
Résumé:
Cette étude cherche à définir ce qu’est l’approche communautaire en milieu urbain.
Pour cela, la recherche s’attache à éclaircir la notion de communauté en Haïti, et à éclairer les questions opérationnelles liées à l’approche communautaire. L’étude se consacre donc d’une part à un exposé des différentes relations de solidarité et liens « communautaires » en Haïti, accompagnés de recommandations qui permettent de mieux appréhender le terrain.
Il existe en Haïti trois grandes bases communautaires : la famille, le voisinage, et la religion.
En milieu urbain, ces trois bases sont éclatées. Les relations familiales se restreignent dans l’espace et se désintègrent au gré des migrations internes ; les liens de voisinage se réduisent aux voisins limitrophes de l’habitation avec qui des relations de confiance se créent dans le temps ; et si les Églises sont toujours très fréquentées, elles s’inscrivent moins dans un esprit communautaire réel que spirituel.
Les communautés citadines répondent donc à d’autres critères qu’en milieu rural. Il y a notamment, en permanence, un enchevêtrement de communautés qui se superposent : la communauté de proximité (de voisinage), la communauté de loisirs (qui prend souvent forme d’association), la communauté religieuse, la communauté politique… Sommaire:
INTRODUCTION . 8
LES COMMUNAUTES EN HAITI . 15
1. Les trois niveaux de solidarité de base : la parenté, le voisinage, le religieux . 15
1.1. La solidarité familiale ou le fondement de la communauté sociale . 15
1.2. Les essentiels liens de voisinage . 16
1.3. La religion comme ciment social transversal en Haïti . 16
2. Prendre en compte une société éclatée : individualité ou individualisme ? . 19
2.1. L’individualisme fondamental de la société haïtienne . 19
2.2. Une masse silencieuse : Si timoun nan pa kriye, li pa bezwen tete . 21
3. Une structuration sociale verticale et l’émergence de chefs légitimes ou non . 23
3.1. La verticalité d’une société hiérarchisée . 23
3.2. L’accès au pouvoir religieux comme moyen d’émergence des chefs de communauté 24
3.3. De l’émergence des gangs et des mafias : un système ambivalent . 25
3.4. L’accès à la direction d’une association ou d’un comité . 26
4. S’adapter à des mobilisations communautaires fluctuantes . 31
5. « Communautaire » et « communauté » : qu’en est-il vraiment ? . 33
5.1. En milieu rural, des communautés de fait . 33
5.2. La création des « communautés administratives » : des choix politiques dépassés . 34
CONCLUSION . 39
ANNEXES . 42
Annexe n°1 : Un exemple concret : Canaan, deux parcours de communautés . 42
Annexe n°2 : Sol, sabotay, konbit et escouade : l’échange économique comme base de
solidarité . 47
Annexe n°3 : Personnes rencontrées lors de l’enquête de terrain . 48
Annexe n°4 : Confiance dans les rapports sociaux et dans les institutions . 50
Annexe n°5 : Bibliographie . 51
Publics-Cibles:
Collectivité , Association , Université , Animateur/Educateur , Acteurs de coopération , Socio-économiste , Décideurs locaux ou nationaux
Mot clef: |
Pays concerné: |
Editeurs/Diffuseurs: |
|
Groupe URD
-
Groupe Urgence Réhabilitation Développement - Plaisians |
Groupe URD
-
Groupe Urgence Réhabilitation Développement - Port-au-Prince - Haïti |
En cas de lien brisé, nous le mentionner à communication@pseau.org