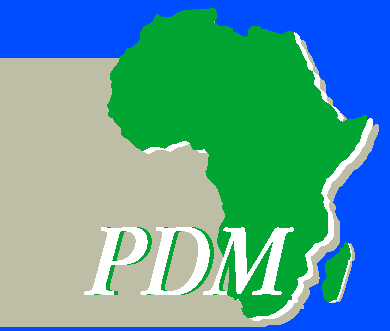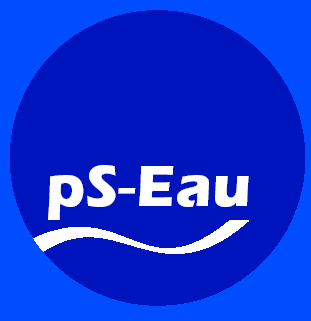Synthèse des acquis du programme
Inscrire
les questions de l’assainissement et des déchets dans une problématique
urbaine
Note
de cadrage par Emile Le Bris (IRD)
Sommaire
1.
Mondialisation et problématiques urbaines : l’Afrique hors jeu ?
1.1. Grandes
tendances de l’urbanisation contemporaine
1.2.
Le cas des villes africaines
2.
Des modèles aux politiques
2.1.
Généalogie des modèles
2.2.
Épuisement des théories
2.3.
Scénarios plus ou moins imaginaires
3.
Jeux d’acteurs en ville autour de l’assainissement et des déchets
3.1.
Des acteurs multiples
3.2.
Place et statut de ces acteurs
3.3.
Quels enjeux par rapport à l’assainissement et aux déchets ?
4.
Quelles logiques ? Quelles stratégies ?
Études citées dans cette synthèse
On
ne peut manquer d’être frappé par le décalage existant entre la définition
de priorités politiques, étatiques ou municipales, et les urgences et
recommandations des bailleurs de fonds en matière environnementale et
sanitaire. Nonobstant la pertinence de certaines de leurs recommandations, ces
acteurs externes ne parviennent que rarement à traiter les enjeux concernant
l’assainissement et les déchets autrement que de manière sectorielle. Or,
toute initiative en matière d’eau potable et d’assainissement a une forte
dimension territoriale, ainsi que des effets d’entraînement sur d’autres
infrastructures urbaines. Il est donc nécessaire de promouvoir des approches
portant non seulement sur le « sens des villes » dans la globalité de leurs
territoires mais aussi sur le rapport ville-territoire (intercommunalité,
agences de bassins, etc.). Pour comprendre la ville, il faut comprendre le système
de valeurs qui entoure cet espace, procéder à une analyse diachronique des
relations entre représentations et configurations de l’espace physique.
Dans
les domaines abordés par le programme, l’examen des logiques d’acteurs doit
donc s’inscrire dans des interrogations plus larges portant en particulier sur
trois questions :
–
à quel « ordre urbain » doivent se référer ces nouvelles politiques
publiques (partie 1) ?
–
comment redéfinir des politiques publiques et situer le rôle des collectivités
locales dans cette nouvelle définition (partie 2) ?
–
comment renforcer réellement le pouvoir des acteurs souffrant d’inégalités
d’accès aux services d’assainissement (partie 3) ?
1.
Mondialisation et problématiques urbaines : l’Afrique hors jeu ?
1.1.
Grandes tendances de l’urbanisation contemporaine
Partout
l’urbain prolifère. Dans le même temps, la planète s’unifie.
S’achemine-t-on pour autant vers une uniformisation des mondes urbains par
dissolution de l’autonomie et de la qualité des lieux ou assiste-t-on, au
contraire, à l’épanouissement d’une « diversité citadine » plus grande
encore que celle observée il y a quelques décennies ? En Afrique, on se trouve
confronté à la réalité d’une récente décrue de la croissance de
certaines très grandes villes au profit d’agglomérations de plus petite
taille. On est loin en effet de retrouver, au cours des années 90, les temps de
doublement de huit à dix ans de la population observés dans cer- taines villes
africaines au cours des décennies 70 et 80. Ce à quoi nous assistons, à l’échelle
mondiale, relève pourtant bien d’un impressionnant processus de concentration
dans les très grandes agglomérations. Dans certaines mégapoles latino-américaines,
un mode d’urbanisation « mature » caractéristique des grandes villes du
Nord en voie de vieillissement se substitue progressivement au mode
d’urbanisation « en expansion » qui demeure l’apanage de l’Afrique et de
l’Asie. Les composantes de la croissance urbaine tendent elles-mêmes à
s’inverser, le croît naturel interne l’emportant désormais sur l’apport
migratoire. Une telle inversion influe durablement sur les dynamiques urbaines
mais, dans le même temps, la plupart des villes du Sud restent animées par des
phénomènes de mobilité intenses et complexes. Il ne faut pas non plus
sous-estimer les effets urbains de la déstabilisation de vastes régions du
globe : villes en guerre et corridors transnationaux où circulent en grand
nombre migrants et réfugiés font désormais partie du panorama urbain de la
planète.
Les
mutations morphologiques subies par les villes au cours des deux dernières décennies
ont complètement brouillé les figures spatiales antérieures : la centralité,
la densité et la juxtaposition des fonctions. Ces changements intervenus dans
les figures spatiales de l’urbanisation ne sont pas propres aux villes du Sud.
Influencent- ils le changement social ou en sont-ils la résultante ? Considérée
naguère comme la forme miraculeuse du capitalisme, la grande ville demeure
aujourd’hui la matrice du changement social et la première condition d’un
marché capitaliste étendu à l’ensemble de la planète. La reconnaissance de
la pluralité des mondes urbains est, de ce point de vue, moins que jamais dans
l’air du temps. Mais, dans le même temps, se joue une véritable mutation du
phénomène urbain et une transformation radicale du sens des villes. Il est peu
probable que l’on assiste, comme on l’a longtemps supposé, à une simple
transposition au Sud de la révolution urbaine ayant affecté les pays du Nord
au siècle dernier. Ce qui peut encore être considéré comme la norme au Nord
demeure l’exception au Sud où prévaut au contraire une banalisation de
l’irrégularité urbaine. On relèvera en particulier deux tendances lourdes
qui hypothèquent toute continuité dans les processus : la remise en cause des
Etats-nations et l’impossible généralisation du salariat à l’ensemble de
la planète. La crise de sens qui affecte les villes apparaît intimement liée
à la crise sociale affectant un monde en proie à une insécurité croissante.
Des masses informes de « résidus urbains » envahissent les campagnes mais,
loin d’annoncer le dépassement de la réalité urbaine existante, cette «
submersion » ne ferait qu’exprimer ce que Guy Debord[1]
appelait la « liquidation de la ville », une liquidation à laquelle nulle
autorité ne serait plus en mesure de faire face.
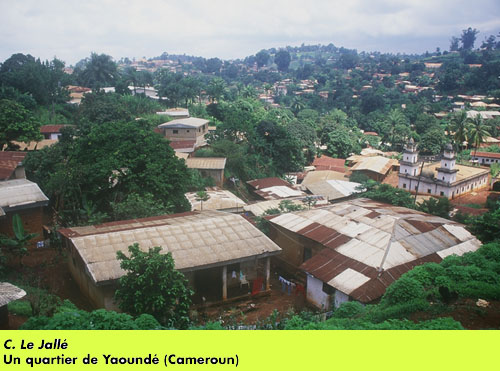
Dans
les nouveaux centres de décision internationaux, on se préoccupe beaucoup, en
cette fin de siècle, de « faire des
villes le moteur du développement économique ».
Se soucie-t-on suffisamment de leur rendre leurs vertus créatives dans
l’ordre culturel et d’y entretenir ou d’y susciter les valeurs attachées
à la citoyenneté ? S’efforce-t-on de faire émerger des administrateurs légitimes,
c’est-à-dire en phase avec des modèles de conduite et des comportements
fondant une civilité urbaine en permanente évolution ? Ce qui frappe, c’est
non seulement l’impossibilité d’« éradiquer » la pauvreté mais, plus
encore, la brutalité des phénomènes de paupérisation, que ceux-ci soient le
résultat d’une longue accoutumance à la récession ou qu’ils soient
occasionnés par des crises financières aiguës du type de celle qui, partie
d’Asie, a gagné la Russie et l’Amérique Latine à la fin des années 90.
Cette montée spectaculaire de la pauvreté s’accompagne d’un creusement non
moins impressionnant des inégalités. Le fossé qui sépare riches et pauvres
hypothèque toute chance de communication entre eux et, à défaut de solutions
adéquates favorisant la mixité spatiale et sociale, cette redoutable
propension à la sécession est lourde de risques d’ébranlements. En lieu et
place de la recherche d’armistices sociaux, la violence s’installe, se
substituant au débat public. Cette dérive affecte, bien qu’avec une intensité
et dans des configurations variables, toutes les grandes villes du monde.
1.2.
Le cas des villes africaines
Les
villes d’Afrique sub-saharienne fournissent, depuis la fin des années 80,
l’illustration d’une « dérive urbaine » préoccupante. Les scénarios antérieurs
entrecroisaient des « trajectoires d’urbanisation » étalées sur plusieurs
générations. Les stratégies d’insertion par le logement et l’accès à
l’emploi prenaient appui sur les solidarités familiales et communautaires.
Sans idéaliser ces solidarités, on peut considérer qu’elles
s’inscrivaient dans une sociabilité ouverte. Les sorties de trajectoires se
multipliant, les citadins se trouvent renvoyés à un « individualisme de la nécessité
», symptôme d’un profond dérèglement social[2].
Des recompositions sociales et identitaires profondes sont aujourd’hui à l’œuvre
et l’on peut faire l’hypothèse qu’elles ne sont pas, pour la plupart, spécifiques
à l’Afrique :
–
les néo-citadins semblent paradoxalement plus à même d’affronter les dérèglements
de tous ordres que les citadins plus anciennement installés ;
–
les femmes chefs de ménages sont de plus en plus nombreuses et semblent plus à
même de résister que les hommes ;
–
les étrangers et les minorités de toutes sortes sont désignés comme victimes
expiatoires face aux difficultés à vivre la mégapole ;
–
la violence politique au sommet, caractéristique des premières décennies des
indépendances, épargnait relativement la grande masse de la population. Il est
un peu déprimant de constater que l’accès (même relatif) à certains droits
politiques est concomitant avec une perversion des liens de voisinage et le développement
d’une violence de proximité. Les mouvements religieux de toutes natures
s’offrent pour recréer à la fois de la sécurité et de la sociabilité.
L’affirmation
du droit à la ville procède d’une activation de ce que Marc Le Pape[3] appelle « l’énergie
sociale », plus sans doute que de l’action publique. Mais on peut se demander
ce que pèse cette énergie, au demeurant remarquable d’efficacité, face à
des macro-processus affectant la relation entre le local et le mondial.
Prolétarisation
sans prolétariat
Le
salariat stable (principalement dans la fonction publique) sert de modèle de référence
depuis les années 60, mais a toujours été une forme très minoritaire de mise
au travail. Il fut en outre constamment récupéré par le non salariat en ce
sens qu’il a fonctionné selon le principe des embauches réservées sur une
base ethnique ou familiale. Le salarié vit en constante interconnexion avec la
couche nombreuse des salariés occasionnels et des non-salariés. Cette
interconnexion est gravement compromise du fait de « l’ajustement »
(licenciements massifs, chômage des jeunes diplômés) et d’une «
concurrence proliférante » au sein du « secteur informel » qui, adoptant
trop brutalement les logiques productivistes, épuise assez rapidement sa propre
dynamique.
Recompositions
démographiques, sociales, spatiales et culturelles
Les
villes africaines restent les seules dans le monde où la composante naturelle
de la croissance n’est pas majoritaire mais elles portent en elles, du fait
que deux citadins sur trois ont moins de 24 ans et que la fécondité reste élevée
en milieu urbain, un formidable potentiel d’expansion démographique. Outre
l’exode rural classique, on observe l’accroissement du nombre de migrants
flottants qui ne parviennent plus à se stabiliser, ni au village, ni en ville.
Anciens clivages (ethnies, maîtres/esclaves, envahisseurs/envahis) et pratiques
spécifiquement urbaines génératrices de normes et de formes ont contribué à
ancrer les diasporas en tendant les « filets sociaux », en jouant comme «
amortisseurs ». Aujourd’hui se dessinent de nouveaux rapports entre individus
et groupes, entre société et espace, la question étant de savoir comment les
acteurs des systèmes de pouvoir contemporains construisent leurs champs de compétence,
à quelles échelles les décisions se prennent, dans quels espaces se croisent
les enjeux.
La
précarisation des conditions de vie des « classes moyennes » et la
multiplication des déclassements sociaux sonnent le glas du « monde enchanté
des solidarités ». Les anciens systèmes de protection se durcissent à l’égard
des plus vulnérables (jeunes renvoyés à la rue, femmes seules, etc.). La
politisation des systèmes d’attribution du sol urbain et du logement a
favorisé le développement d’un « envers » du modèle de ville « moderne
». Comme on le voit à Abidjan, cet « envers » ne peut pas être assimilé en
Afrique aux bidonvilles misérables des cités latino-américaines. Envers et
endroit sont ici organiquement liés à travers des jeux d’alliance complexes.
L’étalement indéfini de villes « bouffeuses » d’espace ne risque-t-il
pas – la fracture spatiale générant des fractures sociales – de remettre
en cause ces solidarités organiques ? Rien ne semble susceptible d’inverser
la tendance à l’éclatement de la ville en une somme de territoires étanches
fortement autocentrés sur l’expression de cultures propres. D’aucuns
proposent de revivifier une tradition pré-urbanistique proprement africaine. Le
développement actuel de certaines villes africaines semble même s’imposer
dans la rupture, jusqu’à la table rase. L’interrogation sur la pertinence
d’une approche patrimoniale de l’intervention urbaine est d’autant plus
forte que les trajectoires historiques des villes africaines sont rarement
inscrites dans la longue durée.
En
règle générale, les configurations urbaines expriment une volonté d’ordre
de la société. En Afrique, la ville coloniale exprime la recomposition de
trois grandes utopies portées par différents types d’acteurs : humaniste,
chrétienne et libertaire. Les modèles urbains de référence sont basés sur
l’hétérogénéité et sur la hiérarchisation socio-spatiale. Ils
s’inspirent d’idéologies associant densité et insalubrité, densité et
criminalité. Historiquement, la notion d’ordre colportée par les élites a
toujours renvoyé à l’impérialisme de la rationalité et s’est inspirée
de trois caractéristiques : monocentrisme, catégorisation spatiale en
correspondance avec la hiérarchie sociale et orthogonalité.
•
Le modèle colonial pionnier
se développe en même temps que le modèle hausmannien et les rapports entre
les deux seront étroits. Ce premier modèle colonial est-il si novateur qu’on
l’a dit ? Largement libéré, il est vrai, des contraintes politiques,
juridiques et sociales qui l’entravent dans la métropole, ce modèle affiche
le primat de l’économique (on dit dans les colonies la « mise en valeur »)
qui s’exprime en particulier dans le fait que gares et ports sont traités
comme des germes de villes. La colonisation impose une rupture radicale, un
changement de centre de gravité faisant de la polarité maritime le principe
quasi exclusif de la fondation des villes marchandes où se produit une
accumulation « en transit » : du comptoir (inséparable de l’économie de
traite) à la ville. Au nom de la mission « civilisatrice » on impose la
propriété civiliste à tout un chacun ... mais d’abord au bénéfice des
colons. Poste administratif et poste militaire fonctionnent comme outils de
quadrillage territorial et de domination politique, seuls susceptibles de
contenir une urbanisation devenue excessive à partir de 1945.
•
Le modèle colonial moderne
entre alors en action, imposant le lotissement et ses trames orthogonales, la
construction en maçonnerie, le principe de séparation des habitats (boulevards
d’isolement, villages de ségrégation) tempéré par la promotion d’un
secteur d’habitat social en faveur d’une strate « d’indigènes » servant
directement le projet colonial. L’hygiénisme ne vient pas ici pallier les excès
d’une urbanisation incontrôlée répondant à l’industrialisation. Il
n’est pas hygiénisme correcteur mais hygiénisme justifiant la séparation.
•
La politique de modernisation à base
nationale des premières années des indépendances
se développe, dans son volet urbain, en référence à la doctrine urbanistique
coloniale, laquelle s’inspire directement de l’urbanisme moderne
international promu par les CIAM[4] dès les années 30. On
est cependant confronté en Afrique à la nécessité de contenir la prolifération
de l’habitat irrégulier en créant des structures prenant la forme de trames
d’accueil qui refondent certes totalement les plans d’urbanisme coloniaux
mais en conservant les principes qui ont présidé à leur construction.
Supports des nouveaux Etats, les grandes villes constituent l’espace premier
de la négociation de leurs bases sociales : sont créés des quartiers réservés
aux fonctionnaires auxquels on propose un habitat correspondant à un mode de
vie et de consommation individualisé et à une structure familiale resserrée.
Cette nouvelle « élite » impose dans le décor urbain un urbanisme du symbole
(la « voie triomphale ») et du monument (la statue du « guide éclairé »).
•
Une insertion rentière dans l’économie
mondiale. Depuis le milieu des années 80,
l’Afrique a connu d’importants bouleversements tant dans le domaine économique,
politique que culturel. Plusieurs évolutions se dessinent. Elles indiquent que
le continent avance vers plusieurs directions simultanément. Sur le plan économique,
les tentatives de modernisation autoritaire n’ont guère permis une véritable
diversification des structures de production. Celles-ci sont restées, pour
l’essentiel, tributaires d’une insertion rentière dans l’économie
mondiale. La crise de la dette n’a fait qu’aggraver cette tendance que les
politiques d’ajustement structurel sont venues renforcer. Sur le plan
politique, les modèles autoritaires de construction de l’Etat et de la nation
ont reposé sur des pratiques clientélistes. Ces pratiques ont fini par vider
le projet post-colonial de modernisation de son sens. Dans ce contexte, le
monopole du politique par l’Etat a été contesté par des groupes de plus en
plus nombreux cherchant à recomposer, souvent en marge de l’Etat, l’espace
public et les formes d’appartenance à la communauté. Dans un petit nombre de
cas, ces mutations ont débouché sur une relative libéralisation du champ
politique. Dans la plupart des cas, elles ont mené à l’affaissement de l’Etat
suite à des conflits sanglants. Sur le plan culturel, la montée en puissance
du religieux et les diverses formes de mobilisation ethnique se sont traduites
par une amplification des revendications identitaires. Mis ensemble, ces
processus remettent fondamentalement en question le projet politique porté par
les élites autochtones. Dans ce contexte de crise profonde du modèle
post-colonial, une autre Afrique est en gestation. C’est ainsi que des frontières
plus ou moins visibles organisent la coexistence de mondes séparés (à
l’instar de ce qu’a codifié le modèle
de Johannesbourg). L’identité
culturelle participe à une ségrégation perçue comme solution à la
discrimination. C’est dans ce contexte de coexistence que s’échafaudent des
stratégies spatiales, parfois collectives, mais le plus souvent individuelles
et familiales, en relation avec l’activité des ménages.
Il
semble pour le moins hasardeux de chercher à lire le futur des villes dans les
dessins et les desseins des villes actuelles. Nous nous trouvons bien confrontés
à une séparation de la ville par rapport aux conceptions ancestrales de la Cité
et de la Nation et à la rupture d’une relation millénaire entre la ville et
la campagne. Le développement au Sud d’une péri-urbanisation assimilable à
des camps de réfugiés chassés des campagnes ou, au Nord, de villes périphériques
(edge cities)
bourgeonnant aux abords de centres commerciaux et d’immenses parkings souligne
les limites du modèle productiviste. Les idées de « fin de l’âge urbain »
et de « contre-urbanisation » constituent une échappatoire commode fondée
sur la conviction – contestable – que certains macro-processus actuellement
à l’œuvre (métropolisation, globalisation) sont irréversibles. Ces prédictions
catastrophistes conduisent à se contenter d’aménager la montée de
l’exclusion dans ses formes les plus caricaturales. Elles justifient
l’absence d’imagination au service de l’invention d’une nouvelle
civilisation urbaine dans laquelle les questions centrales seront en tout état
de cause celles de la démocratie et de la construction d’un nouvel espace
public. Ignorant la pluralité des mondes urbains et l’exigence d’interculturalité,
les scénarios associés à la mondialisation, composés de liberté et de
solitude absolues, n’apportent guère de solutions satisfaisantes à ces
questions.
Le
concept de « développement durable » (ou « soutenable ») est de consécration
récente et il a trouvé sa conjugaison urbaine (la « ville durable »). « Le
développement durable, c’est un développement qui répond aux besoins du présent,
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
propres besoins » (Rapport Brundtland,
1987). S’agissant des villes, les enjeux du développement durable sont
multiples et ambivalents. Naguère producteurs d’une pensée structurée, les
théoriciens de l’urbain sont en plein désarroi :
–
la thèse du « biais urbain », élaborée au cours des années 70, se trouve
remise au goût du jour par ceux qui situent à la campagne les principaux
gisements d’emplois des décennies à venir ;
–
les ultra-libéraux se réapproprient le « développement durable » en défendant
la thèse selon laquelle les villes bien arrimées au marché mondial et
correctement gérées constituent le point de passage obligé vers un nouvel âge
d’or ;
–
les tenants de la « participation populaire » utilisent le développement
durable pour conforter leurs approches en termes de développement urbain
autocentré.
2.3.
Scénarios plus ou moins imaginaires
La
Global City
Les
très grandes villes se transforment-elles en plates-formes d’une économie
mondiale fonctionnant en réseau ou restent-elles – à l’instar des métropoles
de la révolution urbaine du siècle dernier – des lieux de commandement au
profit des économies et des territoires nationaux ? Pour Saskia Sassen[5],
la réponse est claire et peut être assimilée à une bonne définition de ce
que l’on appelle la « métropolisation ». Une nouvelle configuration sociale
et physique de la ville naît de la restructuration socio-économique de la
production sous l’égide des professions financières. L’hypothèse de la
concentration urbaine inéluctable des lieux du pouvoir économique – au
demeurant contredite par le fait que plus de la moitié des 500 premières
multinationales ne sont pas dans les 17 plus grandes métropoles – conduit
l’auteur à la description d’un système-monde oligopolaire, si ce n’est
monopolaire. Dans le club très fermé des « villes globales », le choix se
porte désormais sur l’hypercentre et ses consommations sophistiquées de préférence
à la banlieue résidentielle. La vie s’organise autour de « non-lieux »
tels qu’aéroports, supermarchés et bretelles d’autoroutes urbaines. Cette
vision ne prend pas en compte les effets de l’éclatement de la bulle financière
en Asie et en Amérique Latine et ignore la nouvelle visibilité des « sans
domiciles fixes » et des immigrants sans papiers dans les grandes agglomérations
des pays industrialisés.

City
of Quartz ou
la fin de l’âge urbain
Mégapoles
ou métropoles, toutes ces très grandes villes ont-elles un avenir urbain ?
Mike Davis[6]
décrit une Los Angeles peuplée de « nimbies
» (ceux dont le credo environnemental se
résume à la formule « nobody in my
backyard » !), véritables « dissidents
de l’intérêt public » prompts à naturaliser ou plus encore à criminaliser
la pauvreté. A Alphaville dans le grand Sao Paulo, dans les condominiums de
Bangkok, à Waterford Crest non loin de Los Angeles, la société de contrôle
se met en place progressivement avec ses architectures sécuritaires et ses
milices privées. La privatisation de tous les espaces publics va jusqu’à éradiquer
complètement les habitants des rues. Certains projets de villes privées au Cap
(Afrique du Sud) ou en Floride (Etats-Unis) vont encore plus loin dans la préfiguration
du bunker inexpugnable, protégé de la planète des sansabri et de l’habitat
précaire où campent les « nouveaux barbares ». Malheur aussi à ces agglomérations
européennes ou nord-américaines vivant dans la nostalgie du temps pas si
ancien où urbanisation rimait avec industrialisation, condamnées à n’être
plus que des « dépotoirs de rêves » : elles incarnent de manière
caricaturale le délire urbain de la post-modernité, la perspective déprimante
de la ville à jeter après emploi.
Mégapolisation
du monde
La
figure de la mégapole qui n’organise aucun territoire, ne puise nullement sa
dynamique interne dans la production et croît sans règle ni mesure, suggère
que l’on est confronté moins à une crise urbaine qu’à un changement
radical de nature de l’urbain. Plus de la moitié des 15 plus grandes villes
du monde correspondent à cette figure où l’économie urbaine est davantage
induite par le peuplement urbain qu’elle n’en est l’inductrice[7].
Dépositaire de la « pauvreté majoritaire », la mégapole perd ses caractères
fondateurs (liberté, démocratie). Le destin de ces agglomérations est de
devenir des lieux d’aliénation et d’enfermement sécuritaire, sauf à préserver
la « diversité citadine » à travers les modèles singuliers autorisant le
miracle quotidien de la cohabitation de millions de gens dans des conditions
extraordinairement difficiles.
Les
prescriptions de la bonne gouvernance
Quelle
place, dans ces conditions, pour l’intervention publique ? A l’instar de
celles appliquées en France depuis une dizaine d’années, les prescriptions
de la bonne gouvernance urbaine s’apparentent à celle du pâté d’alouette.
Balançant entre polarité sociale et polarité économique, entre le tout
quartier et le tout marché appréhendé à l’échelle régionale, la
politique de la ville peine à trouver ses marques. Les problèmes de la ville
se trouvent réduits à leurs dimensions technique, juridique et financière ;
ils sont en quelque sorte exclus du champ politique. Que dire lorsque cette
politique se résume à une juxtaposition d’interventions sectorielles financées
de l’extérieur dans le cadre d’un pilotage à vue aux effets où le droit
se trouve en quelque sorte hors la loi ? Les maires de la plupart des grandes
villes du Sud doivent négocier au coup par coup avec des chefs de terre, des
porteurs d’eau ou des transporteurs informels aussi bien qu’avec les
bailleurs de fonds internationaux. Faut-il se résigner à une impuissance définitive
de l’action publique sur la ville ? Est-il encore possible de redonner à la
question urbaine toute sa dimension politique ?
Pour
repenser la civilisation urbaine, il faut combattre les illusions de
l’urbanisme rationaliste et, plus généralement, toutes les visions utopistes
et/ou volontaristes conduisant à un zonage strict espace-fonction ne tolérant
aucune fraction d’espace qui n’eût pas été explicitement désignée et réservée.
Nombre de professionnels africains de la ville ont pourtant été formés à
cette école du zonage et ils rechignent à abandonner les « certitudes »
qu’elle leur a inculquées. Il n’est pas moins indispensable de se défier
de l’ultralibéralisme générateur de dégâts urbains incommensurables et de
se prémunir contre certaines formes de passéisme considérant que la
restitution des trames urbaines du passé – ce qui, dans la plupart des villes
africaines n’a pas grande signification – engendre ipso
facto un retour à un mode de vie «
communautaire » sans hiérarchie ni conflit et rend aux communautés locales le
pouvoir de décision sur leur avenir. La coopération urbaine internationale a
longtemps imposé aux Africains une « logique de projet » largement inspirée
de la pratique du zonage. Or, le projet urbain ne peut en aucun cas être
identifié à une forme globale de la ville. On traite des morceaux de villes en
jouant avec l’inertie de la morphologie matérielle. On produit de la ville,
pas « la ville ».
Faut-il,
en désespoir de cause, assimiler à un modèle de ville tout ce qui relève de
la « production populaire » de la ville ? Face à un espace public émietté
au gré des arbitrages qu’opèrent des consommateurs individuels, on sera tenté
de rechercher des solutions du côté de montages hybrides combinant les
associations d’habitants et les services communaux dans la gestion des
services de proximité (type « régies communautaires »). Dès lors qu’il y
a création urbaine, il y a négociation. Il faudrait que les plans directeurs
fonctionnent moins comme modèle de ville que comme nouvelle règle du jeu dans
le cadre d’un processus social actif. La question est donc : comment réussir
à politiser la question urbaine dans un contexte de démocratisation ? La décentralisation
est bien au cœur d’un processus de réforme des structures de l’Etat
susceptible d’enclencher un tel processus. Fortement recommandée par les
bailleurs de fonds, elle est aussi suscitée d’en bas, par des mouvements
sociaux urbains manifestant une aspiration à la démocratie locale. On peut
toutefois se demander si les pouvoirs locaux ne se trouvent pas réduits, in
fine, à favoriser l’intégration
fonctionnelle au marché en développant des pratiques de marketing
s’adressant à d’hypothétiques investisseurs.
3.
Jeux d’acteurs en ville autour de l’assainissement et des déchets
Il
est demandé à des pays affectés d’une croissance urbaine très rapide et
d’un phénomène de pauvreté majoritaire de faire en quelques décennies ce
que les pays du Nord ont fait en plus d’un siècle dans un contexte de prospérité
économique. La ville non desservie par les réseaux croît en superficie et en
effectifs et les petits centres urbains sont laissés de côté par les
investisseurs privés et par les responsables politiques. Que faire dans ces
espaces « marginaux » ? Faut-il considérer l’eau et l’assainissement
comme marchandises banales ou comme biens communs affectés d’une forte charge
de culture et de spiritualité ?
•
En Afrique, les régies municipales ont
échoué dans la mise en oeuvre de solutions satisfaisantes. Ces acteurs, sans
abandonner complètement le terrain, se sont donc trouvés confrontés à un
grand nombre d’acteurs privés prétendant suppléer la carence du service
public. Il en est résulté un inquiétant foisonnement institutionnel et une
prolifération normative que nul n’est plus en mesure de maîtriser. Les
municipalités se voient attribuer les responsabilités principales dans le
cadre des réformes de décentralisation. Elles se heurtent toutefois aux prétentions
de l’Administration centrale. D’une manière générale, les biens et
services urbains sont devenus une monnaie d’échange électorale sur un marché
plus marqué que jamais par le clientélisme.
•
Les entreprises publiques rentrent
complètement dans ce type de stratégie en se réclamant d’une légitimité
juridique qui leur reconnaît une position de monopole.
•
Eglises, associations de jeunes, de femmes,
de quartier, etc., sont tentées
d’investir le champ des grands services publics. Ces associations de base se
lancent dans une recherche de reconnaissance légale qui profite à leurs
leaders mais les expose aux contraintes administratives et fiscales.
•
Les petits concessionnaires agissent
sous le contrôle étroit des autorités coutumières et dans le cadre des
alliances familiales. Ils s’efforcent d’échapper à cette légitimité
contraignante en obtenant des contrats de concession plus sécurisants car de
plus longue durée. Les exploitants délégués négocient avec l’Etat ou avec
les collectivités locales, soit la concession, soit l’affermage, soit la
simple délégation de gestion. Mais, le plus souvent, c’est sans aucune légitimité
juridique qu’ils assurent l’essentiel des tâches.
•
Les entreprises privées concessionnaires,
généralement étrangères, revendiquent également un monopole pouvant donner
lieu à tous les abus dans la mesure où elles agissent hors de tout contrôle
public.
•
ONG et bureaux d’études se
sont appropriés un véritable marché de l’intermédiation entre les acteurs
précédemment évoqués mais ils n’ont aucune légitimité pour exercer dans
la durée l’indispensable fonction de régulation entre opérateurs et
pouvoirs publics.
En
viennent donc à coexister en cercles concentriques des systèmes sociaux qui
fonctionnent selon leur logique propre et se côtoient sans s’interpénétrer.
Seul traverse ces logiques un petit entrepreneuriat local à base familiale et
clientéliste, habile à réaliser son « accumulation primitive » à partir
des opportunités ouvertes par les « projets » que finance l’aide
internationale.
3.2.
Place et statut de ces acteurs
La
plupart de ces acteurs circulent dans un espace balisé par trois pôles :
•
Identité culturelle stricto sensu,
ethnique, diasporique, religieuse, nationale, etc., menacée de dérive
communautariste ou de dissolution dans une modernité réduite au marché, au
droit et à la raison. De nombreux exemples de ces dérives sont fournis dans
les rapports. Je n’en retiendrai qu’un : la mise en avant, par la communauté
autochtone de Bobo Dioulasso, d’une logique de l’honneur, de la honte et de
la malédiction pour justifier la forme d’opposition à la municipalité que
représente la salissure de la ville (Shadyc-A04).
•
Participation individuelle ou collective à la vie économique
(Hydroconseil-A01, le maillon de la vidange mécanique) et politique
(Cittal-D02, les Amicales à Fès) de la cité.
•
Capacité à être Sujet de son expérience personnelle, à créer sa propre
existence en procédant à des choix qui sont les siens, en mettant en
correspondance sa conscience et son action. Le rapport Shadyc-A04 pose
explicitement la question de l’autonomie du Sujet par rapport aux liens de dépendance
communautaire.
Les
acteurs sociaux réels ne se réduisent ni à des agents de reproduction de
l’ordre établi (par exemple celui de la base conservatrice d’un système de
notables locaux), ni à de purs opérateurs de la rationalité impersonnelle des
marchés et des techniques ; ils combinent une mémoire culturelle et des
projets économiques et professionnels. Un acteur appartient aujourd’hui nécessairement
à plusieurs « mondes », définis comme expressions pratiques et conséquences
logiques de cadres référentiels. Ces différents « mondes » recèlent des
représentations et des projets de ville différents.
Le
statut des acteurs procède en fait de deux modes de structuration :
•
Statut associé à « l’effet de grappe
» : il s’agit du rattachement d’apparentés proches ou lointains, de
clients ou de commensaux à un personnage qui assure une sécurité minimale au
groupe et joue à l’occasion le rôle de « courtier » (voir les travaux d’Emmanuel
N’Dione de Enda).
•
Nombre de groupes se présentent comme des « groupes
problématiques » : c’est une catégorie
qui fonde sa spécificité à partir d’un problème social commun que le
groupe cherche à résoudre en construisant des filières d’accès à l’Etat.
Ces groupes sont hétéroclites et ne trouvent leur homogénéité que grâce au
problème social. On en trouve des exemples dans les Amicales de Fès Agdal,
Cittal-D02 ; les SNG (Structures non gouvernementales) de Cotonou, TechDev-D09 ;
ou encore les Comités de rue de Lomé, Eamau-D10.
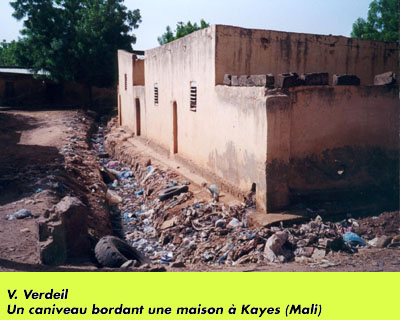 La
« société civile », si souvent invoquée sans être clairement définie,
n’est pas le système complet et hétéroclite des organisations non étatiques,
pas plus qu’elle n’est la société au sens large. C’est la partie de la
société qui s’organise, s’engage, se regroupe avec l’objectif de
s’accaparer tout espace occupé par l’Etat et la société politique. La
vision contestable d’un Etat neutre et garant de l’intérêt général
sous-tend l’option décentralisatrice dans un contexte où offre et demande de
services sont spontanément régulées par un marché concurrentiel sur lequel
interviennent simultanément pouvoir central et multiplicité d’institutions
locales. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer l’absence de véritable
société civile en Afrique : la confusion des sphères publique et privée, la
non-autonomisation de l’économique par rapport au politique et
l’inexistence d’une classe moyenne nettement différenciée. A cette
question, la réflexion du Shadyc-A04 apporte une réponse, sans doute plus
nuancée mais rejoignant au fond le diagnostic précédent : « L’espace
public aussi se cherche dans les métamorphoses du système social et urbain qui
renvoie peut-être à l’émergence d’une “société civile“. La ville
est aujourd’hui faite d’une constellation de groupes sociaux (communautés
ethniques ou religieuses, association…), de classes et de catégories
sociales, formelles ou informelles, qui se constituent en groupes d’intérêt
plus ou moins déclarés ».
La
« société civile », si souvent invoquée sans être clairement définie,
n’est pas le système complet et hétéroclite des organisations non étatiques,
pas plus qu’elle n’est la société au sens large. C’est la partie de la
société qui s’organise, s’engage, se regroupe avec l’objectif de
s’accaparer tout espace occupé par l’Etat et la société politique. La
vision contestable d’un Etat neutre et garant de l’intérêt général
sous-tend l’option décentralisatrice dans un contexte où offre et demande de
services sont spontanément régulées par un marché concurrentiel sur lequel
interviennent simultanément pouvoir central et multiplicité d’institutions
locales. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer l’absence de véritable
société civile en Afrique : la confusion des sphères publique et privée, la
non-autonomisation de l’économique par rapport au politique et
l’inexistence d’une classe moyenne nettement différenciée. A cette
question, la réflexion du Shadyc-A04 apporte une réponse, sans doute plus
nuancée mais rejoignant au fond le diagnostic précédent : « L’espace
public aussi se cherche dans les métamorphoses du système social et urbain qui
renvoie peut-être à l’émergence d’une “société civile“. La ville
est aujourd’hui faite d’une constellation de groupes sociaux (communautés
ethniques ou religieuses, association…), de classes et de catégories
sociales, formelles ou informelles, qui se constituent en groupes d’intérêt
plus ou moins déclarés ».
3.3. Quels enjeux par rapport à l’assainissement et aux déchets ?
1.
La philosophie du progrès, figure accomplie de l’universalisme, a pour
contrepartie le rejet plus ou moins violent
des expressions culturelles aussi bien que
des acteurs sociaux apparaissant comme des particularismes ou des traditions,
des représentations du propre et du salubre résistant au progrès. Comme
indiqué dans le rapport Lasdel-A03, « la
brousse n’est jamais très loin »:
certaines pratiques populaires génératrices de saleté semblant relever de
comportements usuels en milieu rural, grand est le risque de réifier une catégorie
du propre assimilé à l’urbanité. On est bien confronté ici, comme en témoigne
cet extrait d’une thèse récente, à un travail de déconstruction d’une idéologie
remontant à l’époque coloniale et portée en particulier par les
missionnaires.
«
Le boa-totem vit le plus souvent dans
l’espace résidentiel de son propriétaire (…). Dans la plupart des cas, les
latrines sont considérées comme étant leur principal lieu d’élection
(…). Ce lien du boa et des déjections traduit une certaine pérennité des
représentations pré-coloniales du caractère sacré des substances fécales et
amène les habitants à porter une attention particulière à leurs latrines :
d’aucuns par exemple interdisent leur utilisation à des personnes étrangères
ou de passage (…). Certains évoquent même le recours à diverses techniques
curatives (déversement de chaux ou de fongicides, blocage du trou à l’aide
d’un parpaing, etc.) dans le cas où les lieux d’aisance sont suspectés
d’abriter un boa » (Durang, 2003[8]).
La
recherche Shadyc-A04 montre pourtant que ce sont moins les conceptions
culturelles particulières de la saleté et de la propreté que
l’appropriation sociale de l’espace habité et l’insertion dans les
relations de proximité qui structurent les pratiques des habitants en matière
d’assainissement. Les interactions entre acteurs auxquelles ces pratiques
donnent lieu contribuent à établir les rapports de civilité et d’urbanité.
2.
La question de l’innovation technique,
sociale et politique. Peut-on parler avec
N’Djaména-D01de solutions techniques très innovantes en matière de tri ?
Les enjeux du développement urbain durable se trouvent biaisés si n’est pas
accompli le travail de déconstruction idéologique mentionné au point précédent
: un tel travail permet de mesurer la relativité des notions de besoin et de
demande publique : degré d’ancienneté du bien désiré, dans la conscience
et dans la pratique ; expression variable selon les cultures ; problématique
des biens publics mondiaux. L’action Cereve-A10 insiste par exemple sur des
stations de lagunage qui n’intéressent pas plus les chercheurs que les
responsables de ces ouvrages publics, mais seulement les bailleurs et les
techniciens du Nord. Dans N’Djaména-D01, les auteurs fournissent une appréciation
des besoins sociaux en matière de valorisation des déchets. Ceux de Cittal-D02
s’efforcent d’identifier un cercle vertueux de l’urbanité où l’amélioration
du service d’ordures appellerait de nouvelles demandes.
La
crise de la distinction entre privé et public déjà évoquée ne résulte pas
du seul héritage précolonial ; elle doit beaucoup à la pénétration du marché
et aux stratégies des entreprises qui font que la vie urbaine, en particulier
celle des consommateurs, est de plus en plus organisée sur des segments de
marché et donc de moins en moins par l’opposition du public et du privé. Se
posent ici les questions de l’intérêt général et du service public, mais
aussi celle de la confusion croissante entre ressources communes et bénéfices
particuliers. On interrogera à ce sujet les acteurs de la vidange mécanique et
leur construction d’une stratégie commerciale dynamique (Hydroconseil-A01),
ou les SNG de Cotonou qui ne peuvent pas conserver leur statut associatif et
doivent envisager de prendre un statut d’entreprise ou de GIE (TechDev-D09).
L’action Eamau- D10 montre également comment l’interface entre dimension
municipale et niveau privé ne semble pas intégrée dans une dynamique de
gestion participative pour la gestion des dépotoirs intermédiaires.
3.
Peut-on dire que l’adaptation du paradigme environnemental conduit à une
recomposition des institutions et de l’action publique locale
? C’est ce que suggère la recherche menée par Shadyc-A04, qui évoque un
processus d’élargissement progressif des « cercles de proximité » autour
d’intérêts reconnus communs. L’émergence ou le recyclage
d’entrepreneurs locaux privés souvent informels représente un défi pour la
rationalisation et l’efficacité gestionnaires. Tel n’est semble-t-il pas le
cas pour Hydroconseil-A01 qui décrit un « marché mature de la vidange mécanique
». Pour tenter de relever ces défis, se multiplient des projets
d’organisation/ encadrement, de contractualisation et de fiscalisation. Les
collectivités locales cherchent à externaliser certaines fonctions à travers
divers types d’arrangements inscrits dans deux grands cadres stratégiques :
–
instaurer des dispositifs de solidarité territoriale entre fractions d’agglomérations
(fiscalité, intercommunalité). Un tel scénario n’apparaît pas dans les
rapports ;
–
développer la régulation directe d’une mosaïque de services de base étroitement
territorialisés par le biais de subventions différenciées aux entreprises
desservant les aires les moins rentables (populations cibles de l’aide
internationale versus «
encapsulage » des pauvres) – au risque de ne responsabiliser ni les sociétés,
ni les pouvoirs locaux en précipitant les quartiers pauvres dans « l’endogestion
».
Les
collectivités décentralisées jouent-elles dans le sens d’un renouvellement
de l’action publique ou, faute d’articulation entre décentralisation et
politiques sectorielles, fonctionnent-elles comme lieu de reproduction des
logiques inégalitaires ? Se pose plus généralement la question des politiques
publiques telle que l’a formalisée le réseau IMPACT (Inégalités, micro
macro, pauvreté, acteurs[9]).
Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle l’ambition d’atteindre des
politiques publiques globales étant est hors de portée, il convient
d’imaginer de nouvelles politiques publiques plus réalistes parce que partant
des acteurs concernés, de leurs intérêts, de leurs normes plurielles. Une
note récente du réseau (mai 2003) s’interroge sur l’inspiration commune
entre l’ajustement structurel et les nouveaux cadres stratégiques de réduction
de la pauvreté. En partant de l’assainissement et des déchets, il serait intéressant
de creuser certaines pistes ouvertes dans cette note : comment travailler
simultanément sur les politiques sectorielles et sur les objectifs macro-économiques
de croissance ? Comment identifier les liens entre croissance et inégalités et
aller vers des modèles de « croissance redistributive » supposant l’élaboration
de politiques sociales ?
On
peut se référer sur l’ensemble de ces questions à :
–
N’Djaména-D01 décrit le montage contractuel du projet de valorisation des déchets
entre les entreprises pétrolières, la municipalité, l’opérateur privé,
les Comités d’assainissement, la coopération décentralisée ;
–
Cittal-D02 montre comment le déchet peut être le vecteur d’une mobilisation
en faveur d’une gestion urbaine démocratisée ;
–
TechDev-D09 illustre la façon dont le paiement obligatoire de l’abonnement au
service de ramassage conduit à la monétarisation du service public, préféré
à la mise en œuvre d’une fiscalité locale à vocation redistributive, et
ainsi à l’élimination de ceux qui ne peuvent pas payer et se voient
interdire l’accès au geste citoyen consistant à aller jeter leurs ordures
dans le bac de regroupement public !
D’une
manière générale, cette question de la citoyenneté politique du plus grand
nombre me semble abusivement réduite aux questions de participation ou de
concertation.
4.
La crise de distinction entre public et privé coïncide avec l’affirmation/réaffirmation
d’acteurs contestataires, le plus souvent communautaires, occupant une place
sur la scène fragmentée des contestations. Se posent ici les questions de
l’arène politique et du consensus local dans un contexte d’affrontement
entre régularité et irrégularité où les enjeux fonciers s’avèrent décisifs.
Dans Shadyc-A04, il est montré comment la contestation risque de remplacer un
despotisme d’Etat par un despotisme communautaire. Dans Ceda-D03, elle se
manifeste par un discours méprisant des techniciens tandis que dans
TechDev-D09, elle transparaît dans la différence de logique entre l’approche
projet du PGDSM et celle des initiateurs de la recherche-action (l’ONG
Tech-Dev et l’organisme de formation Crepa).
Le
« prêt à penser » le fonctionnement urbain que véhiculent les bailleurs de
fonds est en quelque sorte « endogénéisé » par les élites en fonction
d’une certaine conception de « l’ordre urbain » (good
order), mais aussi d’importants enjeux
de pouvoir entre les sphères de l’encadrement public territorial et entre
celles-ci et les acteurs économiques privés. Ce qui est en cause, c’est
aussi la réorganisation des rapports sociaux à travers la redistribution des
facteurs d’accessibilité aux ressources procurées par les services
collectifs. A partir de Cittal-D02, peut-on imaginer un « dialogue
constructif et non politique » autour de
l’hygiène et de la collecte des déchets ? Agdal et ses Amicales pourraient
bien être l’élite moderne !
L’ensemble
des enjeux présentés ici, de manière non exhaustive, convergent pour
questionner l’articulation entre modèles de développement et modèles de
ville. Cette convergence n’est guère mise en évidence dans les rapports. Il
serait particulièrement intéressant de voir comment les enjeux propres à
l’assainissement et aux déchets interfèrent ou non avec la question du
logement.
4.
Quelles logiques ? Quelles stratégies ?
Partant
du concept d’habitus développé par Bourdieu[10],
on s’interrogera sur la grande variété des logiques de confrontation et de négociation
mises en évidence par les rapports et sur les échelles de régulation dans les
espaces d’interaction denses que sont les villes.
Logique
d’ignorance
Faut-il
inscrire sur ce registre l’incapacité à faire appliquer les normes publiques
? On relève en tout cas la non-prise en compte du dispositif étatique
national, en particulier les sociétés nationales, par les bailleurs qui
poussent à des réformes de décentralisation au « bénéfice » d’élus
locaux insuffisamment préparés aux tâches de commandement, de gestion et
d’organisation ; d’où la multiplication d’espaces « en friches » où prévalent
dynamiques de désintégration et polarisations ethno-régionales. Un bon
exemple en est fourni par la vidange mécanique (Hydroconseil-A01), maillon
essentiel des systèmes autonomes d’assainissement : face au désintérêt des
pouvoirs publics, il s’organise tout seul mais reste à la merci
d’intervention étatique (réglementation, prix, etc.). A un autre niveau, on
peut noter le dialogue de sourd entre les pratiques réelles en matière de
lagunage et les interrogations des chercheurs dans Cereve-A10, ou encore les
sollicitations de la Mairie en ce qui concerne les ordures, auxquelles les
populations du quartier opposent des priorités renvoyant à des expériences
passées et oubliées par les instances municipales dans Eamau-D10.
Logique
de détournement
En
relève l’entretien de l’illusion communautaire guidant l’action et
s’insérant dans les rapports entre acteurs locaux engagés dans les projets.
Or, en Afrique, prévaut une vieille tradition de contournement, d’évitement,
de subversion, par laquelle la société réussit à éroder la domination de
l’Etat, à le maintenir à distance sans pour autant l’ignorer. On se
gardera cependant de verser dans la vision prométhéenne d’une société
civile parée de toutes les vertus, vision portée par l’école de la Society
centered approach. L’affirmation souhaitée
d’un « pouvoir social » risque fort de déboucher sur la fragmentation et le
localisme, tant il est vrai que la société civile que l’on invoque n’est
pas porteuse d’un projet cohérent et mobilisateur à l’échelle de la société
tout entière, qu’elle est par définition hétérogène (sinon « gélatineuse
») et peut aussi briller par son incivilité, comme le montrent les exemples de
salissure volontaire de l’espace public dans Shadyc-A04 et ceux de détournement
des équipements d’assainissement ou les cas de déconnexion du réseau dans
ENSP-A08.
Logique
de manipulation et d’instrumentalisation réciproques
Les
systèmes de normes « officiels » et « officieux » peuvent difficilement
rester longtemps étanches l’un vis-àvis de l’autre. On observe une
collusion de fait entre autorités administratives, collectivités locales,
entrepreneurs privés et usagers pour pallier le manque de moyens et renforcer
le clientélisme local. Ceda-D03 évoque ainsi les dérapages des services
techniques municipaux portés aux opérations « coup de poing » en année électorale.
 L’infantilisation
des acteurs de la société par ses élites au nom d’une exigence de
rationalité de l’action sociale est-elle encore de mise ? On se trouve dans
une situation où les demandes d’une société civile en recherche des
conditions de son expression sont contredites par des demandes contraires ou
contradictoires d’autres acteurs sociaux – voire des mêmes acteurs dans
d’autres rôles – qui pratiquent une sorte de « servitude volontaire » en
attendant de l’Etat et des institutions la solution de tous leurs problèmes.
Dans le même rapport du Ceda-D03, on peut s’interroger sur une démarche
participative qui semble être mise en place pour « faire
plaisir aux autorités » et s’appuie
sur des ONG locales réputées proches des populations, mais dont les leaders
appartiennent souvent à une élite locale entretenant peu de liens avec les
couches populaires et visent la satisfaction d’avantages personnels.
L’infantilisation
des acteurs de la société par ses élites au nom d’une exigence de
rationalité de l’action sociale est-elle encore de mise ? On se trouve dans
une situation où les demandes d’une société civile en recherche des
conditions de son expression sont contredites par des demandes contraires ou
contradictoires d’autres acteurs sociaux – voire des mêmes acteurs dans
d’autres rôles – qui pratiquent une sorte de « servitude volontaire » en
attendant de l’Etat et des institutions la solution de tous leurs problèmes.
Dans le même rapport du Ceda-D03, on peut s’interroger sur une démarche
participative qui semble être mise en place pour « faire
plaisir aux autorités » et s’appuie
sur des ONG locales réputées proches des populations, mais dont les leaders
appartiennent souvent à une élite locale entretenant peu de liens avec les
couches populaires et visent la satisfaction d’avantages personnels.
La
rhétorique du développement participatif confronte un «local» voué à la
disette permanente à la domination économique et politique d’entrepreneurs
identitaires qui monopolisent la relation entre les populations et le pouvoir
central. La décentralisation court donc le risque d’enclencher un mécanisme
de mise à distance d’un local déconnecté des enjeux nationaux et globaux et
elle n’ouvre pas véritablement de nouvelles possibilités d’action publique
partant des citoyens. On peut sur ce point se référer aux rapports suivants:
–
Eamau-D10 : à travers les « comités de surveillance des rues », le contrôle
social fonctionne à Lomé sous l’impulsion de la JDQ (Jeunesse pour le Développement
du Quartier, association de pré-collecte), du CDQ (Comité de Développement de
Quartier ) et de la Mairie sous un des régimes les plus autocratiques que
connaisse l’Afrique ;
–
Lasdel-A03 montre comment le volontarisme des interventions extérieures est
manipulé par les collectivités locales, tandis que Cittal-D02 développe les
enjeux politiciens des relations entre élus et amicales ;
–
le rapport Era-D05 indique que « Hysacam
serait intéressé à prendre en charge une partie du personnel, mais pour
l’instant, cela pourrait porter entrave à l’autonomie des opérateurs de pré-collecte
».
Logique
de compétition et d’exclusion
Faute
de mécanismes négociés et reconnus, l’exclusion d’un système de normes
par un autre n’aboutit pas à l’avènement d’un type stabilisé de régulation
de l’accès aux ressources et aux services. Il faut bien voir que, quand l’Etat
est faible, la société civile l’est également et s’avère impuissante à
contenir l’éclosion de mouvements incivils ; on observera aussi que plus un
pays est arriéré économiquement et plus est impérieux est le besoin d’État
(cf. Stiglitz[11]).
Ces
rapports de force ou conflictuels sont illustrés dans plusieurs études du
programme :
•
Hydroconseil-A01 : « Les acteurs du secteur de la vidange mécanique sont très
critiques par rapport aux ONG porteuses de technologies “appropriées“ » ;
•
ENSP-A08 aborde les relations tendues entre les promoteurs immobiliers (MAETUR[12]
et SIC[13])
d’une part, et la Communauté urbaine de Yaoundé d’autre part, autour des
infrastructures d’assainissement ;
•
Cittal-D02 montre que les élus vont d’une attitude de blocage à une attitude
de non participation au Comité de suivi qu’animent les Amicales ;
•
Era-D05 : malgré son implication dans le projet, Hysacam n’envoie aucune
copie du cahier des charges à la Communauté urbaine de Yaoundé pour
validation.
Logique
de convergence
On
trouve dans les rapports un certain nombre d’exemples de médiations opératoires
entre dispositif public et stratégies privées.
•
Moshi-A05b : un jeu d’acteurs semble avoir permis la mise en place de règles
relativement pragmatiques en matière de régulation ;
•
Gret-A07 : le passage du comité de pilotage de l’opération pilote au comité
d’assainissement pérennisant le travail collectif des acteurs peut être lu
comme une construction progressive de l’urbanité ;
•
Cittal-D02 : les médiateurs qui émergent du projet sont à la fois contrôleurs
sociaux, canalisateurs des vœux de la population et traqueurs de déviants.
Les
pratiques des acteurs instituent une « zone intermédiaire » de règles et
d’organisations qui correspond souvent à des « espaces sociaux de proximité
» ou à des «dispositifs collectifs privés » qui s’efforcent de garantir
un minimum de durabilité dans les interactions entre acteurs. Dans Era-D05, les
auteurs postulent la crédibilité à moyen-long terme des prestataires de
service. Ceux de TechDev-D09 laissent à penser que l’arrimage SNG/entreprises
privées de collecte aux points de regroupement est jugé effectif par la
Communauté urbaine. Dans les deux cas, on peut toutefois se demander dans
quelle mesure ces points sont réellement acquis.
Le
poids croissant des acteurs locaux et les logiques marchandes prévalant dans
les dispositifs d’offre aboutissent à une hétérogénéité accrue «
d’arrangements territorialisés ». Un exemple en est donné dans Tech-
Dev-D09, où les 4 SNG revendiquent leur rôle légitime d’association de
quartier, non seulement comme ramasseurs d’ordures mais aussi comme acteur à
part entière de la propreté du quartier ; la Cogeda juge en revanche irréaliste
le compostage décentralisé et recherche une solution de compostage centralisé.
Intervient dans ces arrangements la résistance des sociétés locales à un
changement venu d’en haut. Mais le local s’appuie aussi sur des communautés
d’acteurs, de savoirs partagés et de processus d’apprentissage : lieu du
compromis stratégique entre logiques du haut et du bas ou lieu d’antagonisme
irréductible entre logiques d’acteurs issues de cultures différentes
(municipalités, ONG, grandes firmes) ? Malgré les questions que peuvent poser
les stations de lagunage aux chercheurs ou aux bailleurs, il est indéniable que
localement, les activités des maraîchers et des pisciculteurs sont étroitement
dépendantes de leur bon fonctionnement (Cereve-A10).
Les
dispositifs de privatisation et de communautarisation circonscrivent le domaine
d’action directe des pouvoirs publics recentré sur une fonction de «
facilitation » : techniques de concertation et de construction de consensus à
géométrie variable et à rayon d’action réduit. Dans Tenmiya-D07,
l’organisation mise en place repose sur une cascade de contrats et conventions
liant les différentes parties. Dans Era-D05, l’ONG Era se trouve en position
de juge et partie en tant que signataire avec l’entreprise Hysacam et la
municipalité de Yaoundé du contrat établi avec les structures relais des
quartiers et les prestataires de pré-collecte ; mais quid
de la capacité d’Era à devenir un
prestataire pérenne dans la pré-collecte ?
Ce
qui apparaît, c’est plus l’affirmation d’acteurs aux intérêts et aux
stratégies antagoniques sur la scène locale (communautés, leaders
traditionnels, groupements volontaires) et l’émergence de formes renouvelées
de l’autochtonie qu’une articulation renouvelée entre pouvoirs publics et
acteurs sociaux à travers l’usage d’outils de redistribution.
On
retiendra des études de cas réalisées la complexification du jeu des acteurs.
Il faut aussi prêter attention à la recomposition des alliances entre les
pouvoirs publics et les élites urbaines, et plus encore avec les couches
moyennes frappées par les déclassements et la paupérisation. Les territoires
urbains sont de plus en plus hétérogènes, socialement et économiquement différenciés,
désolidarisés par des systèmes gestionnaires autonomisés (Bourdin[14]
parle « d’ententes oligopolistiques de la gouvernance locale »).
L’échelle
communautaire est, dans ces conditions, un puissant ressort identitaire mais
aussi un outil inopérant de la gestion urbaine. L’illusion du learning
by doing – qu’invoque notamment le
projet Tenmiya-D07, présenté comme une occasion pour l’ensemble des acteurs
d’apprendre par l’action concrète, ne contribue pas plus à la conception
et à la mise en oeuvre de véritables politiques publiques. Les études
fournies à l’issue du programme apportent quelques réponses à la question
du positionnement des ONG dans l’espace public. Elles situent bien ces dernières
dans une relation d’opposition/coopération avec les décideurs publics ou les
opérateurs privés (Hydroconseil-A01), et ce à toutes les échelles
d’organisation, du local à l’international. Elles interrogent aussi la crédibilité
d’un discours auto-instituant par lequel les ONG prétendent parler au nom de
« l’opinion publique » et défendre des intérêts généraux (Lasdel-A04,
Gret-A07, Ceda-D03, Burgeap- D06 notamment).
Plusieurs
questions majeures me paraissent en revanche insuffisamment traitées :
•
Le rapport entre privé et public.
L’irruption de la grande entreprise urbaine de service est récente en
Afrique. Dans un domaine où les « lois du marché » ne sont pas directement
opératoires, la question posée est donc celle d’un environnement régulatoire
global dont les composantes sont la légitimité des élus locaux, la définition
précise du domaine public, l’existence de fondements juridiques solides. La
question est bien de savoir comment instaurer un processus dynamique
d’apprentissage d’un nouveau mode de relation entre acteurs attentif à la
fois aux savoirs locaux, au principe de solidarité et à une subsidiarité
active donnant effectivement la parole à tous.
•
La décentralisation.
Comment investir les nouveaux dispositifs de pouvoirs locaux de missions d’intérêt
public ? Les coalitions d’intérêts souvent éphémères qui se forment à
l’échelle locale promeuvent sans doute des pratiques originales de négociation
; mais la question se pose de savoir comment et à quelles fins se construit un
pouvoir local. Il semble bien difficile de chercher à assigner une position
privilégiée aux collectivités locales tout en valorisant les communautés
d’appartenance et en favorisant nolens
volens l’atomisation de la « société
civile ». Si l’espace public se cherche dans les métamorphoses du système
social et urbain, force est d’admettre que l’appropriation du modèle représentatif
et l’émergence de processus civiques fondés sur l’organisation collective
demanderont du temps.
Études
citées dans cette synthèse
Hydroconseil-A01.
Les entreprises de vidange mécanique des systèmes d’assainissement autonome
dans les grandes villes africaines (Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Bénin,
Tanzanie, Ouganda)
Lasdel-A03.
La question des déchets et de l’assainissement dans deux villes moyennes
(Niger)
Shadyc-A04.
Une anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques
sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine (Burkina Faso)
Moshi-A05b
(Université de Dar es Salam / Université de Pau et des pays de l’Adour).
L’amélioration des services d’assainissement de la ville de Moshi. Analyse
de la demande et régulation du secteur (Tanzanie)
Gret-A07.
Planification concertée pour la gestion des excreta (Mauritanie, Éthiopie)
ENSP-A08.
Gestion et valorisation des eaux usées dans les zones d’habitat planifié et
leurs périphéries (Cameroun, Tchad)
Cereve-A10.
Valorisation des eaux usées par lagunage dans les pays en développement
(Niger, Cuba, Burkina Faso, Sénégal, Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun)
N’Djaména-D01.
Tri sélectif et valorisation des déchets urbains de la Ville de N’Djaména
(Tchad)
Cittal-D02.
Réflexion concertée pour une gestion intégrée de la propreté entre
population, puissance publique et opérateur privé : le cas de Fès (Maroc)
Ceda-D03.
Recherche d’espaces pour le dialogue, la prise de conscience et
l’organisation en vue de l’action dans la commune urbaine (Bénin)
Era-D05.
Mise en place de structures de pré collecte et de traitement des déchets
solides urbains dans une capitale tropicale, Yaoundé (Cameroun)
Burgeap-D06.
Analyse des procédés de recyclage des déchets au Vietnam pouvant être transférés
vers l’Afrique (Vietnam, Sénégal)
Tenmiya-D07.
Projet d’appui aux petits opérateurs «transporteurs des déchets solides»
du quartier de Basra à Nouakchott (Mauritanie)
TechDev-D09.
Maîtrise de l’amont de la filière déchets solides dans la ville de Cotonou
: pré-collecte et valorisation (Bénin)
Eamau-D10.
Opportunités et contraintes de la gestion des déchets à Lomé : les dépotoirs
intermédiaires (Togo)
Etude-AfD.
« Revue comparative des modes de gestion des
déchets urbains adoptés dans différents pays de la ZSP », réalisée pour
l’AfD
[1]
Debord, G., La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1996.
[2]
Marie, A. (éd.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, 1997.
[3] Le Pape, M., L’énergie sociale à Abidjan. Economie politique de la ville en Afrique Noire, 1930-1995, Paris, Karthala, 1995.
[4] Congrès Internationaux d’Architecture Moderne
[5] Sassen, S., La ville globale, Paris, Descartes et Cie, 1996.
[6] Davis, M., City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur, Paris, La Découverte, 1997.
[7] Haeringer, P., L’économie invertie : mégapolisation, pauvreté majoritaire et nouvelle économie urbaine, Plus, 2001, n° 50.
[8] Durang, X., Vivre et exister à Yaoundé. La construction des territoires citadins, thèse de géographie soutenue le 20/05/2003 devant l’Université Paris IV.
[9] www.reseau-impact.org
[10]
Bourdieu (Questions
de sociologie, Paris, Éditions de
Minuit, 1992) évoque des systèmes de disposition durables, des habitus,
qui, sans prétendre concurrencer le dispositif institutionnel, le complètent
au point de l’absorber parfois dans leur logique «fonctionnelle». Hommes
et ressources s’organisent autour de ces dispositifs selon trois principes
d’efficacité :
–
conçus et structurés sur la base des réseaux traditionnels d’échanges
et d’alliance, ces dispositifs changent de nature sous l’impact de
nouvelles fonctions ;
– les règles empruntent à un langage et font référence à des valeurs endogènes qui connotent cependant l’émergence de « valeurs communes » se différenciant aussi bien de la « tradition » que de la « modernité ». On peut ajouter que, dans bien des cas, c’est la « modernité » qui génère la « tradition » ;
– les systèmes sont caractérisés par une logique fonctionnelle concurrençant la logique institutionnelle des dispositifs étatiques ou capitalistes.
[11] Stiglitz, J., La grande désillusion, Paris, Fayard, 2002.
[12] Mission d’Aménagement des Terrains Urbains et Ruraux, établissement public.
[13] Société Immobilière du Cameroun, société d’économie mixte.
[14] Bourdin, A., La question locale, Paris, PUF, 2000.