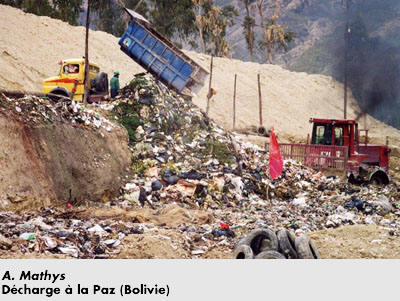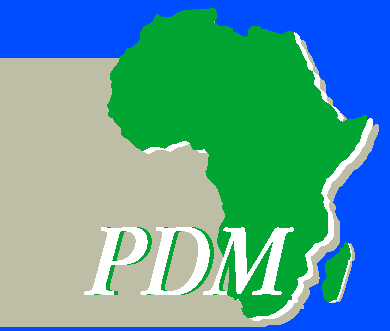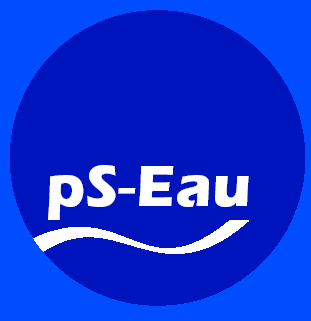Synthèse des acquis du programme
Le financement de l’assainissement solide et liquide en Afrique. Considérations générales.
Alain
Mathys (Suez-Environnement)
Sommaire
2.
Les besoins en financements – les investissements
3.
Les besoins en financement – les frais d’exploitation et d’entretien
4.
Mécanismes de recouvrement des coûts
Cette note vient en complément
des deux synthèses « Assainissement » et « Déchets »
ci-avant, ainsi que de celle sur « Quel rôle pour la commune ? »
ci-après, qui abordent également la question du financement de
l’assainissement solide et liquide en Afrique. Son objet est de resituer cette
question dans une approche plus globale (macro-économique), restituant la réflexion
en cours dans de nombreuses enceintes internationales, et d’illustrer par des
cas, y compris d’autres régions du monde (Bolivie), les modalités de
financement au niveau local qui ont pu être mises en œuvre.
Dans le cadre des
objectifs de développement du millénaire, le financement de l’assainissement
liquide et solide en Afrique représente un défi particulièrement difficile à
relever dans la mesure où les niveaux d’accès à ces services sont particulièrement
bas :
• on estime qu’au
moins 45 % de la population de l’Afrique sub-saharienne, soit 300 millions
d’habitants, n’ont pas accès aux services d’assainissement des eaux usées
à ces services[1]
;
• il n’existe pas de
données globalisées sur la gestion des ordures ménagères : il est donc
difficile d’avoir une vision générale des niveaux de services. La collecte
et le traitement des déchets solides sont d’abord un problème urbain, qui
doit être au moins aussi important que celui des déchets liquides. Comme près
de 300 millions d’Africains vivent en ville, on peut estimer en première
approximation que 150 millions ne disposent pas de systèmes acceptables d’évacuation
des déchets.
Le financement de
l’assainissement, liquide et solide, se pose à deux niveaux :
• le financement des dépenses
en infrastructures (équipements des foyers, réseaux de collecte, installations
de traitement pour les eaux usées ; centres de collecte, de tri et de
transfert, décharges pour les ordures ménagères) ;
• le financement des dépenses
récurrentes d’entretien, d’exploitation et de renouvellement.
Les sources de financement
se situent à quatre niveaux :
• les usagers, de manière
directe (tarifs et redevances) ou indirecte (impôts et taxes alimentant les
budgets nationaux et locaux) ;
• les prêts des
institutions de financement internationales ;
• les subventions
publiques constituées le plus souvent de dons des organismes de coopération
bilatérale;
• l’investissement
privé apporté par des investisseurs nationaux ou étrangers dans le cadre de
la mise en concession ou de la privatisation des services publics.
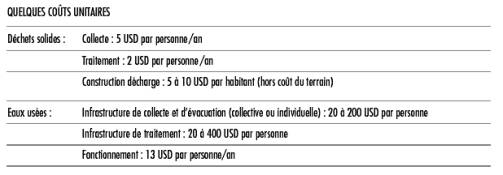
2.
Les besoins en financements – les investissements
Les
investissements requis pour les dépenses en capital afin d’atteindre des
objectifs du millénaire en matière d’assainissement (réduire de moitié la
proportion de la population non couverte par ces services), étendus au domaine
des déchets solides, ont été estimé à un peu plus de 8 milliards USD en se
basant sur les hypothèses suivantes :
–
déficit actuel de couverture en assainissement (eaux usées, excreta) : 45 %
(urbain et rural) ;
–
pourcentage des eaux usées collectées non-traitées avant rejet : 95 % ;
–
déficit actuel de couverture en collecte des déchets solides : 45 % ;
–
pourcentage des déchets solides collectés non-mis en décharge : 95 % ;
–
utilisation de technologies appropriées à faible coût ;
–
non-prise en compte des coûts fonciers pour les décharges et les stations de
traitement ;
–
investissement lié au domaine privé (latrines ou WC raccordé à un réseau)
à la charge des usagers.
Réparti
sur dix ans, l’investissement dédié à l’assainissement solide et liquide
serait donc d’environ 1 milliard USD par an (si l’on ajoute les frais d’études
et les imprévus). Rapporté aux 150 millions de personnes qui pourraient bénéficier
de services améliorés d’ici 2015, cela représente un investissement de 60
USD par personne bénéficiaire. Ce sont donc des chiffres abordables, si l’on
pense aux impacts économiques induits par l’amélioration de
l’assainissement sur la santé publique et l’environnement.
On
ne peut toutefois attendre de manière réaliste que la communauté
internationale finance ces investissements sous forme de dons comme on ne peut
attendre que les gouvernements africains, voire la population elle-même, s’en
chargent intégralement sur la base de leurs propres ressources.
La
solution réaliste en matière de financement des infrastructures (le hardware)
est un appui des institutions internationales sous forme de prêts
concessionnels, sans intérêt et à longue période de maturation, dans la
mesure où l’on peut admettre un recouvrement, partiel ou total, des coûts
par les usagers. Le software,
c’est- 80 à-dire les actions de promotion et d’éducation qui ne sont pas
financièrement rentables mais génératrices de bénéfices indirects sur la
santé et l’économie, serait financé sous forme de dons.
Un
financement efficace et durable doit obligatoirement être associé à une
gestion optimale, à la fois du développement des infrastructures et de la
gestion des services. Là également, des solutions ont été proposées, qui
lient le financement des investissements aux résultats obtenus dans un mécanisme
que la Banque mondiale a intitulé OBA (output-based
aid). Ce mécanisme peut être mis en
place aussi bien au niveau des opérateurs des services, publics ou privés,
chargés de l’extension des services et de leur gestion ultérieure que des
ONG et autres prestataires chargés des actions de promotion et d’éducation.
![]()
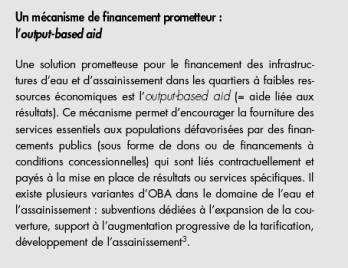 Comme
le souligne le rapport Camdessus[2],
la mise en place d’un financement efficace est dépendante de la performance
du cadre institutionnel ainsi que de la qualité de la planification et de la
gestion des projets d’infrastructures. Il est probable aujourd’hui qu’un
nombre limité d’États africains remplissent ces conditions, ce qui implique
qu’un appui aux réformes institutionnelles et des actions de formation à la
gestion municipale seront un préalable indispensable à la mise en place de
financements pour des infrastructures d’assainissement.
Comme
le souligne le rapport Camdessus[2],
la mise en place d’un financement efficace est dépendante de la performance
du cadre institutionnel ainsi que de la qualité de la planification et de la
gestion des projets d’infrastructures. Il est probable aujourd’hui qu’un
nombre limité d’États africains remplissent ces conditions, ce qui implique
qu’un appui aux réformes institutionnelles et des actions de formation à la
gestion municipale seront un préalable indispensable à la mise en place de
financements pour des infrastructures d’assainissement.
3.
Les besoins en financement – les frais d’exploitation et d’entretien
Un
système ne peut fonctionner de manière durable que si ses frais récurrents
sont supportés par ses utilisateurs. Ceci n’interdit pas la mise en place de
péréquations entre les différentes catégories économiques de consommateurs,
à conditions que le système reste performant et soit basé sur une bonne compréhension
de la capacité et la volonté des bénéficiaires de payer ces services. Une
structure tarifaire appropriée permettant d’équilibrer les charges
d’exploitation par les revenus implique également une volonté politique de
faire supporter aux utilisateurs (directement ou indirectement) le coût réel
des services.
Les
frais d’exploitation et d’entretien de l’assainissement, y compris une
provision pour le renouvellement des infrastructures, ont été estimés à 8
USD par mois et par famille de type modeste. En rajoutant une consommation
d’eau de 4 USD par mois, la charge d’une famille modeste de 5 personnes se
situerait aux alentours de 12 USD par mois. Pour une famille très pauvre dont
le revenu total est de l’ordre de 150 USD par mois (1 USD par habitant et par
jour), la part du budget du ménage consacré à l’eau et à
l’assainissement liquide et solide s’élèverait à 8 %. Ce taux
s’abaisserait à 4 % pour un ménage un peu moins pauvre, avec un revenu de 2
USD par habitant et par jour.
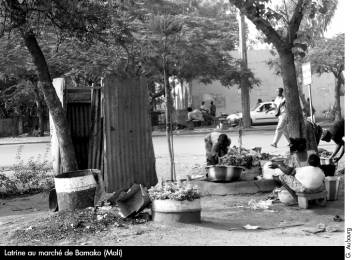
On
voit donc que, même pour des familles considérées comme très pauvres, la
charge des services d’eau et d’assainissement (y compris l’évacuation des
ordures ménagères) reste supportable. Dans le cas où le consentement à payer
serait inférieur à ce coût, les besoins de subventions ne seraient pas si élevés
et pourraient être gérés par des mécanismes de péréquations entre classes
d’usagers. Si l’on compare en particulier le bénéfice économique induit
au niveau du ménage par un accès amélioré à l’eau et l’assainissement,
la charge par ménage ne représente pas un fardeau financier insurmontable.
Là
encore, le consentement ou la capacité à payer n’est pas suffisant pour
assurer une exploitation durable des systèmes d’assainissement. L’efficacité
dans la récupération des coûts et, bien entendu, dans l’exploitation et
l’entretien des systèmes reste essentielle. L’organisation des services, la
répartition des tâches et le partage des responsabilités entre autorités
publiques et opérateurs des services (qu’ils soient publics ou privés,
grands ou petits) sont des éléments incontournables de réussite.
4.
Mécanismes de recouvrement des coûts
Le
moyen le plus simple, et le plus souvent utilisé, pour affecter aux usagers les
charges de l’assainissement liquide est d’inclure à la facture une
surcharge sur la consommation d’eau potable. Celle-ci peut être
proportionnelle au volume d’eau consommée (dans le cas d’un raccordement à
un réseau d’égout) ou représenter un montant fixe (en particulier dans le
cadre de l’assainissement autonome).
|
Le mécanisme de recouvrement pour la gestion des déchets à La Paz, Bolivie Contexte. La ville de La Paz produit environ 450 tonnes de déchet par jour, pour une population de 800 000 habitants. En 1997, la gestion des déchets municipaux fut confiée à une entreprise privée, CLIMA, pour 8 ans.
Description du
contrat. Le
contrat signé entre la municipalité de La Paz et CLIMA inclut les
services suivants :
Système de
recouvrement des coûts.
CLIMA reçoit 48 USD
pour chaque tonne de déchets mise en décharge, pour l’ensemble des
activités. La rémunération de l’entreprise est mensuelle et obtenue par
deux sources : un paiement indirect par les bénéficiaires et un paiement
direct par la municipalité.
Détail du mécanisme
financier.
Electropaz, une compagnie privée, recouvre les factures d’électricité à
laquelle la taxe de services urbains est indexée. Après une commission
couvrant ses frais de gestion, Electropaz verse la somme collectée pour
cette taxe sur un compte bancaire de la municipalité qui ne peut être
utilisé que pour le paiement du service des déchets. Ce compte sert à
payer CLIMA, mais ne couvre que 50 % de ses coûts. La municipalité paie
les 50 % restants à CLIMA à partir du budget municipal, dont la
disponibilité n’est pas toujours garantie, ce qui implique souvent des
retards de paiement. Toutefois le système fonctionne bien et la ville
est propre. Impact pour les usagers. La surcharge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers représente environ 5% de la facture électrique. Ce mécanisme institue une subvention croisée de fait, les ménages pauvres ne consommant pas ou peu d’énergie électrique.
|
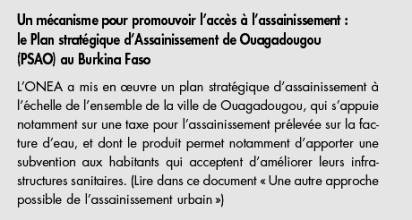 Le
recouvrement des coûts pour la collecte et le traitement des déchets solides
est moins évident. Il est difficilement envisageable de facturer directement
les usagers pour ce service, car il n’y a pas de mesures aisément applicables
en cas de non-paiement (comme la coupure du service d’eau). Le moyen le plus
simple est d’affecter également une surcharge à la facture d’un des
services publics. Une surcharge sur la facture d’électricité est préférable
à celle sur la facture d’eau car son impact apparaît comme plus faible,
proportionnellement
au montant relatif à la consommation. Par ailleurs si le paiement se fait sous
forme d’un montant proportionnel, sa dimension sociale est plus marquée dans
la mesure où la consommation d’électricité est mieux corrélée avec le
niveau économique d’un ménage que celle de l’eau. Ce mécanisme de
taxation est courant en Amérique du Sud. A La Paz (Bolivie) par exemple, la
surcharge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers représente
environ 5 % de la facture électrique (cf. encadré page précédente).
Le
recouvrement des coûts pour la collecte et le traitement des déchets solides
est moins évident. Il est difficilement envisageable de facturer directement
les usagers pour ce service, car il n’y a pas de mesures aisément applicables
en cas de non-paiement (comme la coupure du service d’eau). Le moyen le plus
simple est d’affecter également une surcharge à la facture d’un des
services publics. Une surcharge sur la facture d’électricité est préférable
à celle sur la facture d’eau car son impact apparaît comme plus faible,
proportionnellement
au montant relatif à la consommation. Par ailleurs si le paiement se fait sous
forme d’un montant proportionnel, sa dimension sociale est plus marquée dans
la mesure où la consommation d’électricité est mieux corrélée avec le
niveau économique d’un ménage que celle de l’eau. Ce mécanisme de
taxation est courant en Amérique du Sud. A La Paz (Bolivie) par exemple, la
surcharge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers représente
environ 5 % de la facture électrique (cf. encadré page précédente).
Ce mécanisme institue une
subvention croisée de fait, vers les ménages ne consommant pas ou peu d’énergie
électrique, souvent les plus pauvres.
Le coût économique,
social et environnemental de l’absence d’assainissement est largement supérieur
au coût réel du développement et de la gestion de ces services. L’évaluation
empirique des besoins d’investissement montre que, en utilisant des
technologies simples et économiques, les montants nécessaires pour atteindre
les objectifs de développement du millénaire ne sont pas astronomiques et
pourraient être assumés par de nombreux Etats africains avec l’aide des
bailleurs de fonds, à condition que ces Etats mettent en place les réformes
institutionnelles préalables à une planification et une gestion efficace de
ces services.
Par ailleurs, et bien que
peu nombreuses, les enquêtes quantitatives menées auprès des ménages démontrent
que la gêne causée par le manque d’assainissement est fortement ressentie et
qu’il existe une vraie volonté de payer pour éliminer les déchets, pour
autant que le service offert soit crédible et adapté aux besoins des usagers.
Les coûts d’exploitation de ces services sont compatibles avec les ressources
des ménages africains, à la condition que les structures tarifaires incluent
des mécanismes de subventions basés sur le consentement et la capacité réelle
à payer des foyers. Là encore, la mise en place de systèmes efficaces de
gestion impliquant autorités publiques et opérateurs de service est nécessaire.
Le préalable à des
investissements massifs est, pour de nombreux pays africains, la mise en place
de programmes de réformes institutionnelles impliquant le renforcement des
capacités municipales dans la gestion des services urbains. Il est également
dans une claire affirmation de la priorité donnée à l’assainissement dans
l’agenda politique des gouvernements.
[1]
Africa Development Bank, Achieving
the Millennium Development Goals in Africa. Progress, Prospects and Policy
Implication, 2002.