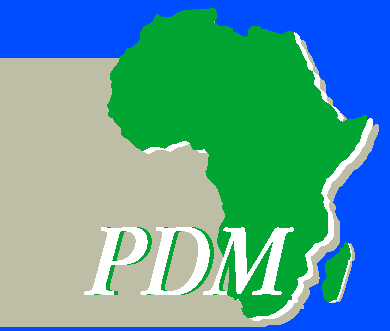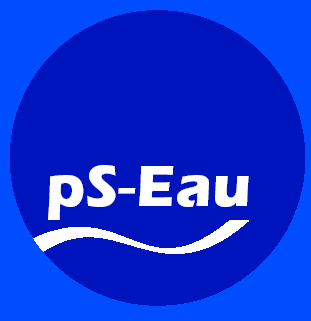Synthèse des acquis du programme
Demande sociale et
assainissement liquide
et solide
Synthèse
réalisée par Janique Etienne (AfD)
Sommaire
1.
Représentations populaires de la propreté et de l’hygiène
2.
La gêne occasionnée par le non-assainissement
3.
La gêne occasionnée par les rejets d’eaux usées et les excreta est fonction
la densité de population
4.
Satisfaction des ménages vis-à-vis des systèmes existants
5.
Un consentement à payer général mais relativement faible
Études
citées dans cette synthèse
Le nombre de latrines inutilisées ou mal entretenues, qu’elles soient publiques ou privées, et l’accumulation des déchets liquides et solides dans les rues, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, suscitent bien des interrogations.
Partant de ces constats,
beaucoup de campagnes de sensibilisation[1]
destinées à promouvoir l’assainissement auprès des ménages ont longtemps
été fondées sur une double croyance : d’une part l’assainissement ne
serait pas une priorité pour les ménages, d’autre part ces mêmes ménages
ne feraient pas le lien entre le manque d’hygiène et d’installations
sanitaires et la santé publique.
Ces méthodes ont évolué,
avec comme point de départ l’intuition que l’intimité, la commodité et le
statut des installations étaient des facteurs importants de motivation pour la
construction d’installation sanitaires. C’est sur la base de ces facteurs
relevant des pratiques locales, culturelles et sociales que se construisent
aujourd’hui les stratégies d’intervention en matière de promotion de
l’hygiène, ciblées sur les individus et sur la collectivité.
En amont de ces actions de
« promotion de l’assainissement », au moment de la conception et de la
planification d’un programme d’équipement, l’analyse de la demande des ménages
vise à :
– dimensionner des «
offres » techniques par segment de population ;
– améliorer le niveau
d’équipement et les pratiques des ménages engendrant de réelles améliorations
des conditions de vie, dont la santé ;
– évaluer le degré de
contribution des usagers au financement de tout ou partie des investissements et
de l’entretien des équipements.
Elle est ainsi essentielle
pour l’atteinte des objectifs du projet ou programme.
Nous nous proposons dans
cette synthèse d’aborder « la demande sociale pour un dispositif
d’assainissement amélioré[2]
», à travers différentes approches adoptées par quelques équipes du
programme : les représentations populaires de la propreté et de l’hygiène,
la gêne occasionnée par l’absence de dispositifs d’assainissement, le
niveau de satisfaction des ménages vis-à-vis des équipements existants et
leur consentement à payer pour une amélioration de leur système
d’assainissement.
Basée sur les apports du
programme, à travers les travaux qualitatifs des anthropologues sur les déterminants
culturels de cette demande et les travaux quantitatifs (enquêtes-ménages) des
socio-économistes, cette synthèse ne propose pas un traitement exhaustif de la
question. Il s’agit plutôt de rendre compte de la complexité de cette
demande, de son caractère évolutif, de l’impact de certains facteurs et des
tendances généralisables.
La demande sociale est
entendue ici au sens de la demande des ménages pris individuellement, par
opposition à la demande institutionnelle, qui est celle des représentants de
l’Etat ou des collectivités locales. Cette seconde dimension ne sera pas
traitée.
Certains paragraphes sont
volontairement empruntés aux auteurs cités.
1.
Représentations populaires de la propreté et de l’hygiène
Comme l’explique l’équipe
du Lasdel-A03, la propreté est très valorisée dans les discours, soit en
termes de bienséance (valeur centrale attachée à l’apparence, à l’ordre
et à l’odeur des gens et des lieux), soit en termes de pureté (en
particulier en référence à l’Islam et aux ablutions rituelles), soit en
termes de santé (on retrouve là beaucoup de thèmes développés par les
services de santé et passés dans le langage courant).
Parmi ces différentes
valeurs qui renvoient aux croyances culturelles, scientifiques ou religieuses,
il semble que la honte vis-à-vis du voisinage soit un facteur important dans
les motivations et les stratégies d’équipement des ménages en
infrastructure d’assainissement autonome. L’enquête menée dans le cadre de
la recherche Shadyc- A04 a mis en évidence le fait que les gens étaient très
attentifs à ne montrer de leurs propres ordures que ce qui est « montrable ».
La logique sociale (la réputation d’honneur) ou morale (la honte) prime sur
la logique d’hygiène (la crainte de la pollution ou de la contamination).
Paradoxalement, il est
commun d’observer le déversement des eaux usées dans la rue devant les
parcelles et le remblai des creux dans les cours ou les rues par des déchets,
des caniveaux à ciel ouvert où l’on jette tout, etc. Les seuls endroits
propres de façon régulière sont généralement les mosquées où règne une
autodiscipline à base religieuse et, dans une moindre mesure, les écoles où
s’impose une discipline collective institutionnalisée (Lasdel-A03).
Deux réponses sont apportées
par les équipes du programme :
La
dispersion et la dilution sont les meilleurs moyens de faire disparaître les
eaux usées et les excreta
Quand il n’y a pas
d’eau et qu’on ne peut pas diluer, on essaye de disperser les eaux usées en
les jetant à la rue tout en espérant que les roues des véhicules et les
semelles des gens emporteront petit à petit les traces de la fange au loin.
C’est à la fois le moyen le plus ancien et le plus économique de se débarrasser
personnellement de l’ordure et en particulier de sa vue et de son odeur
(Shadyc-A04).
Une
perception différenciée de la propreté et de l’hygiène en fonction de la
nature de l’espace
• L’espace privé
de la cour d’habitation
« L’impression
dominante qu’on retire de l’ensemble des discours est que les citadins se
font une idée très étroite de leur cadre de vie. Le seul lieu qui leur
importe vraiment, c’est la cour d’habitation construite sur la parcelle possédée
» (Shadyc-A04).
Mais même dans cet espace
privilégié, les différentes activités qui se succèdent engendrent des
proximités paradoxales qui posent de sérieux problèmes d’hygiène.
A cela s’ajoute le fait
que l’environnement ne se prête pas au maintien de la propreté : sols non
cimentés, poussière et sable omniprésents, circulation des animaux, etc. : on
tolère de fait largement la saleté entre deux « coup de nettoyage ».
• L’importance de
l’« espace limitrophe », cet extérieur immédiat de la cour
Cet espace est occupé par
les activités de lavage (lessive, vaisselle), parfois de commerce (tablier) ou
de coupe du bois. Il est aussi le lieu de certaines activités des hommes,
telles que prendre le thé, jouer aux dames ou à l’awalé.
Les ménages
s’approprient ainsi cet espace limitrophe de la concession qui, entre le
domaine privé et le domaine public, illustre la richesse de la sociabilité
africaine de proximité (Shadyc-A04).
C’est aussi
traditionnellement le lieu du dépotoir d’ordures et parfois un lieu de défécation.
A l’origine, c’est ainsi qu’était marquée la limite entre le domaine
familial et l’extérieur, mais aussi la limite entre le monde des hommes et le
monde invisible. En milieu Mossi, le dépotoir d’ordures domestique tampuure
est également un symbole de richesse et de puissance. Le paradoxe n’est
qu’apparent : ce dépotoir sert à la fumure des champs de case dont il marque
en même temps la limite.
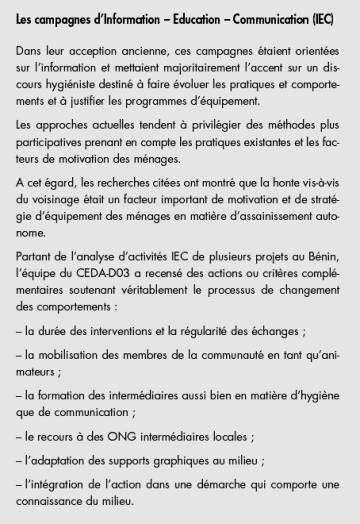 • La
souillure systématique de l’espace public, exacerbée en ville
• La
souillure systématique de l’espace public, exacerbée en ville
Face à l’accumulation
de flaques nauséabondes des eaux usées ménagères, de douche comme de
lessive, de toilette ou de cuisine, sur la chaussée ou dans les caniveaux mal
drainés, force est de constater l’indifférence relative des citadins.
Plusieurs interprétations sont proposées.
Cette indifférence
traduit la dégradation du rapport entre les hommes mais surtout du rapport
entre les citoyens et les élus. Cette thèse va même jusqu’à évoquer une
« souillure volontaire » de l’espace public.
On peut aussi la
comprendre comme une relation à l’espace public marquée par une conception
rurale de la propreté. Les endroits vacants au sein des villes sont traités
dans les faits comme des dépotoirs « naturels », c’est-à-dire comme
s’ils représentaient en ville ce que reste encore « la brousse » pour les
villages, le lieu « naturel » d’évacuation (Lasdel-A03).
Enfin, elle traduit la
conception d’une cité sans espaces publics partagés. La plupart des études
sur la propreté urbaine confirment a contrario que les attitudes
positives des citadins sont liées à un sentiment d’attachement à « leur »
ville, souvent associé à la conscience d’un intérêt collectif vis-à-vis
du territoire urbain.
2.
La gêne occasionnée par le non-assainissement
« On ne peut pas
marcher la nuit dans le quartier : on risque d’être noyé dans les eaux usées
et dans les eaux de WC.»[3]
Interrogés sur la gêne
occasionnée par les eaux usées, les excreta et la stagnation des eaux
pluviales, les ménages de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et de Moshi (Tanzanie),
semblent se préoccuper davantage de l’assainissement défectueux de leur
quartier que de celui de leur parcelle (Cereve-A05a).
Alors que
l’assainissement défectueux des quartiers est ressenti comme le principal
facteur de gêne, plus des deux tiers des enquêtés ne font état d’aucun
problème majeur au niveau de leur parcelle. Seuls 17 % y évoquent une gêne
due aux eaux usées et aux excreta et 10 % mentionnent comme problème la
stagnation des eaux pluviales.
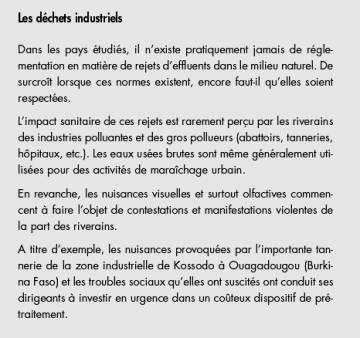 Paradoxalement,
personne ne s’occupe de la salubrité des espaces publics. Les eaux usées ménagères
de douche, de lessive, de toilette ou de cuisine sont évacuées d’une façon
ou d’une autre de la parcelle et s’accumulent en flaques nauséabondes sur
la chaussée. Pourtant, alors que tous souffrent des pratiques de chacun, ils en
attribuent la responsabilité aux lacunes du service public plutôt qu’aux
comportement des voisins (Cereve-A05a).
Paradoxalement,
personne ne s’occupe de la salubrité des espaces publics. Les eaux usées ménagères
de douche, de lessive, de toilette ou de cuisine sont évacuées d’une façon
ou d’une autre de la parcelle et s’accumulent en flaques nauséabondes sur
la chaussée. Pourtant, alors que tous souffrent des pratiques de chacun, ils en
attribuent la responsabilité aux lacunes du service public plutôt qu’aux
comportement des voisins (Cereve-A05a).
Les déchets plastiques
(sachets usagés et plus encore débris de sachets) ont un statut particulier
selon les interlocuteurs. Parfois considérés comme la principale nuisance
sanitaire (les plastiques sont considérés comme des réceptacles de saletés)
et productive (ils empêchent l’infiltration de l’eau dans les champs ; les
animaux qui les ingèrent meurent), ils ont pour d’autres le statut du déchet
« moderne », déchet propre par opposition aux ordures domestiques, organiques
et odorantes (Lasdel-A03).
« L’accumulation des
eaux de vaisselle est source de conflit entre voisins.»[4]
C’est surtout dans les
parcelles multi-familiales des anciens quartiers denses que se pose le problème
du rejet des eaux usées. Il est parfois tellement aigu que les habitants
doivent restreindre les quantités d’eau utilisées ou accomplir de nombreuses
activités à l’extérieur de la cour : lessive, vaisselle, toilette des
enfants et quelquefois des adultes. La saturation du bâti permet difficilement
de déverser ces eaux dans la cour et les puisards d’eaux usées ou la fosse
des WC débordent vite si les femmes se permettent d’y déverser les eaux usées
de la lessive ou de la vaisselle. Il arrive alors que le responsable de la
concession interdise l’utilisation de la douche tant que la vidange n’a pas
été faite.
Les enquêtes menées dans
le cadre de l’action de recherche Cereve-A05a ont montré qu’il existe des
degrés de gêne différenciés en fonction de la densité d’occupation de la
parcelle. En deçà d’un premier seuil de densité, de l’ordre de 30
personnes par parcelle, soit environ 400 à 450 habitants à l’hectare, les
nuisances demeurent supportables à l’échelle du quartier car la densité du
bâti reste suffisamment faible pour que les eaux usées soient rejetées en
partie dans l’espace des cours d’habitation sans y causer de gêne. Lorsque
la densité est plus élevée mais demeure inférieure à un second seuil (plus
de 50 personnes par parcelle, soit 600 à 750 personnes à l’hectare), les
habitants ne peuvent plus faire autrement que de rejeter leurs eaux usées sur
les espaces publics : la gêne devient importante au niveau du quartier. Enfin,
au-delà de ce second seuil, la densité est si forte que la gêne devient inévitable
même à l’intérieur des parcelles.
4.
Satisfaction des ménages vis-à-vis des systèmes existants
« Il existe un seul WC
pour les 15 ménages qui habitent la concession : quand il est rempli et qu’il
n’y a pas les moyens de faire appel aux services de vidange, le WC est fermé
jusqu’à ce que les boues se tassent ; pendant ce temps chacun se débrouille
comme il peut.»[5]
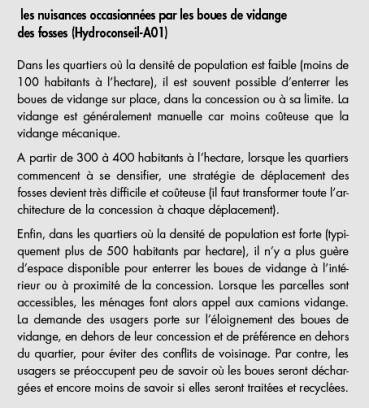 Les
caractéristiques des dispositifs sont très différentes d’une ville à
l’autre. Suivant le type et les caractéristiques du WC utilisé, le taux de
satisfaction varie considérablement (de 30 % à 84 % entre Port Bouet,
Bobo-Dioulasso et Conakry). A Conakry, les WC reliés à l’égout entraînent
une insatisfaction élevée, expliquée par la forte proportion de canalisations
d’assainissement obstruées et hors d’état de fonctionnement dans les
quartiers qui en sont équipés. La même enquête (Cereve-A05a) met en évidence
que les principaux motifs de plainte résident partout dans les odeurs dégagées
par les fosses, le pullulement des mouches et la prolifération des cafards. Il
faut aussi noter les problèmes liés au manque d’eau pour l’entretien des
latrines.
Les
caractéristiques des dispositifs sont très différentes d’une ville à
l’autre. Suivant le type et les caractéristiques du WC utilisé, le taux de
satisfaction varie considérablement (de 30 % à 84 % entre Port Bouet,
Bobo-Dioulasso et Conakry). A Conakry, les WC reliés à l’égout entraînent
une insatisfaction élevée, expliquée par la forte proportion de canalisations
d’assainissement obstruées et hors d’état de fonctionnement dans les
quartiers qui en sont équipés. La même enquête (Cereve-A05a) met en évidence
que les principaux motifs de plainte résident partout dans les odeurs dégagées
par les fosses, le pullulement des mouches et la prolifération des cafards. Il
faut aussi noter les problèmes liés au manque d’eau pour l’entretien des
latrines.
Il semble que les latrines
publiques à la périphérie du quartier soient parfois sous-utilisées en
raison de leur coût élevé, qui les rend inaccessibles pour une utilisation
courante (Hydroconseil-A01).
Par ailleurs, les terrains
vagues, les abords des koris (cours d’eau temporaires) ou du fleuve,
les parcelles inoccupées ou les champs à la limite de la ville restent encore
pour nombre de personnes des alternatives préférables à l’usage de latrines
(Lasdel-A03), ce qui démontre l’importance de la défécation en plein air
comme pratique populaire.
5.
Un consentement à payer général mais relativement faible
Comme le montre l’enquête
conduite dans le cadre de l’action Cereve-A05a, la plupart des ménages
acceptent le principe d’investir dans l’amélioration de leur système
d’assainissement. A Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), plus de 70 % des ménages
acceptent de payer pour obtenir toutes les améliorations proposées, y compris
pour bénéficier d’un système d’assainissement hors site (type réseau).
Par ailleurs, deux tiers
des ménages locataires accepteraient une augmentation de loyer correspondant à
l’une des améliorations proposées si elle était financée par leur propriétaire.
Cette proportion ne varie pas en fonction de la nature de l’amélioration.
Les facteurs susceptibles
d’avoir une influence sur le consentement à payer ont été étudiés et ont
permis de mettre en évidence différentes catégories de ménages vis-à-vis de
la demande en dispositif amélioré, en fonction de l’âge, du niveau de
ressources et d’éducation, ainsi que du statut d’occupation de
l’habitation (propriétaire, locataire, hébergé gratuitement).
Cette même étude a
permis de montrer que l’effort financier que les ménages sont disposés à
consentir pour bénéficier d’un assainissement amélioré est remarquablement
homogène : le montant que les ménages sont prêts à payer correspond dans la
grande majorité des cas à moins de six mois d’épargne.
Ce résultat confirme
aussi les observations faites à l’occasion de la mise en œuvre du PSAO (Plan
Stratégique d’Assainissement de Ouagadougou), à savoir que les ménages
s’engagent effectivement dans le chantier d’amélioration de leur
assainissement après une phase préalable d’épargne de six mois environ.
Les travaux des
anthropologues ont montré la variabilité des perceptions de l’hygiène et de
la propreté selon les croyances culturelles, religieuses et scientifiques.
Le visible, l’apparence
(les odeurs, etc.) semblent être les valeurs dominantes qui occasionnent la gêne
et l’insatisfaction et motivent les changements. La densité de population détermine
aussi largement le niveau d’insatisfaction des ménages.
La souillure de l’espace
public par toutes sortes de déchets liquides et solides est un constat quasi général.
La stratégie la plus courante consiste ainsi à se débarrasser des déchets,
de la maison vers la cour, de la cour vers la rue, et du centre-ville vers la périphérie.
Il existe véritablement une perception différenciée de l’hygiène et de la
propreté en fonction du statut de l’espace. S’agissant de la propreté de
l’espace urbain, elle présuppose l’existence d’une conception partagée
de ce qui relève du domaine public et du domaine privé, du service public et
de l’espace public (Shadyc-A04), conception qui semble faire cruellement défaut.
Sur le plan méthodologique,
les études citées devraient contribuer à l’évolution :
– des activités d’Information
Education Communication (IEC) basées sur la connaissance du milieu, la prise en
compte des pratiques existantes et les facteurs motivant les changements de
comportement ;
– des études de
consentement à payer par une meilleure connaissance des facteurs susceptibles
d’avoir une influence sur ce consentement à payer ;
– des offres techniques
et gestionnaires (types d’équipements, modalités d’entretien et de gestion
associées) grâce à une meilleure compréhension des critères de choix des ménages
et de leur rapport à l’espace public.
Études
citées dans cette synthèse
Hydroconseil-A01. Les
entreprises de vidange mécanique des systèmes d’assainissement autonome dans
les grandes villes africaines (Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Bénin,
Tanzanie, Ouganda)
Lasdel-A03. La question
des déchets et de l’assainissement dans deux villes moyennes (Niger)
Shadyc-A04. Une
anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques
sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine (Burkina Faso)
Cereve-A05a. Gestion
domestique des eaux usées et des excreta : étude des pratiques et
comportements, des fonctions de demande, de leur mesure en situation contingente
et de leur opérationnalisation (Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger,
Tanzanie)
Ceda-D03. Recherche
d’espaces pour le dialogue, la prise de conscience et l’organisation en vue
de l’action dans la commune urbaine (Bénin)
[1] Campagnes réalisées en accompagnant des projets d’équipement.
[2] Il s’agira ici essentiellement de la collecte et de l’évacuation des excreta et des eaux usées ménagères sur place, et dans une moindre mesure la collecte et l’évacuation des déchets solides.
[3]
Propos recueilli par Morel à l’Huissier, quartier Carrière, Conakry
(Cereve-A05a)
[4]
Propos recueilli par Morel à l’Huissier (Cereve-A05a).
[5]
Propos recueilli par Morel à l’Huissier, Conakry quartier Dixin Mosquée
(Cereve-A05a).