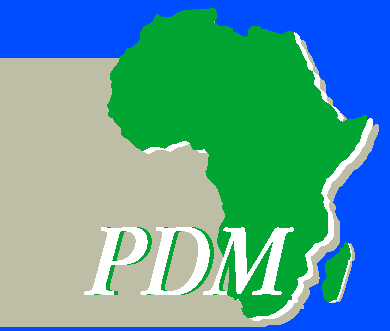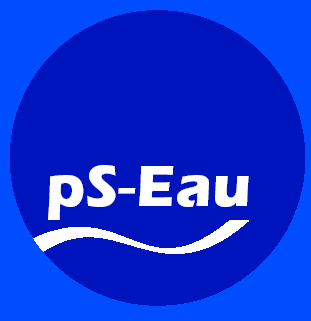Synthèse des acquis du programme
SYNTHÈSE ET ANALYSE DES ACTIONS RELATIVES AUX DÉCHETS
De
l’amont vers l’aval : l’émergence d’une filière de
gestion des déchets adaptée aux villes africaines
Synthèse
réalisée par Francis Chalot
Sommaire
1.
Des réalités urbaines et foncières qui s’imposent à la gestion des déchets
1.1.
Des contraintes urbaines fortes
1.2. Des dispositifs adaptés de pré-collecte par conséquent incontournables
1.3.
Accorder le temps nécessaire au changement
2.
Une méconnaissance encore tenace des gisements de déchets
2.1.
Approfondir, de manière rigoureuse et critique, la terminologie, les mesures et
leur analyse
2.2.
La présence importante de sable dans les déchets ménagers collectés : une
question majeure dans l’ensemble des agglomérations africaines.
2.3.
Les autres résidus urbains encore largement ignorés
2.4.
Pour une approche « rudologique » à l’africaine
3.
Consolider les dispositifs de pré-collecte
3.1.
La formalisation de démarches méthodologiques
3.2.
Aller vers une professionnalisation des petits opérateurs
3.3.
La planification spatiale des interventions
3.4.
La conception d’un matériel adapté aux spécificités locales
4.
La complémentarité entre maillons
4.1.
Éviter que les points de regroupement ne constituent un nœud de blocage
4.2.
Penser de manière simple, mais systémique, la conception et l’exploitation
des points de regroupement et de transfert
4.3.
Une approche raisonnée de l’implantation des points de regroupement et de
transfert
5.
Le traitement final
5.1.
Plus ou moins élaboré et organisé, l’enfouissement reste aujourd’hui la
solution largement prépondérante
5.2.
Pour une évolution pragmatique et progressive vers des décharges soutenables
6.
La coordination entre les acteurs : des rôles clarifiés et assumés
6.1.
Dépasser la simple phraséologie sur la « gestion partagée »
6.2.
Des autorités locales assumant leur rôle
6.3.
Coordonner l’intervention des différents prestataires privés
6.4.
Favoriser l’intervention de structures relais issues du terrain
7.
Construire progressivement le puzzle du financement
7.1.
Un financement différencié selon les maillons successifs
7.2.
Les limites d’une redevance payée par l’usager
7.3.
Ne pas attendre du recyclage une contribution au financement de l’élimination
8.
L’évacuation pure et simple comme mode hégémonique, voire exclusif, d’élimination
mérite d’être questionnée
Études
citées dans cette synthèse
De
tous temps et en tous lieux, la production de déchets est inhérente aux
activités humaines, qu’elles soient domestiques, agricoles, industrielles –
au sens large – ou commerciales. Mais, en Afrique comme partout, ce n’est
qu’avec le fait urbain qu’elle devient véritablement une problématique
publique.
N’oublions
pas que les pays du Nord ont aussi connu en leur temps (et sans doute encore
aujourd’hui, sous d’autres formes) des crises liées aux distorsions entre
l’état du développement urbain et l’aptitude à répondre correctement aux
nécessités sanitaires et environnementales ainsi qu’aux attentes de la société
en matière de déchets.
A
cet égard, les lourdes difficultés rencontrées aujourd’hui par les agglomérations
africaines dans ce domaine s’expliquent, au-delà de spécificités
climatiques, culturelles ou d’organisation politico-administrative, par le
rythme et le mode de développement démographique et urbanistique qu’elles
connaissent et qui sont liés aux handicaps économiques de ces pays et de la
plupart de leurs habitants.
Il s’agit ici d’une
approche délibérément « technicienne et gestionnaire » – amplement
questionnée par ailleurs, à juste titre – de la gestion des déchets dans
les contextes urbains qui ont fait l’objet du programme, et ceci à partir des
rapports et résultats produits. Selon une logique de « progressivité » du déploiement
de la filière d’élimination à partir des espaces de production des résidus
urbains, la collecte auprès des habitants/ producteurs eux-mêmes est apparue
au Comité scientifique comme l’élément primordial.
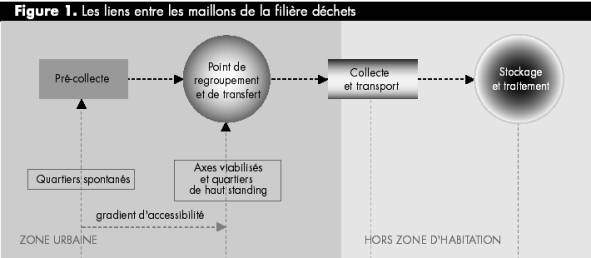
En
effet, cette « pré-collecte » se confirme comme l’enjeu essentiel et tout
à fait spécifique de ces grandes agglomérations africaines, et ceci de manière
croissante compte tenu de leur rythme et de leur mode de développement démographique
et urbanistique. Précisons d’emblée que l’examen de ce « maillon » est
indissociable de celui du « nœud » qui le relie au suivant (cf. Figure 1 page
précédente), c’est-à-dire des conditions de regroupement et de transfert à
une collecte et un transport plus classiques dans leur organisation et leurs
moyens.
1.
Des réalités urbaines et foncières qui s’imposent à la gestion des déchets
Dans
la mesure où l’on s’en tient à l’objectif opérationnel communément
admis du service public d’élimination des déchets (assurer un enlèvement
auprès de l’ensemble de la population, puis l’évacuation hors de
l’agglomération en vue du stockage et d’un traitement et/ou d’une
utilisation/valorisation), force est de constater que les grandes agglomérations
sub-sahariennes sont encore loin du compte (cf. Tableau 1).
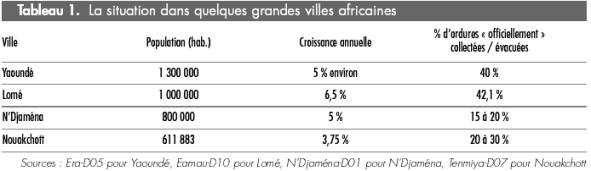
1.1.
Des contraintes urbaines fortes
Avant
même de rechercher des explications à cette situation en termes de manque de
moyens financiers, déficits d’organisation, carences des puissances
publiques, errements des dispositifs induits par les bailleurs de fonds ou
autres raisons, c’est sur les formes d’évolution de ces agglomérations
elles-mêmes qu’il faut porter l’analyse. Elles présentent une typologie
contrastée selon deux types de quartiers :
–
une ville planifiée, héritière notamment de la période coloniale, où se
situent un habitat de moyen et haut standing et les couches sociales
correspondantes ;
–
mais aussi, de plus en plus, une ville spontanée aux populations moins favorisées.
Encore
faut-il bien préciser que ces « deux villes » sont assez souvent imbriquées
l’une à l’autre, dans leurs différentes dimensions (sociales,
architecturales, etc.). Il ne faudrait pas simplement raisonner en termes de
centre et de périphérie. Globalement non maîtrisé, le développement de
cette dernière présente, sous la pression de la démographie tant interne que
migratoire, une série de caractéristiques étroitement interdépendantes :
1)
une urbanisation extensive. « La forte
croissance démographique de Yaoundé s’accompagne d’une augmentation de sa
superficie qui est passée de 1 200 ha en 1961 à 18 000 ha [x15]
en 2000 »
(Era-D05);
2)
une densité néanmoins élevée de la population dans les nouveaux quartiers
constitués : 3 à 6 fois plus importante que celle des quartiers « planifiés
» (cf. Tableau 2) ;
3)
des changements de la configuration urbaine qui connaissent un rythme accéléré
;
4)
une absence de viabilité des voiries (des voies étroites, accidentées, en
terre battue, a fortiori soumises
aux aléas climatiques, etc.).
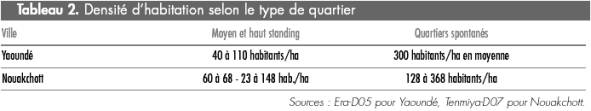
«
Yaoundé ne dispose que de 800 km de routes
toutes catégories confondues [soit] une densité de desserte de 4,4 km/km2
[...] inférieure à la moyenne de 15 à 20 km/km2 requise en matière
d’urbanisme. (...) Seuls 30 % sont bitumés et en plus ou moins bon état. Sur
les 800 km de voirie, 560 km sont ainsi en terre et impraticables à plus de 70
%. L’accès est impossible en véhicule pour 57 % des habitations des
quartiers Melen, (...) même les chemins piétons pouvant servir de voie d’évacuation
sont entrecoupés d’escaliers pour gravir des pentes raides, de caniveaux et
d’autres obstacles artificiels ou naturels (...). »
(Source : Era-D05)
La
description de ces contraintes à Yaoundé vaut tout autant pour les autres
villes de la région : Lomé, Nouakchott, N’Djaména ou Cotonou, etc.
L’absence
de prise en compte de la gestion des déchets dans la planification urbaine est
régulièrement dénoncée dans les rapports. Pour être exacte, la critique
ainsi formulée reste un peu vaine et incantatoire. C’est plus globalement
l’absence de planification urbaine tout court qui est en cause. Or, ce développement
spontané et extensif tel qu’il existe actuellement semble devoir être une
tendance lourde (IRD-D08), même si une restructuration des quartiers précaires
est dans certains cas annoncée, avec optimisme, par les autorités (dès 2010
à Nouakchott, selon Tenmiya-D07).
La
question est donc d’adapter davantage les solutions d’élimination des déchets
à la réalité urbaine d’aujourd’hui, quitte à en tirer des enseignements
interactifs, par exemple sur la place à réserver aux points de regroupement,
qui puissent progressivement orienter des aménagements partiels de la cité. «
Il faut adapter le service à chaque
situation de zone ou d’espace à collecter »
(Tenmiya-D07).
1.2.
Des dispositifs adaptés de pré-collecte par conséquent incontournables
Pour
le service public d’élimination des ordures ménagères, les conséquences
des contraintes énumérées cidessus sont en effet doubles :
1)
les quartiers « spontanés » restent globalement inaccessibles aux véhicules
classiques d’enlèvement des ordures ménagères (bennes) ;
2)
mais en même temps, les distances y sont trop importantes pour envisager un
apport volontaire des ordures par l’ensemble de leurs habitants jusqu’aux
axes viabilisés où il redevient possible d’assurer un tel enlèvement.
Dans
ces grandes agglomérations sub-sahariennes, les dispositifs de pré-collecte à
forte intensité de maind’œuvre, utilisant des moyens rustiques (charrettes,
etc.) et opérés par des micro-entreprises privées (au sens large), émanant
des quartiers spontanés eux-mêmes, semblent ainsi être les seuls en mesure de
combler le fossé entre lesdits quartiers et ce qui existe actuellement de trame
de voirie cohérente et en bon état, et donc d’assurer la généralisation du
service à cette partie de l’espace urbain. « Peut-on
continuer, dans le contexte des villes africaines, à parler de techniques
modernes et artisanales en termes d’alternatives ou faudrait-il plutôt parler
de complémentarité ? » (Era-D05).
En
effet, durant la précédente décennie, cette option de pré-collecte a fait
l’objet de maintes expérimentations dispersées et chaotiques dans la plupart
des villes d’Afrique sub-saharienne, selon des logiques de différenciation,
de concurrence et de rupture techniques (et non spatiales) avec d’autres
modalités plus « conventionnelles ». Un des acquis majeurs du programme, au
travers des actions Era-D05 (Yaoundé), Tenmiya-D07 (Nouakchott) et TechDev-D09
(Cotonou) en particulier, est de justifier aujourd’hui pleinement la place qui
revient à cette pré-collecte et de montrer comment elle est en passe d’y accéder
à une certaine maturité. Car la question qui se pose véritablement désormais
est celle de sa consolidation, à partir de l’expérience acquise et partagée
et notamment grâce à une articulation institutionnelle, financière et
technique au sein de l’ensemble du dispositif de gestion des résidus urbains.
1.3.
Accorder le temps nécessaire au changement
En
complément de la dimension spatiale, la dimension temporelle est aussi
fondamentale.
L’amont
de la gestion des déchets ménagers repose en effet sur une intense
mobilisation des acteurs du terrain ainsi que sur des évolutions essentielles
dans les pratiques domestiques quotidiennes et les comportements individuels et
collectifs. Accorder le temps nécessaire à ces évolutions apparaît donc
crucial. Il faut penser à la manière dont cette dimension a été prise en
compte dans les politiques publiques de gestion des déchets au Nord : délais
accordés par les Directives communautaires, échéance à dix ans de la loi
française de 1992, calendriers de développement et d’apprentissage des
nouvelles pratiques de collecte séparative, etc.
Or,
il est assez surprenant de constater que le manque flagrant de temps accordé
ici aux expériences passées et en cours pour faire leurs preuves est,
finalement, assez peu pointé comme un handicap essentiel.
Les
rétrospectives regorgent pourtant d’exemples édifiants à cet égard :
programmes souvent abandonnés au bout de 6 à 18 mois seulement, 2 à 4 ans
dans le meilleur des cas ; contrats public/privé sur des durées trop courtes
(4 ans, voire moins). Le nombre de solutions tentées à Yaoundé entre 1990 et
1998, recensées dans le rapport Era-D05, est à lui seul ahurissant ! A cet égard,
cette étude met en avant une condition essentielle et révélatrice de réussite
: la stabilité sur une durée suffisante de l’un des maillons du système « il
n’y aura plus d’interruption du service de collecte dans les dix prochaines
années ». Et dans ses conclusions, les
auteurs proposent même un échéancier à vingt ans pour intégrer «
une progression des performances du service » et parce que « cette échelle de
temps est appropriée pour permettre un changement des comportements ».

2.
Une méconnaissance encore tenace des gisements de déchets
2.1.
Approfondir, de manière rigoureuse et critique, la terminologie, les mesures et
leur analyse
«
L’absence de données fiables sur la
production des déchets dans la plupart des villes du pays constitue encore
l’un des blocages majeurs pour les ministères techniques »
(Era-D05).
La
lecture des rapports montre pourtant une volonté générale de s’appuyer sur
des données chiffrées relatives à la production et à la composition des déchets
ménagers, issues essentiellement de la bibliographie disponible dans ce
domaine. Les principaux éléments clés pour fonder, à ce stade, des démarches
opérationnelles valides, semblent ressortir des données recueillies : un ordre
de grandeur du poids d’ordures à évacuer par habitant, selon les grandes catégories
de quartiers, globalement corroboré sur l’ensemble de la zone ; des
indicateurs de densité et de teneur en eau ; la mise en évidence des fractions
prépondérantes, comme le sable (cf. § suivant) ou les fermentescibles.
Ce
souci ainsi que l’apparente précision « scientifique » de certains des
tableaux produits dans les rapports ne masquent pas pour autant un déficit
encore profond de connaissance des gisements de déchets, au plein sens du
terme.
Le
statut et la nature exacte de ce que recouvrent les données avancées, le stade
auquel l’analyse a été réalisée et dans quelles conditions, parfois même
l’unité de référence sont autant d’éléments qui, en regard de la nécessité
et de l’ambition de disposer d’un socle sérieux dans ce domaine, restent
encore d’une précision inégale selon les travaux, voire au sein de ceux
d’une même équipe. Le poids des déchets par exemple : se réfère-t-il à
des ordures brutes humides ou à des analyses en matière sèche ? Quant à leur
nature, parle-t-on des déchets tels qu’ils sortent de l’espace domestique
ou d’une analyse après collecte où ils incluent ceux d’autres producteurs
(marchés, etc.) ? Les pourcentages de répartition indiquent-ils des fractions
en poids ou en volume ? L’imprécision se trouve aussi dans la terminologie
employée, où l’on dénote souvent l’influence des tendances rudologiques
du Nord. Quel sens y a-t-il à croiser ici le terme « déchets verts », si
essentiellement lié à un contexte d’entretien intensif d’espaces verts
d’agrément, en climat tempéré, avec exportation systématique des résidus
(tontes de pelouses, etc.)?
La
connaissance – la reconnaissance même – des flux masqués, détournés,
souffre d’autant plus de ce flou. Les matériaux écrémés à la source par
la récupération familiale et informelle apparaissent ainsi cruellement absents
de tous les tableaux présentés, même si cette absence est généralement
mentionnée à titre de commentaire accessoire.
L’interprétation
de ces données par les acteurs concernés n’est donc pas facilitée, sans
compter les risques, avec un matériau aussi faible (données incomplètes, peu
fiables ou mal référencées), de déperdition et/ou de déformation de
l’information dans le temps et dans l’espace.
A
cet égard, le constat dressé par Eamau-D10 à Lomé est significatif : « La
Mairie de Lomé ne dispose pas de données qualitatives et quantitatives sur le
volume des ordures ménagères, [ni] par conséquent de base de calcul pour la
maîtrise du coût d’enlèvement et de gestion des dépotoirs intermédiaires
[…]. Les chiffres avancés pour le poids volumique des O.M. (ordures ménagères)
et la quantité d’O.M. produites par jour en kg/hab. sont en réalité des
moyennes sous-régionales. Les données réelles concernant le Togo ne sont pas
connues ».
La
démarche de mesure, très pragmatique, entreprise dans cette recherche pour remédier
à un tel constat apparaît tout à fait méritoire et productive, faisant
apparaître in fine une
surestimation « d’au moins 170 % » des productions d’ordures prises en
compte dans les dispositions contractuelles...
D’autres
exemples méritent d’être relevés. Ainsi, le taux atypique de plastiques
(comparé aux autres villes africaines, mais aussi aux ordures des pays du Nord)
dans la composition pondérale des déchets de Nouakchott, reprise dans le
Tableau 3 ci-dessous, ne suscite étrangement ni interrogation ni commentaire.
C’est aussi le cas de certaines différences tout à fait surprenantes, et
pour le moins contradictoires, qui ressortent de la comparaison des compositions
des ordures selon le profil socio-économique des quartiers (du « haut standing
» aux quartiers spontanés) et sur d’autres sites.
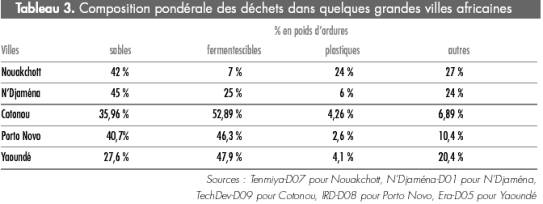
L’un
des rapports (TechDev-D09) avance pour le cas de Cotonou un supposé « doublement
de la production de déchets par habitant entre 1980 et 1996 »
– par référence à un rapport du bureau d’études Dessau – et le juge «
plausible en considérant l’évolution
des habitudes de consommation de la population ».
A l’appui est présenté un tableau de la composition de ces déchets, qui
montre une prépondérance écrasante du sable (36 %) et des matières
organiques (53 %). Or, on peut légitimement s’interroger sur l’impact
effectif de l’évolution des modes de consommation sur ces fractions-là, qui
représentent à elles deux 89 % des ordures, et par conséquent sur la réalité
de ce doublement.
La
manière dont est survolée la question des déchets spéciaux à Yaoundé
(Era-D05) relève un peu du même registre. Objectif initialement retenu mais
sans justification forte, la piste d’une expérimentation de la collecte séparée
de ces déchets spéciaux est finalement abandonnée à bon escient, mais au
prix d’une pirouette explicative étonnante : « Les
déchets à caractère dangereux produits par les ménages sont très marginaux [c’est
sans doute vrai, mais le tableau figurant au-dessus de cette affirmation n’en
fait aucunement état] ; les activités
artisanales sont concentrées uniquement le long de la voie bitumée et les déchets
produits par ces artisans sont déversés directement dans les bacs. Il n’est
donc plus utile de mettre en œuvre des activités pour le tri des déchets
dangereux [sic] ».
Comme
le montre le Tableau 3, le sable est systématiquement la première ou la
seconde « fraction » des ordures en importance pondérale, en alternance avec
les fermentescibles (avec des variations selon la latitude de la ville concernée).
Cette présence de sable, essentiellement liée au balayage des espaces privés,
participe de manière essentielle à la charge pondérale des ordures et, en
conséquence, à la pénibilité de leur transport, a
fortiori lorsque celui-ci est réalisé en
pré-collecte par des femmes ou des enfants, comme c’est le plus souvent le
cas, ou avec un matériel à traction humaine.
Le
« tri à la source » du sable apparaît donc ici comme une véritable priorité
technique de la gestion des déchets, par rapport à celui d’hypothétiques
matériaux recyclables ou déchets dangereux évoqués ci-dessus. C’est sans
doute un axe majeur d’une réflexion sur la préservation ou le développement
de pratiques préventives d’évitement ou de valorisation in
situ des déchets, comme alternative ou
complément à la logique d’évacuation (cf. § 8. L’évacuation
pure et simple comme mode hégémonique, voire exclusif, d’élimination mérite
d’être questionnée).
Des
innovations assez « rustiques » ont fait, dans le cadre du programme,
l’objet d’expérimentations permettant d’éviter le transport inutile du
sable, selon deux grandes options :
1)
des pratiques de balayage ou des outils de ramassage (pelle ajourée) évitant
de ramasser trop de sable ;
2)
l’adaptation des poubelles (transformation du fond en tamis grâce à des
orifices) afin que le sable s’écoule.
Dans
les deux cas, les résultats obtenus semblent significatifs sans toutefois résoudre
totalement le problème (27 à 30 % du sable évité à Lomé selon le rapport
Eamau-D10 ; 30 à 35 % à Cotonou selon TechDev-D09). La simple combinaison, à
chaque fois que c’est possible, des deux types d’action serait peut-être un
facteur simple d’amélioration, à l’instar de ce que semble finalement
envisager le PGDSM (Projet de gestion des déchets solides ménagers) à
Cotonou. Mais elle n’est quasiment pas évoquée dans les rapports.
2.3.
Les autres résidus urbains encore largement ignorés
Les
travaux du programme ne mentionnent presque jamais non plus l’existence et le
sort d’éventuels « déchets volumineux » des ménages (pour éviter les
termes de « monstres » ou « d’encombrants », usuels dans les pays du Nord,
mais trop connotés), sauf au détour de l’expérience de Nouakchott
(Tenmiya-D07) où ils émergent comme une carence et un facteur
d’insatisfaction de certains habitants à l’encontre du service assuré par
les petits opérateurs de pré-collecte.
Plus
encore, les déchets banals des entreprises (et des administrations !) sont
relativement peu évoqués dans les investigations engagées. Seules, peut-être,
l’étude Era-D05 s’avance à formuler courageusement une quantité de déchets
d’entreprises ramenée à l’habitant de Yaoundé, tandis que celles de
N’Djaména-D01 et de Burgeap-D06 (Sénégal) soulignent le rôle, potentiel ou
déjà acquis de fait, du gisement des DIB (déchets industriels banaux) dans
l’approvisionnement des filières de recyclage.
La
question des marchés apparaît, elle, plusieurs fois, mais les rapports
n’analysent pratiquement pas les interférences ou synergies éventuelles
entre la gestion de ces déchets des marchés et celle des déchets domestiques.
L’analyse très fine menée par Tenmiya-D07 montre pourtant la place centrale
jouée par ces marchés dans la pluri-activité des charretiers de Nouakchott,
qui utilisent leur instrument de travail tant pour la collecte des ordures que
le transport de personnes vers ces lieux très fréquentés.
Cela
n’a en soi rien d’étonnant si l’on observe que même dans certains pays
du Nord, et en tout cas en France, persiste aussi cette difficulté à prendre
en compte l’ensemble des résidus urbains au sein d’une gestion territoriale
intégrée.
Les
autorités locales, opérateurs et équipes de recherche qui continueront à les
accompagner sur le terrain gagneraient donc à s’intéresser désormais de
manière plus systématique et approfondie aux synergies possibles entre déchets
strictement ménagers et déchets industriels et commerciaux, tant pour
l’optimisation des matériels ou des circuits que pour l’émergence de véritables
filières de valorisation ou le financement des services.
2.4.
Pour une approche « rudologique » à l’africaine
D’une
façon générale, n’est-il pas temps qu’émerge une véritable rudologie
africaine adaptée aux spécificités et aux enjeux propres à ce continent,
s’appuyant sur davantage de rigueur et d’approfondissement, de recul et de
sens critique ?
Pour
ce faire, l’important travail socio-anthropologique déjà disponible sur les
perceptions et les attitudes locales face au déchet pourrait être plus étroitement
combiné, dans une perspective opérationnelle, à des approches métrologiques
(caractérisations des déchets plus systématiques, aux deux sens du terme) ou
géographiques, tant l’utilisation des outils cartographiques apparaît encore
limitée dans les travaux actuels.
3.
Consolider les dispositifs de pré-collecte
Etant
admis le caractère incontournable du maillon de pré-collecte dans une logique
de généralisation du service d’évacuation, la question des conditions de pérennisation
des dispositifs qui l’assurent reste ouverte, compte tenu de la précarité
des structures opératrices et au vu des aléas et des échecs observés antérieurement.
3.1.
La formalisation de démarches méthodologiques
Trois
recherches du programme en particulier (Era-D05, Tenmiya-D07 et TechDev-D09)
fournissent un matériel foisonnant et extrêmement profitable en termes
d’analyse des expériences antérieures et d’expérimentation de démarches
et d’outils innovants, éventuellement reproductibles, pour répondre à la
question de la pérennisation des dispositifs de pré-collecte. Selon des
approches diversifiées mais complémentaires, elles se sont en effet chacune
appliquées à développer un appui organisationnel et méthodologique à ces
structures. L’étude détaillée de leurs activités constitue l’un des
principaux produits des travaux en question.
L’action
conduite à Yaoundé (Era-D05) a abouti à l’élaboration d’une grille
d’analyse des opérations de précollecte. Sans doute perfectible, car elle a
un côté strictement « gestionnaire », détaché du contexte sociologique et
urbanistique, elle offre néanmoins une base pour une approche comparative
formalisée entre des expériences dont la mémoire et la présentation
restaient, jusqu’à présent, extrêmement diffuses et hétérogènes.
 Le
travail mené sur le quartier de Basra à Nouakchott (Tenmiya-D07) constate la
pluri-activité de fait – indispensable sur le plan économique – des petits
opérateurs : transport de biens, de personnes, etc. Ce constat est corroboré
par TechDev-D09 à Cotonou avec un autre profil de complémentarité, plutôt axé
sur l’assainissement et la propreté. Evaluant la rentabilité interne de
chacune des activités (chiffre d’affaires par rapport au temps consacré,
phases inactives et autres facteurs d’inefficacité), la recherche Tenmiya-D07
met en évi- dence les déséquilibres structurels actuels dus à une pratique
d’opportunisme « nomade » vis-à-vis de la clientèle potentielle, qui se
traduit notamment par des parcours techniques non optimisés (distances
parcourues trop élevées, répartition de l’occupation du temps non
rationnelle, etc.)
Le
travail mené sur le quartier de Basra à Nouakchott (Tenmiya-D07) constate la
pluri-activité de fait – indispensable sur le plan économique – des petits
opérateurs : transport de biens, de personnes, etc. Ce constat est corroboré
par TechDev-D09 à Cotonou avec un autre profil de complémentarité, plutôt axé
sur l’assainissement et la propreté. Evaluant la rentabilité interne de
chacune des activités (chiffre d’affaires par rapport au temps consacré,
phases inactives et autres facteurs d’inefficacité), la recherche Tenmiya-D07
met en évi- dence les déséquilibres structurels actuels dus à une pratique
d’opportunisme « nomade » vis-à-vis de la clientèle potentielle, qui se
traduit notamment par des parcours techniques non optimisés (distances
parcourues trop élevées, répartition de l’occupation du temps non
rationnelle, etc.)
Une
approche comparable dans ces différentes recherches contribue utilement à
faire émerger un faisceau de paramètres et de ratios d’efficacité : seuils
de rentabilité (en nombre d’abonnements par rapport au montant de
l’abonnement à Cotonou, en nombre de charrettes en service à Nouakchott) ;
rayon d’action optimal pour la pré-collecte ; critères d’amélioration des
circuits ; etc. Ces éléments pourraient être mis à profit pour une « modélisation
de la pré-collecte dans des contextes similaires »
(Tenmiya-D07).
3.2.
Aller vers une professionnalisation des petits opérateurs
Les
démarches méthodologiques évoquées précédemment fournissent les bases,
ainsi qu’un certain nombre d’outils pratiques, favorables à une
professionnalisation des petits opérateurs de pré-collecte, dont la nécessité
ressort clairement de ces diverses expérimentations (voir aussi Eamau-D10, à
Lomé, en complément des trois actions déjà citées). Dans cet esprit,
l’action TechDev-D09 a d’ailleurs développé concrètement, auprès des
quelques opérateurs sélectionnés à Cotonou, un accompagnement soutenu en
matière de management portant sur le triptyque suivant :
–
organisation et gestion du personnel ;
–
système comptable et financier simplifié (élaboration d’un compte
d’exploitation, etc.) ;
–
sécurité des charretiers.
Cette
évolution des petits opérateurs vers un profil plus entrepreneurial suscite
parfois, a contrario,
une inquiétude quant à la perte de leur rôle « communautaire » – elle
transparaît notamment dans cette même action TechDev-D09. Une clarification
semble utile à ce sujet.
Les
besoins de sensibilisation des habitants à la propreté et d’opérations
exemplaires non marchandes – comme les nettoyages de dépôts sauvages que
l’on retrouve dans pratiquement tous les programmes – sont indéniables.
Leur réalisation, surtout quand elle implique des opérateurs de pré-collecte,
favorise sans aucun doute l’adhésion des habitants/usagers au service
qu’ils proposent. Mais il ne paraît ni sain, ni viable, tant en termes de
moyens techniques que de charges financières, que les entreprises de pré-collecte
en restent les principaux, voire les seuls, maîtres d’œuvre à l’interface
avec la population du quartier. Nous y reviendrons plus loin, mais voilà
typiquement un domaine dans lequel d’autres acteurs, notamment la collectivité
locale, se doivent d’assumer pleinement leurs responsabilités ou de développer
une fonction qui leur sied davantage qu’aux entreprises elles-mêmes. C’est
le cas des diverses « structures relais » représentant les habitants/usagers
du quartier que l’on retrouve dans presque toutes les expériences, ou des
esquisses d’organisation professionnelle que l’on voit aussi émerger sous
forme de coordination des opérateurs, par exemple la Cogeda (Coordination des
ONG de gestion des déchets solides ménagers et de l’assainissement de la
ville) à Cotonou (TechDev-D09).
Quant
aux petites structures de pré-collecte, la question immédiate n’est peut-être
pas tant de disserter sur le statut formel qui leur conviendrait. Elles se sont
emparées de fait des formules, plus ou moins claires et adaptées, que leur
offrait le paysage institutionnel et juridique tel qu’il est. Il s’agit plutôt
d’affirmer clairement le contenu et le périmètre de leur activité de
prestataire, quitte à déterminer tout aussi précisément les registres dans
lesquels leur spécificité sociale et communautaire mériterait se manifester
(recrutement des agents, politique tarifaire, etc. ainsi qu’une participation,
parmi d’autres, aux actions de sensibilisation et d’éducation).
3.3.
La planification spatiale des interventions
La
définition et l’attribution rationnelles de secteurs d’intervention pour
les différentes entreprises de pré-collecte, ainsi que l’optimisation des
circuits à l’intérieur de ces secteurs, constituent une seconde condition
primordiale pour contrecarrer la précarité de ces petits opérateurs émergents.
Indispensable pour en finir avec le caractère erratique de leurs parcours et la
concurrence sauvage qui règne parfois entre eux, cette stratégie générale de
zonage est commune aux trois expériences citées (Yaoundé Era-D05, Cotonou
TechDev-D09 et Nouakchott Tenmiya-D07), qui laissent entrevoir une maturité
possible de cette option. Ainsi, à Nouakchott, « Les 4 charretiers se sont répartis
entre les 4 secteurs. Leur temps consacré à la collecte est entre 8 heures du
matin et 14 heures l’après-midi ; soit une augmentation de 400 % par rapport
au rythme d’avant-projet où le temps consacré par charretier à la collecte
des déchets ne dépassait pas une heure et demie par journée de collecte » :
cela a donc nettement amélioré la rentabilité de leur activité.
Allant
au-delà de la simple utilisation des ratios d’efficacité déjà évoqués
(en distances à parcourir et en nombre d’abonnés desservis), la recherche
Era-D05 présente une méthodologie particulièrement intéressante testée à
Yaoundé. Elle repose sur l’utilisation d’une série d’outils
cartographiques d’échelles décroissantes et permet :
•
d’abord l’identification des « poches
de pré-collecte organisée potentielle »
à l’intérieur de la trame urbaine (qui servira également à ajuster la
complémentarité avec le maillon aval de la collecte dite conventionnelle) ;
•
puis l’organisation détaillée des circuits de pré-collecte à l’intérieur
de ces poches, en intégrant précisément les contraintes d’accessibilité
pour définir l’enchaînement des modes de pré-collecte eux-mêmes (transport
manuel ou par brouette, puis par charrette « porte-tout »).
Ce
travail, qui fait notamment écho à l’appel à une approche rudologique
formulé plus haut, constitue indéniablement un des apports méthodologiques
les plus riches concernant la gestion des résidus urbains dans ce programme,
dont l’ensemble des équipes pourrait utilement tirer profit.
3.4.
La conception d’un matériel adapté aux spécificités locales
Comme
le souligne à juste titre Tenmiya-D07, « la
dotation en équipements adéquats pour la collecte primaire, seule, ne peut
favoriser l’essor des petits opérateurs ».
Toutefois,
plusieurs travaux du programme (N’Djaména-D01, Tenmiya-D07, TechDev-D09,
Lasdel-A03, etc.) montrent combien, à défaut d’être suffisante, l’amélioration
des « charrettes » est non seulement nécessaire mais surtout désormais
possible en capitalisant, avec un réel souci d’analyse et
d’approfondissement, les expériences acquises sur ce point technique.
 Augmenter
l’efficacité des tournées de pré-collecte, celle du transport puis du
transfert aux points de regroupement, réduire la pénibilité pour les
charretiers, rehausser l’image de leur activité – à leurs yeux comme à
ceux des usagers – sont autant d’objectifs à traduire de manière plus systématique
en paramètres simples (rapports poids/volume, hauteurs, modes de remplissage et
de vidange, etc.) afin de dépasser la simple improvisation, d’éviter de répéter
les mêmes erreurs ou de réinventer les mêmes demi-solutions.
Augmenter
l’efficacité des tournées de pré-collecte, celle du transport puis du
transfert aux points de regroupement, réduire la pénibilité pour les
charretiers, rehausser l’image de leur activité – à leurs yeux comme à
ceux des usagers – sont autant d’objectifs à traduire de manière plus systématique
en paramètres simples (rapports poids/volume, hauteurs, modes de remplissage et
de vidange, etc.) afin de dépasser la simple improvisation, d’éviter de répéter
les mêmes erreurs ou de réinventer les mêmes demi-solutions.
On
a le sentiment qu’en consolidant les travaux déjà menés par divers
partenaires (le réseau Crepa particulièrement) et les données
bibliographiques rassemblées et commentées par les recherches du présent
programme (notamment Tenmiya-D07), et en formalisant les démarches d’amélioration
expérimentées par certaines équipes (Eamau- D10), il serait aujourd’hui
possible de concevoir et de mettre à disposition des acteurs concernés un
catalogue actualisé des matériels déjà utilisés dans les différents pays
de la zone. Assorti d’une analyse critique de leurs caractéristiques et de
leurs évolutions ainsi que des éléments méthodologiques (critères
d’analyse, logique et déroulement dans le temps de la démarche, etc.), il
leur permettrait de poursuivre utilement pour leur compte le processus
d’innovation.
En
effet, s’il s’agit de ne pas oblitérer la nécessaire adaptation aux spécificités
de chaque contexte géo-climatique et urbain, le processus de participation des
acteurs eux-mêmes à cette innovation doit aussi rester, pour une bonne
appropriation de l’équipement, un élément central de la démarche.
Plus
en amont, la question des récipients de présentation des déchets ménagers à
la pré-collecte apparaît dans les expériences du programme, mais de manière
plus diffuse et sans qu’il paraisse possible d’en tirer véritablement, à
ce stade, des conclusions synthétiques, pertinentes et valorisables. Au-delà
du constat d’évidence poubelienne d’un « déficit
sur le conditionnement initial »
(Tenmiya-D07), cette question ne reste-t-elle pas pour l’instant secondaire et
non décisive dans l’installation de la pré-collecte ?
On
note, ici et là, des expériences de dotation ou des tentatives de
commercialisation de poubelles « normalisées » (y compris sélectives, dénotant
plus d’un mimétisme intempestif avec les modes observées au Nord…), le
recours de bon sens à des options de réutilisation (demi-fûts) ou de
recyclage des métaux par l’artisanat local, ou la recherche de certaines améliorations
comme les récipients à fond percé pour l’évitement du sable. Dans son
rapport final, la recherche TechDev-D09 finit même par faire état d’un « engouement
des ménages [de Cotonou] […],
le prix auquel l’action pilote a fait fabriquer les poubelles [étant]
jugé tout à fait compétitif ».
A
l’intersection avec la sphère domestique de la gestion des ordures, peut-on
imaginer des progrès obtenus peu à peu par la sensibilisation, la mobilisation
sociale et des approches contractuelles entre usagers et opérateurs, ou cette
question de la poubelle ne sera-t-elle résolue que par une intervention
prescriptive forte de l’autorité municipale, à l’image de ce qui s’est
passé au Nord depuis un peu plus d’un siècle ?
4.
La complémentarité entre maillons
La
focalisation sur la mise en œuvre d’une pré-collecte adaptée aux difficultés
d’accès des quartiers spontanés n’a de sens que si cette pré-collecte
dispose ensuite d’un exutoire accessible et fiable dans le temps.
A
cet égard, la logique qui sous-tend les schémas de principe de l’élimination
des déchets dans toutes les villes du programme est à peu près la même (cf.
Figure 1 page 45). Elle postule que la collecte mécanisée conventionnelle qui
ne peut pénétrer dans ces quartiers redevient théoriquement opérante à
partir des axes de circulation viabilisés et dans la partie planifiée de
l’agglomération. De fait, c’est sur cet espace que subsistent
aujourd’hui, avec plus ou moins de bonheur, les derniers avatars des
tentatives successives d’organisation d’un service d’élimination pour
l’ensemble de cette agglomération.
A
Nouakchott par exemple (Tenmiya-D07), « l’inexistence
ou l’éloignement des dépôts de transit oblige les petits opérateurs à
vider le long de leurs circuits. Quand ils existent [...]
la mauvaise gestion des sites de transit
(retard, enlèvement partiel, etc.) engendre bien souvent des nuisances et des
plaintes des riverains ». En regard de
ces réalités, la stratégie de gestion des déchets solides (SGDS) énoncée
par la Communauté Urbaine, courant 2002, semble encore bien superficielle et
formelle, n’apportant guère de précision sur l’implantation des «
nouvelles infrastructures » envisagées en termes de dépôts de transit, leur
conception ou leur exploitation (hormis l’évocation d’un matériel de type
Ampliroll). Ceci laisse, du même coup, songeur quant à la pérennité de la pré-collecte,
malgré le travail d’analyse en profondeur et d’appui potentiel dont elle a
fait l’objet, et que nous avons salué plus haut. L’état des lieux n’est
guère différent à Cotonou au départ de l’action TechDev-D09.
4.1.
Éviter que les points de regroupement ne constituent un nœud de blocage
Il
est essentiel d’assurer une articulation efficiente entre le maillon de la pré-collecte
et celui de la collecte secondaire et du transport par :
–
la mise en œuvre de points de regroupement et de transfert convenablement : 1)
implantés, 2) conçus, 3) équipés et 4) exploités ;
–
l’assurance d’une évacuation régulière des déchets qui y sont regroupés.
Ce
dernier point apparaît sans conteste comme prépondérant et prioritaire pour
garantir un « déblocage » de l’ensemble du dispositif par l’aval : « les
dépotoirs intermédiaires resteront sommairement aménagés tant que l’enlèvement
des ordures ne sera pas assuré »
(Eamau-D10). A Yaoundé (Era-D05), c’est la présence même d’un opérateur
fiable (Hysacam) sur une période suffisamment longue qui permet d’envisager
une organisation durable et généralisée de la pré-collecte par les petits opérateurs,
ainsi qu’une véritable stratégie relative aux points de regroupement. Avec
des caractéristiques par ailleurs sensiblement différentes des villes
subsahariennes, le cas de Fès et l’opportunité d’intervention d’Onyx
(Cittal-D02) confirment cette conclusion. L’évolution récente de la
situation à Cotonou (à la faveur des premières élections municipales ?)
telle que la rapportent les compléments adressés par TechDev-D09 peut laisser
espérer une avancée comparable : « La
CUC (Communauté urbaine de Cotonou) a octroyé des contrats de concession à 16
entreprises, regroupées dans un collectif Collect-DSM, pour la collecte aux
points de regroupement et le transport jusqu’à la décharge. Ce nouveau découpage
doit permettre de mobiliser davantage de véhicules et d’assurer un meilleur
service. L’enquête réalisée [...] confirme
une amélioration sensible de l’enlèvement au niveau des bacs ».
Les ambitions affichées de la CUC pour une implantation et un aménagement sérieux
des points de regroupements pourraient y gagner en crédibilité.
La
Figure 2 page suivante s’efforce de présenter de façon synthétique les
paramètres déterminants pour la mise en œuvre de tels points de regroupement
et de transfert. Comme toute infrastructure charnière de ce type, seule une
approche analytique prenant en compte, de façon véritablement approfondie et
combinée, les contraintes et les besoins amont (ici, relatives aux petits opérateurs)
et aval (entreprises d’élimination) sera de nature à assurer correctement
cette mise en œuvre. Celle-ci peut et doit être adaptée aux conditions
locales, aussi rudimentaires soient-elles.
Se
donnant comme objectif que « le dépotoir
intermédiaire [soit perçu] comme
un équipement urbain qui a besoin d’une gestion (aménagement - exploitation
- entretien - maintenance) », le travail
mené à Lomé par Eamau-D10 démontre qu’une telle ambition est tout à fait
réalisable et produit pour ce faire un certain nombre de prescriptions simples
mais pertinentes, portant notamment sur :
–
un gabarit adéquat pour l’entrée du point de regroupement et de transfert ;
–
une gestion du dépotage par casiers (dont les bénéfices tirés en termes de
propreté, de nuisances olfactives, d’amélioration des conditions de travail
des différents intervenants et d’optimisation économique sont assez
clairement évalués) ;
–
la détermination de paramètres clés pour l’exploitation (volumes de
stockage, d’enlèvement, temps de séjour optimal, etc.) ;
–
mais aussi le rôle qui devrait revenir aux petits opérateurs de pré-collecte
dans la maintenance de ces sites de transfert.
L’autre
leçon intéressante de cette action est de mettre en évidence les surcharges
financières flagrantes occasionnées jusque-là par les dysfonctionnements du
dispositif de transfert, principalement la surestimation des quantités réellement
évacuées conduisant à des surfacturations. Le dépotage plus méthodique,
optimisant les volumes et fréquences d’enlèvement, donne une meilleure maîtrise
des coûts effectifs. L’équipe Eamau-D10 poursuit judicieusement cette
analyse technico-économique sur le maillon suivant du transport à la décharge.
Un tel constat n’offre t-il pas un autre éclairage à la sempiternelle
question butoir du financement ? (cf. § 7. Construire
progressivement le puzzle du financement).
On
peut toutefois s’interroger sur les recommandations sensiblement discordantes
de la nouvelle « stratégie de gestion des dépotoirs intermédiaires » conçue
par la Commune de Lomé fin 2002, pourtant supposée mettre à profit les résultats
de l’expérimentation. En effet, il y est finalement proposé de passer
d’emblée à une solution requérant davantage d’équipements et de mécanisation
(transfert via des bennes de 12 à 15 m3, reprise par camion poly-bennes) et de
confier l’entretien des dépotoirs aux entreprises aval. Des arguments sont
esquissés (optimisation pratique et financière de la rupture de charge) mais
il reste à espérer que la faisabilité d’une telle stratégie se confirme
effectivement.
4.3.
Une approche raisonnée de l’implantation des points de regroupement et de
transfert
Les
différentes recherches sur la pré-collecte déjà évoquées font ressortir,
du point de vue amont des petits opérateurs, un certain nombre de paramètres
relatifs aux distances supportables :
– pour l’apport volontaire direct par les riverains ;
–
pour les opérateurs de pré-collecte
compte tenu des contraintes d’accessibilité auxquelles ils sont soumis et des
moyens humains et matériels qu’ils peuvent mettre en œuvre.;
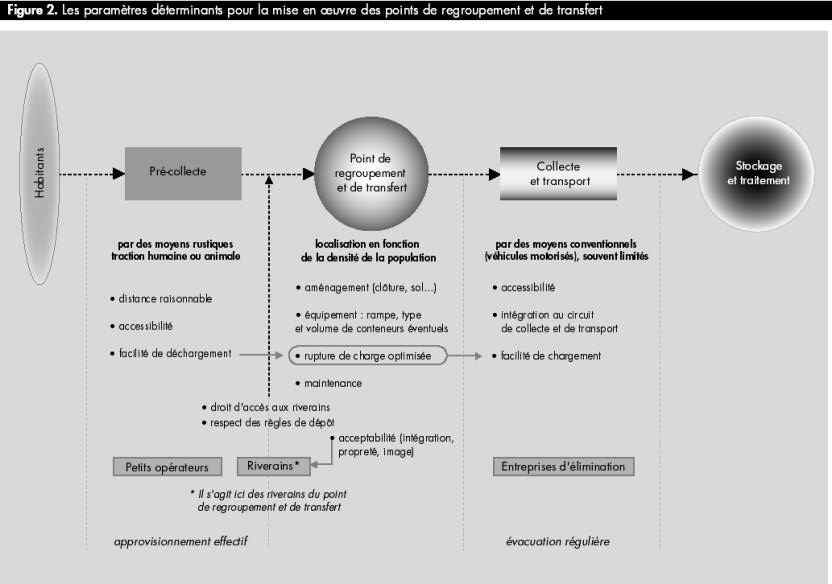
Là
aussi, certaines données directement tirées de la bibliographie méritent un
suivi pour évaluation et ajustement éventuel : ainsi à Nouakchott « les
charretiers se plaignent de l’éloignement du dépôt de transit, malgré le
fait qu’il se trouve dans un rayon inférieur à 2 km qui est la distance
maximale recommandée pour le transport par charrette »
(Tenmiya-D07).
On
perçoit implicitement, à la lecture des rapports, qu’une démarche
d’analyse spatiale et participative commence à prendre corps pour aboutir
enfin à une implantation judicieuse des points de regroupement et de transfert
: recensement par l’autorité locale des conteneurs déjà installés, mais
aussi des dépotoirs spontanés (dont on peut présumer que leur localisation
recèle de fait une certaine logique) ; concertation avec les opérateurs amont
et aval pour ajuster ces localisations, etc. Il semble toutefois encore y
manquer un recours plus systématique et appliqué à des outils
cartographiques, ce qui renvoie à nouveau à l’exemplarité, sur ce sujet, de
la méthode expérimentée par Era-D05 à Yaoundé.
Enfin,
les réactions des riverains aujourd’hui négatives à l’encontre des dépotoirs
intermédiaires – néanmoins accaparés par ces mêmes riverains pour leur
propre usage... – sont souvent mises en avant comme un élément de blocage
primordial pour l’implantation de points de regroupement et de transfert
dignes de ce nom. Les problèmes de maîtrise foncière des sites
d’implantation envisagés méritent, à n’en pas douter, d’être abordés
résolument, et au premier chef par l’Autorité locale. On peut aller jusqu’à
soutenir la thèse selon laquelle cette hostilité des habitants n’est que la
conséquence trop compréhensible du quasi-abandon de ces dépotoirs. Accompagnée
d’une concertation assidue avec les riverains, une stratégie d’exemplarité,
dont on vient de souligner à quelles conditions techniques elle peut être menée
à bien, devrait permettre de dépasser dans une large mesure cet écueil.
Derrière
la question première de « l’extraction » des déchets hors du système
urbain, largement abordée par les équipes et traitée dans les chapitres précédents,
celle de leur traitement ultérieur est relativement peu abordée dans les
travaux du programme.
Dans
bon nombre de cas, les déchets finalement rassemblés sont éliminés de façon
spontanée et erratique aux marges[1]
de la ville, sous forme de dépôts, voire d’utilisation comme remblai ou
comme amendement (IRD-D08). Pour des agglomérations moyennes et sous certaines
conditions climatiques favorables, ces pratiques ne constituent-elles pas sinon
une issue satisfaisante, du moins une solution de fait ? Dans ce cas, la priorité
relèverait peut-être davantage d’une prise en compte, à la source, des déchets
facteurs de gêne ou de risques (plastiques de plus en plus présents, déchets
dangereux issus de certaines activités, etc.).
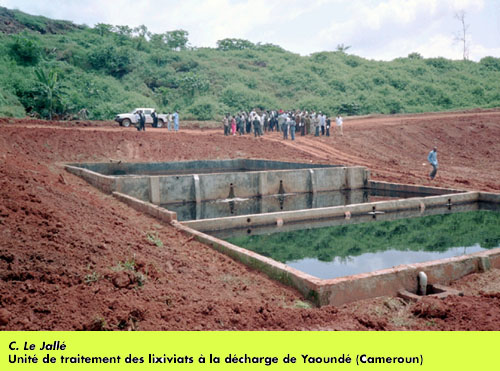
D’une
manière générale, il faut sans doute d’emblée souligner que les pratiques
ou techniques d’enfouissement, qu’elles soient spontanées ou organisées,
passives (simple dépôt) ou à vocation utilitaire, constituent encore
l’essentiel des solutions accessibles, en tout cas en Afrique subsaharienne,
compte tenu tant de la nature des résidus urbains que de ses capacités
techniques et financières à ce stade du développement.
Il
serait illusoire aujourd’hui d’y envisager une élimination finale organisée,
au travers de dispositifs industriels sophistiqués d’incinération ou de
traitements biologiques (usines de compostage ou de méthanisation). Ces
derniers ont fait et font, certes, l’objet de réalisations au Nord du
continent (Maroc, Egypte), mais avec des résultats mitigés... En tout état de
cause, comme les pays du Nord en ont eux-mêmes progressivement pris conscience,
la mise en décharge restera un maillon, éventuellement ultime, mais de toute
façon incontournable, d’une gestion durable des déchets.
5.2.
Pour une évolution pragmatique et progressive vers des décharges soutenables
Dans
certains cas et particulièrement dans les plus grandes agglomérations,
l’absence de site d’enfouissement technique officiel et organisé constitue
toutefois déjà un facteur d’embolie qui se répercute lui-même sur
l’amont du service.
On
retrouve alors, à une autre échelle, et un maillon plus loin, les mêmes
causes et mécanismes de blocage que pour les points de regroupement et de
transfert :
–
manque de disponibilité foncière pour implanter l’infrastructure ;
–
éloignement excessif, occasionnant des détournements et des abandons en cours
de route (cf. le projet de décharge de Cotonou) ;
–
premières manifestations de rejet des riverains (syndrome Nimby, comme à Porto
Novo, IRD-D08).
Quant
à la conception de ces sites d’enfouissement, il semble contre-productif de
prétendre adopter des normes de décharges modèles correspondant à celles des
pays les plus avancés sous la pression des bailleurs de fonds.
Comme
on l’a vu pour les points de regroupement et de transfert, il y a certainement
place pour une démarche progressive de qualification des centres
d’enfouissement, au travers de mesures relativement simples : choisir une
implantation adéquate au plan hydro-géologique, clôturer, exploiter en
casiers, contrôler les entrées et peser dès que possible2, prévenir les brûlages
sauvages, etc. La décharge exploitée par Hysacam près de Yaoundé donne un
exemple intéressant dans ce sens (Era-D05).
Dans
tous les cas, l’organisation de l’enfouissement doit être menée avec le
souci d’une véritable intégration des populations de récupérateurs
informels pré-existants dans ce processus évolutif : clôturer le site ne doit
pas revenir à exclure les chiffonniers.
6.
La coordination entre les acteurs : des rôles clarifiés et assumés
Dressées
par la plupart des recherches du programme (en particulier Tenmiya-D07 à
Nouakchott et Eamau- D10 à Lomé), les analyses des échecs antérieurs ou des
impasses en cours sont sans équivoque sur un certain nombre de carences
organisationnelles, qu’il s’agisse d’absence de coordination entre
acteurs, de confusion des rôles, de responsabilités non véritablement assumées.
6.1.
Dépasser la simple phraséologie sur la « gestion partagée »
Leitmotiv
systématiquement mis en avant, la notion de « gestion partagée » semble intégrée,
depuis la fin de la précédente décennie, par la plupart des programmes
officiels d’élimination des déchets. Mais ne s’agit-il pas encore trop
souvent pour certains échelons politiques et techniques d’une formule alibi
et un peu creuse ? Il semble en être un peu de même de l’appel quasi
incantatoire chez certains, mais pas toujours suivi d’effet, à « mettre en
place un cadre de concertation ». Pour ce qui est de partager la gestion, il ne
s’agit pas tant d’une juxtaposition opérationnelle entre secteurs public et
privé que d’une véritable structuration des rôles et prérogatives entre
donneur d’ordre public et prestataires privés.
Un
des principaux mérites des actions menées dans le cadre de ce programme est de
commencer à donner un véritable contenu, concret et formalisé, à ces notions
en développant, parfois à profusion, les démarches méthodiques
d’identification et de diagnostic des acteurs locaux, puis de concertation et
de contractualisation entre ces différents partenaires.
La
Figure 3 page suivante s’efforce, sur cette base, de positionner schématiquement
les acteurs essentiels et leurs rôles constitutifs d’un dispositif de gestion
des déchets potentiellement pérenne dans le contexte de ces villes africaines.
Trois éléments clés, développés dans les paragraphes qui suivent, peuvent
être identifiés.
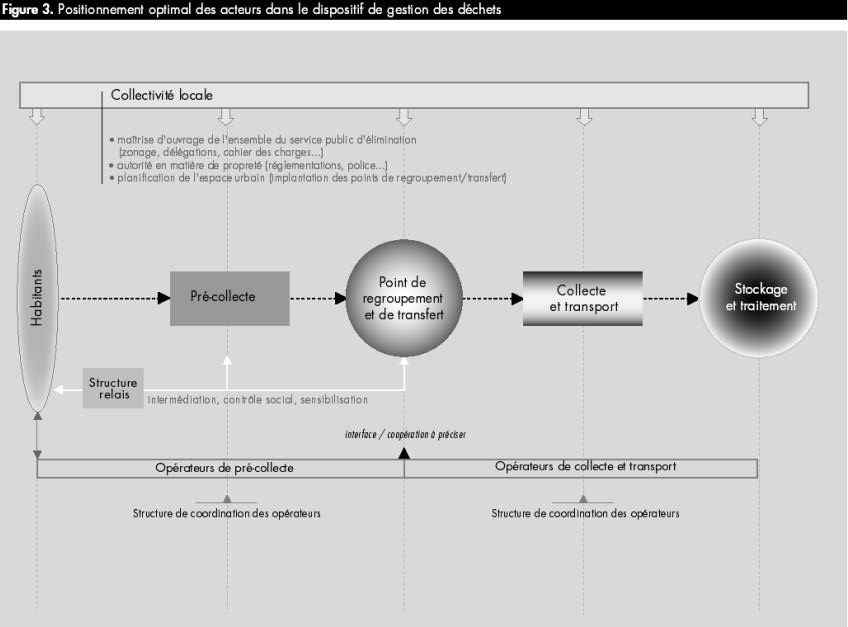
6.2.
Des autorités locales assumant leur rôle
Il
paraît tout d’abord indispensable que les autorités municipales assument
pleinement la totalité des fonctions qui leur reviennent dans l’élimination
des déchets, qu’il s’agisse de la maîtrise d’ouvrage du service public,
de la planification urbaine ou de la police de l’environnement.
Il
faut « faire de la municipalisation et du
renforcement de la capacité municipale, l’objectif prioritaire et préalable
ou au moins parallèle à la multiplication d’initiatives privées. (...) La
cohérence générale de la filière, du domicile jusqu’à la décharge finale
et le traitement, impose une action publique coercitive de conception,
d’arbitrage et d’évaluation à la fois technique et économique »
(IRD-D08).
«
La fonction de maîtrise d’ouvrage
publique par la collectivité [doit être]
affichée et reconnue »
TechDev-D09)
6.3.
Coordonner l’intervention des différents prestataires privés
Une
coordination effective entre les différents prestataires privés constitue une
seconde condition de la réussite, qu’il s’agisse :
–
de distribuer et de coordonner l’intervention des opérateurs agissant sur le
même maillon technique à l’intérieur du territoire urbain ;
–
d’organiser la coopération entre les opérateurs respectifs des deux maillons
: pré-collecte d’une part, collecte secondaire et transport d’autre part.
L’absence
de maîtrise d’ouvrage réelle et de précision des missions déléguées,
ainsi que la succession accélérée et incohérente des interventions publiques
conduisaient souvent, jusque-là, à une concurrence contre-productive entre les
initiatives et les acteurs de terrain, voire à des « programmes qui
s’excluent et s’étouffent les uns les autres ». Remédier à de tels
dysfonctionnements devrait être une priorité pour les municipalités. Les données
rassemblées et les expériences menées dans le cadre du programme offrent à
cet égard une gamme assez complète et cohérente d’outils : zonage des
interventions ; élaboration de cahiers des charges, contrats, conventions ;
suivi et contrôle effectifs des services délégués ; méthodes de
concertation ; etc.
Point
particulier, l’interface entre les prestataires amont et aval, au niveau de la
gestion des points de regroupement et de transfert, est probablement
essentielle. Il paraît pour le moins nécessaire de bien préciser
contractuellement les règles d’utilisation du site à respecter par chacun,
mais aussi leurs rôles respectifs dans son entretien et sa surveillance. Outre
l’intérêt pour une bonne exploitation, cela peut constituer un vecteur de
partenariat renforcé entre les entreprises d’enlèvement et les petits opérateurs
de pré-collecte.
On
peut aussi redire ici l’intérêt qu’offre l’émergence d’organisations
professionnelles (à l’instar de Cogeda et Collect-DSM à Cotonou) assurant
elles-mêmes des fonctions de coordination entre les opérateurs d’un même
maillon, d’appui à la professionnalisation (échanges, émulation,
capitalisation des expériences), de représentation auprès des autres
partenaires et pour des interventions d’intérêt général (campagnes de
salubrité, etc.).
6.4.
Favoriser l’intervention de structures relais issues du terrain
Enfin,
le recours à des structures relais identifiées parmi la population constitue
une troisième clé du dispositif.
Comités
de quartiers à Nouakchott (Tenmiya-D07), Amicales à Fès (Cittal-D02),
structures relais à Yaoundé (Era-D05), comités de responsabilisation et de
surveillance à Lomé (Eamau-D10), etc. Elles peuvent préexister ou être
constituées spécifiquement autour du projet de généralisation de la pré-collecte
et/ou de réhabilitation des points de regroupement et de transfert. Elles
doivent être bien distinctes des petits opérateurs de pré-collecte en voie de
professionnalisation, même si ceux-ci ont pu être initialement l’émanation
de telles associations de quartiers. Dans tous les cas, elles gagnent bien
entendu à s’appuyer sur les structures « traditionnelles » présentes dans
ces quartiers (chefferies, etc.).
On
voit au travers des différentes actions du programme que les formules expérimentées
ou envisagées recouvrent, selon le contexte et l’histoire, des champs
d’intervention plus ou moins étendus, particulièrement pour ce qui est de
l’intermédiation contractuelle et financière assurée par ces structures :
à Nouakchott (Tenmiya- D07) le comité de quartier disposerait d’une véritable
délégation de service dans le recouvrement des redevances, jouant un rôle
d’intermédiaire entre l’autorité communale et les charretiers, là où
dans d’autres cas (Yaoundé, Era-D05), son rôle se limite à celui de contrôleur
et d’arbitre de proximité en appui de ce bon recouvrement. S’il ne paraît
guère possible de trancher de manière générale et définitive, on peut
toutefois insister sur la nécessité d’éviter toute formule qui conduirait
encore une fois à une confusion des rôles et au désengagement implicite de la
puissance publique.
C’est
l’occasion d’aborder le cas de Fès (Cittal-D02), relativement spécifique
par rapport aux villes sub-sahariennes dont il a surtout été question jusqu’à
présent. Le quartier qui y a été étudié, mais c’est loin d’être le cas
de l’ensemble de la ville de Fès, ne présente pas le même degré
d’inaccessibilité que les quartiers étudiés par les autres équipes sur
l’Afrique sub-saharienne, où se justifiait un maillon technique à part entière
et, pour le couvrir, le développement de petits opérateurs privés de pré-collecte.
A
Fès, même si ces objectifs contractuels ne sont pas tout à fait atteints, il
a pu être sérieusement envisagé l’installation de bacs de regroupement « tous
les 100 m [...] le
trajet demandé à l’usager étant limité à 25 m »,
ce qui marque bien cette différence. Si pré-collecte il y a, c’est donc de
façon beaucoup moins prégnante et autonome, et en grande partie par apport
volontaire des habitants eux-mêmes. Ce maillon, raccourci, devient périphérique
à une problématique essentiellement recentrée sur l’implantation et la
gestion des bacs. Même s’il est question de « confier la pré-collecte »
aux Amicales, leur intervention, pour essentielle qu’elle soit, relève bien
d’une logique de mobilisation sociale pour assurer la propreté urbaine à
l’instar de celle des « structures relais » dont il est question ici.
7.
Construire progressivement le puzzle du financement
Par
delà les considérations techniques et organisationnelles, la question du
financement du service public d’élimination des déchets urbains reste entière
pour ces agglomérations africaines, compte tenu à la fois du niveau de vie de
la majorité de leurs administrés, particulièrement ceux des quartiers spontanés
dont il a été question, et de leurs propres ressources.
Les
travaux réalisés dans le cadre du programme recèlent un matériau intéressant,
mais assez partiel et hétérogène, sur ces questions financières, qui porte
notamment sur :
–
l’analyse des coûts actuels des différents maillons du service d’élimination,
particulièrement de la pré-collecte par les petits opérateurs (niveaux de rémunération
et autres charges) ;
–
le consentement à payer ce service de pré-collecte par les populations des
quartiers défavorisés (et son évolution sur les premiers mois de développement)
;
–
différents scenarios de financement, plus ou moins développés.
Ces
éléments mériteraient à eux seuls un travail en profondeur d’analyse
comparée et de synthèse. Quelques axes principaux peuvent néanmoins en être
extraits.
7.1.
Un financement différencié selon les maillons successifs
Si
elle n’est pas aujourd’hui assurée de manière certaine, la solution du
financement passera sans doute par une complémentarité entre deux modules (cf.
Figure 4 page suivante) :
–
un financement structurel par les pouvoirs publics de l’ossature de base du
dispositif (points de regroupement et de transfert, service d’enlèvement à
partir de ces points et transport) ;
–
un financement plus ou moins important par l’usager des services qui lui
seraient rendus (collecte à domicile).
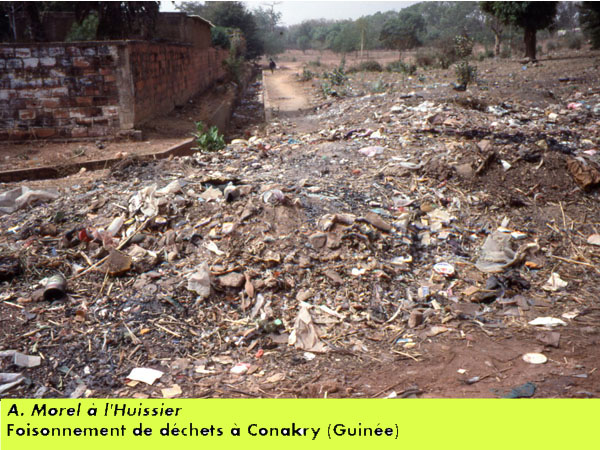
Le premier de ces deux modules est à rechercher à la fois dans :
–
la consolidation progressive du produit de la fiscalité locale : par une
augmentation de son assiette mais aussi de son taux de recouvrement,
aujourd’hui extrêmement partiel. Pour faire face à cette difficulté, la
piste d’une surtaxe destinée au financement de l’élimination mais reposant
sur un autre service mieux maîtrisable, comme l’alimentation en électricité,
est à nouveau évoquée (par Era-D05 notamment), mais sans être approfondie ;
–
l’optimisation et la transparence des charges réelles supportées par les
entreprises auxquelles la collectivité délègue l’aval du dispositif. On
l’a déjà dit, l’investigation menée par Eamau-D10 à Lomé est plus
qu’instructive à cet égard. Les comparaisons, même grossières, s’avèrent
également intéressantes lorsqu’elles montrent par exemple que « le
coût moyen pour éliminer 1m3 de DSM (déchets
solides ménagers) à Cotonou est élevé,
comparé à celui d’autres grandes villes africaines »
– de fait supérieur à celui de Dakar, et pratiquement le double des autres
agglomérations subsahariennes – même si la recherche TechDev-D09 ne va pas
au-delà de ce constat.
Plusieurs
recherches convergent ici sur la défense d’une notion de service minimal généralisé
à l’ensemble de la population, porteur « d’équité » plutôt que « d’égalité
». Ce minimum serait essentiellement constitué par l’ossature aval, à
savoir un maillage suffisant et adapté de points de regroupement et de
transfert, et un service d’enlèvement et de transport vers la décharge.
«
Les occupants de zones d’habitat spontané
seront satisfaits si leurs déchets sont régulièrement évacués de leur
environnement à partir de points de dépôts vers lesquels ils amèneraient
eux-mêmes leurs ordures ou avec l’aide de pré-collecteurs ».
Par contre, « on peut s’attendre à ce
que les habitants des quartiers résidentiels soient demandeurs d’un niveau de
service élevé privilégiant l’enlèvement quotidien à leur domicile de leur
poubelle personnelle » (selon Era-D05 à
Yaoundé).
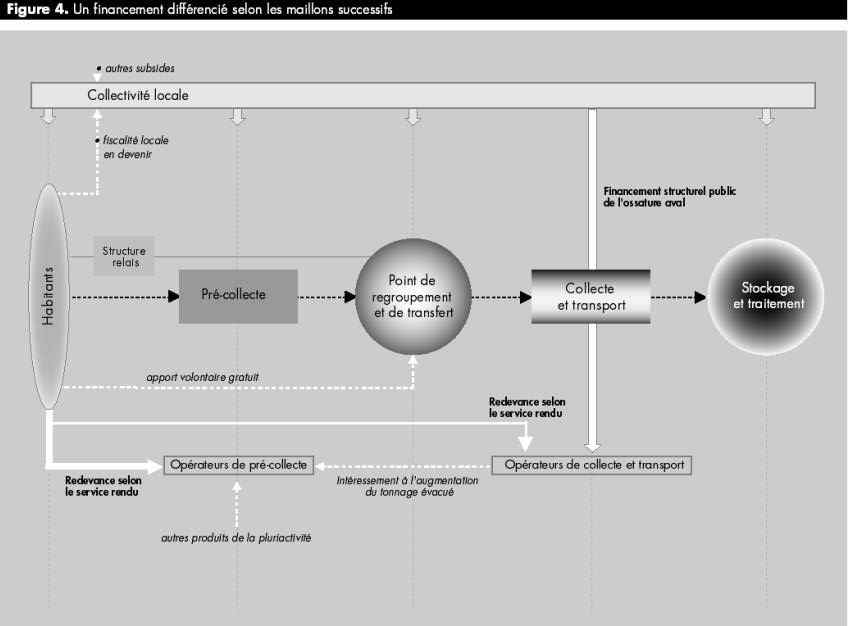
En
amont, selon ce schéma, et sauf apport volontaire pour les riverains, les
services complémentaires de précollecte seraient donc directement financés
par la contribution des usagers, sur l’ensemble de l’agglomération, quel
que soit le « standing » des quartiers, mais en fonction du service qui leur
est assuré (mécanisme de redevance).
En
plus d’une différenciation logique par tranches selon la taille des ménages
desservis, les « tarifs » expérimentés par les actions sur la base d’enquêtes
préalables et de concertations dans les quartiers spontanés ont montré la nécessité
de prendre en compte des considérations d’ordre social (tarif différencié
selon le degré de pauvreté).
7.2.
Les limites d’une redevance payée par l’usager
La
question reste en effet de savoir si ce second module de financement, le
paiement par l’usager, est de nature à couvrir, ou pas, le coût de la pré-collecte
dans tous les cas de figure.
A
Lomé, Eamau-D10 pose l’hypothèse qu’il est possible « d’améliorer
les recettes des associations de précollecte en vue de leur permettre de
participer au financement de l’évacuation du dépotoir ».
La pré-collecte serait ainsi suffisamment profitable pour financer une partie
de l’aval du dispositif, en complément des économies obtenues par une remise
à plat des charges réelles de ce maillon aval. La démonstration n’en est
toutefois pas apportée. Mais les études explicitement centrées sur le développement
de la pré-collecte dans les quartiers spontanés concluent assez clairement en
sens inverse.
Ces
actions ont obtenu des résultats incontestables en termes d’adhésion des
populations au service proposé et de recouvrement des redevances. Dans le
quartier de Basra à Nouakchott (Tenmiya-D07), le nombre d’abonnés a doublé
en 4 mois, avec 80 % de recouvrement. A Yaoundé (Era-D05), les enquêtes menées
quelques semaines après le démarrage de l’opération montrent une nette amélioration
de la volonté du ménage « à confier ses déchets » et « à payer », ce
qui se traduit d’ailleurs très concrètement par une augmentation de 30 % du
tonnage d’ordures évacuées vers les bacs de regroupement d’Hysacam.
Néanmoins,
comme le souligne cette étude à l’issue d’une analyse économique détaillée,
« les opérations de pré-collecte ne
pourront pas être équilibrées à partir de la cotisation des ménages »,
notamment parce que dans le même temps, « le
montant des factures que les ménages sont prêts à supporter a baissé ».
C’est alors une piste totalement symétrique de celle évoquée à Lomé qui
est suggérée : l’entreprise aval Hysacam étant rémunérée en fonction du
tonnage évacué vers la décharge, les 30 % de déchets supplémentaires «
extraits » grâce à la pré-collecte pourraient lui permettre d’intéresser
les structures de pré-collecte au bénéfice qui en résulte (et qui est
largement à la hauteur des besoins : avec une recette de 692 400 FCFA, il
manque 353 000 FCFA par mois aux pré-collecteurs, tandis qu’Hysacam augmente
son chiffre d’affaires de 768 000 FCFA !). Retenons en tout cas qu’il
convient de privilégier, tout au long de la chaîne, les mécanismes financiers
proportionnés au service effectivement assuré sur des bases quantifiables.
Certaines
difficultés subsistent néanmoins dans la mise en œuvre détaillée du schéma
se revendiquant d’une certaine équité : ainsi la gratuité de l’accès par
apport volontaire aux points de regroupement – qui se justifie à plus d’un
titre : gage d’acceptation par les riverains, sauvegarde d’un espace ouvert
à une démarche autonome, voire citoyenne, par opposition à une
marchandisation systématique du service public – n’est pas sans poser des
problèmes. Sachant que ce sont généralement les plus démunis qui en sont les
plus éloignés, n’y a t-il pas un risque de distorsion ? Ces questions auront
besoin d’être approfondies.
7.3.
Ne pas attendre du recyclage une contribution au financement de l’élimination
Enfin,
il paraît vain de rechercher, comme on en sent encore la tentation dans
plusieurs travaux de ce programme, une contribution complémentaire au
financement du dispositif d’élimination des résidus urbains dans le tri à
la source, la collecte séparée et le recyclage de certains de leurs composants
valorisables.
Ce
constat n’est d’ailleurs guère différent de celui auquel ont abouti les
pays du Nord où, pour faire simple, l’utopie de « l’or dans les poubelles
» a fait long feu et conduit à d’autres mécanismes de financement :
responsabilité des producteurs initiaux et internalisation dans le prix de
vente des produits de consommation. Ici, on l’a vu, les gisements de matériaux
effectivement recyclables font déjà logiquement l’objet d’un écrémage de
fait par un secteur de récupération qui intègre toute une filière depuis
l’informel (y compris dans le cas du compostage pour des besoins de proximité,
dans les limites de leur existence) jusqu’au plus « professionnel ».
Favoriser la maturation « industrielle » de ce secteur pourra par contre
constituer un objectif complémentaire à celui de la consolidation du service
public d’élimination (cf. N’Djaména-D01 ou Burgeap-D06 au Sénégal).
A
propos de la logique même d’évacuation des déchets, la recherche IRD-D08
(sur Mopti et Porto Novo) jette indéniablement un pavé dans le marigot, en
donnant une perspective renversée de la question des 60 à 80 % de déchets ménagers,
dont on dit qu’ils ne sont pas pris en charge dans la plupart des villes
africaines.
Au-delà
de l’analyse d’économiste critique sur l’existence ou non d’une demande
d’évacuation, force est alors de constater qu’il y existe bien des
pratiques alternatives d’élimination, dont on peut relever « la puissance,
la persistance et l’efficacité ». Sinon comment ces flux, par ailleurs
croissants, s’évanouiraient-ils ?
Séparation
du sable à la source, réutilisation des objets et recyclages en circuit court
et de proximité, autocompostage et utilisation en agriculture urbaine ou périurbaine,
brûlages, et surtout remblaiements répondant à de réelles contraintes de
l’environnement (topographiques, hydrologiques, etc.) ou à des nécessités
foncières d’une ville de fait en développement... On oppose là, au dogme de
l’élimination/évacuation, toute une gamme de pratiques de traitement et de
valorisation autonomes, in situ.
Dans
ce même registre de la sauvegarde souhaitable d’une certaine « autonomie »
des pratiques de gestion des déchets, plusieurs travaux soulignent à juste
titre ce qu’il y aurait d’inopportun à interdire au citoyen d’apporter
lui-même gratuitement ses déchets à des points de regroupement (cf. § 7. Construire
progressivement le puzzle du financement).
L’analyse
anthropologique (Shadyc-A04 ) apporte sa contribution à ces approches en
soulignant avec force l’existence d’une « ingéniosité
[qui] se
déploie et donne aux objets déchus une seconde chance de survie et de
participation à l’économie domestique ».
Comment
ne pas relever à quel point ceci rejoint directement des réflexions qui émergent
actuellement dans les pays du Nord, compte tenu des limites et des impasses des
systèmes en place, y compris collectes sélectives et recyclage. Autour de la
prévention des déchets (par réduction à la source, évitement, détournement
avant prise en charge par les services d’élimination), elles soulignent
notamment la nécessité de préserver en les accompagnant des bonnes pratiques
qui évitaient de fait l’apparition d’une partie du flux de déchets en tant
que tel. L’exemple le plus significatif, en France, en a été la défense/promotion
du compostage individuel comme alternative à la systématisation de collectes séparées
de déchets fermentescibles, en province et dans les zones périurbaines.
La
recherche IRD-D08 propose ainsi d’ouvrir une réflexion nouvelle vers une « élimination
raisonnée [...] par
réduction des volumes à évacuer ».
Elle souligne le lien étroit avec le contexte urbain qu’il faut prendre en
compte, reconnaissant que ces réponses alternatives sont peut-être davantage
adaptées à des villes de taille intermédiaire et aux moyens limités, comme
Mopti et Porto Novo. Le déséquilibre structurel relevé à Yaoundé (Era-D05)
entre le flux de matières fermentescibles de l’agglomération et la capacité
d’absorption par l’agriculture urbaine et périurbaine illustre en partie
ces réserves.
Études
citées dans cette synthèse
Lasdel-A03.
La question des déchets et de l’assainissement dans deux villes moyennes
(Niger)
Shadyc-A04.
Une anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques
sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine (Burkina Faso)
N’Djaména-D01.
Tri sélectif et valorisation des déchets urbains de la Ville de N’Djaména
(Tchad)
Cittal-D02.
Réflexion concertée pour une gestion intégrée de la propreté entre
population, puissance publique et opérateur privé : le cas de Fès (Maroc)
Era-D05.
Mise en place de structures de pré collecte et de traitement des déchets
solides urbains dans une capitale tropicale, Yaoundé (Cameroun)
Burgeap-D06.
Analyse des procédés de recyclage des déchets au Vietnam pouvant être transférés
vers l’Afrique (Vietnam, Sénégal)
Tenmiya-D07.
Projet d’appui aux petits opérateurs “transporteurs des déchets solides”
du quartier de BASRA à Nouakchott (Mauritanie)
IRD-D08.
Gestion des déchets et aide à la décision municipale : Municipalité de Mopti
et Circonscription Urbaine de Porto Novo (Mali, Bénin)
TechDev-D09.
Maîtrise de l’amont de la filière déchets solides dans la ville de Cotonou
: pré-collecte et valorisation (Bénin)
Eamau-D10.
Opportunités et contraintes de la gestion des déchets à Lomé : les dépotoirs
intermédiaires (Togo)
Etude-AfD.
Revue comparative des modes de gestion des déchets
urbains adoptés dans différents pays de la ZSP », réalisée pour l’AfD