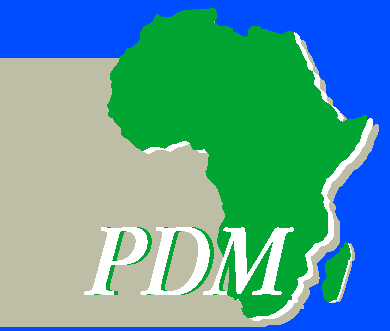Synthèse des acquis du programme
Quel
rôle pour la commune ?
Jean-Paul
Duchemin
Sommaire
1.
Une entité et une histoire
1.1.
De quelle entité parlons-nous ?
1.2.
Quelques points d’histoire
1.3.
Un contexte nouveau
2.
La commune et le service de l’assainissement et des déchets aujourd’hui
2.1.
Un acteur politique faible, en permanence contourné mais avec lequel il faut
compter
2.2.
Un service à rendre mais lequel ?
3.
Les modes de « faire »
3.1.
Le virage des années 90 et ses retombées sur la gestion des services
3.2.
Faire soi-même, faire-faire ou contrôler ?
4.
Vrais et faux débats, premiers enseignements
4.1.
Enseignements
4.2.
Quel positionnement pour la commune ?
5.
Aujourd’hui, des objectifs, une stratégie, des points d’application
5.1.
Des objectifs
5.2.
L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique de gestion des déchets
solides et liquides
5.3.
La question des niveaux spatiaux pertinents
5.4.
Des points d’application
6.
Les moyens d’agir
6.1.
Un préalable : la connaissance des pratiques des habitants, de la nature des déchets
et des quantités produites
6.2.
Des nouveaux métiers à apprendre
6.3.
La question du financement : prélèvement fiscal ou redevance directe, une
contradiction seulement apparente ?
6.4.
La mobilisation sociale et la participation des usagers
Études
citées dans cette synthèse
Cette
réflexion a été construite à partir des éléments fournis par les
recherches menées dans le cadre du programme « Gestion
durable des déchets et de l’assainissement urbain »,
qui a fait l’objet d’un appel à propositions pour des actions de recherche
et des actions pilotes, par la réunion de partage des enseignements du
programme avec les partenaires camerounais (Yaoundé, novembre 2003), par les
exposés et débats traitant du sujet au cours du sommet « Africités 3 »
(Yaoundé, décembre 2003).
A
l’exception d’informations portant sur le Maroc (Agadir, Fès, Rabat), sur
deux villes de l’aire anglophone (Moshi en Tanzanie et Accra au Ghana), et sur
Debre-Berhan en Ethiopie, les éléments, au demeurant très disparates, sur
lesquels nous nous appuyons dans ce texte concernent essentiellement des villes
de l’Afrique francophone.
1.1.
De quelle entité parlons-nous ?
Les
termes de référence de l’appel à propositions portaient sur la gestion
durable des déchets et de l’assainissement dans les villes, sans qu’un
seuil de taille ait été défini. Les villes ou parties de villes qui ont servi
de terrains d’études sont de tailles très différentes : à l’exception
d’un bourg en périphérie de Cotonou (Togoudo, 14000 hab.), il s’agit de
villes moyennes (Mopti, Louga, etc.) ou de très grands villes (Yaoundé, Dakar,
etc.).
La
dénomination couramment utilisée pour ces entités est le terme de « commune
». C’est celui que nous retiendrons. En effet, dans ce texte, nous ne
traiterons que de ce premier échelon des collectivités locales. Les autres
niveaux de l’organisation du territoire, les autres « collectivités
territoriales », ne seront qu’évoquées, si nécessaire.
D’autre
part, nous ne traitons que de communes urbaines, que celles-ci couvrent
l’ensemble de l’agglomération urbaine ou une partie seulement. En effet,
dans le cas d’un certain nombre de grandes villes, souvent capitales d’Etat,
l’agglomération a été divisée en plusieurs communes.
Ce
terme générique de « commune » recouvre en Afrique des statuts
administratifs différents. Même si des nuances existent, deux statuts
coexistent. Le clivage essentiel entre ces deux statuts tient à la personne détentrice
de l’autorité de décision (tout particulièrement celle de l’engagement
des ressources du budget municipal). D’un coté, un maire élu, de l’autre,
un représentant de l’Etat (sous-préfet, délégué du gouvernement, etc.).
Les termes de « commune de plein exercice » et de « commune mixte », statuts
créés par le colonisateur français, sont encore, quelquefois, employés.
1.2.
Quelques points d’histoire
Le
souhait des communautés d’administrer elles-mêmes leurs intérêts propres
et de dessiner leur avenir est ancien. Il est fondé sur le principe de la
participation de tous au gouvernement de la cité (la démocratie municipale).
Si,
en Afrique, le fonctionnement de certaines sociétés acéphales se rapproche de
ce modèle, le concept administratif – un territoire géré par un conseil
municipal – fut importé avec les colonisations.
L’empire
britannique, en appliquant « l’indirect
rule », laissa une large autonomie d’auto-organisation
aux communautés. Même si, en officialisant la position d’arbitre des chefs
coutumiers, il s’agissait surtout d’en faire des instruments dociles de la pax
britannica.
Dans
l’empire français, les premières communes furent Saint Louis du Sénégal,
Gorée, Rufisque puis Dakar dont les citoyens furent très tôt français.
Longtemps, la vie politique pour les africains de l’Afrique coloniale française
se résumera à ces quatre communes de plein exercice.
La
seconde guerre mondiale, par ses besoins en hommes mais aussi par l’idéologie
de liberté qui fondait le camp des alliés, puis la création des Nations unies
et l’indépendance acquise par de nombreux peuples, imposèrent des
changements dans la politique coloniale française (discours de Brazzaville).
Durant la période postérieure à la seconde guerre, la puissance publique
coloniale commence à mettre en place un système communal pour les villes,
d’ailleurs encore peu nombreuses. Les communes de plein exercice restent rares
(quelques grandes villes) et la plupart des communes érigées sont dites «
mixtes ». Elles associent un conseil municipal élu à un exécutif aux mains
du représentant de l’autorité coloniale (commandant de cercle puis sous-préfet).
Consacrée
à la mise en place des appareils d’Etat, la décennie des indépendances ne
voit pas le mouvement s’amplifier. Bien au contraire, un certain nombre de
services publics, la distribution de l’eau en particulier, sont repris aux
communes par l’Etat qui crée les offices ou les sociétés nationales de
distribution.
Il
faut attendre la fin des années 70 pour que, dans un pays précurseur, la Côte
d’Ivoire, la préoccupation, nouvelle, de l’aménagement du territoire,
relance le mouvement. Des communes – chefs-lieux de région ou de département
– sont alors créées, mais toujours sous les deux formes de commune gérée
par un maire élu et de commune dont l’exécutif est sous l’autorité d’un
représentant de l’Etat.
Encore
aujourd’hui, ces deux statuts sont présents dans un certain nombre de pays.
Au Cameroun, dans les dix principales villes du pays (y compris Yaoundé et
Douala), le pouvoir de décision appartient à un délégué du gouvernement
malgré la présence d’un maire et d’un conseil municipal élus.
A
partir des années 80, quatre faits vont conjuguer leurs effets pour modifier
profondément le paysage politique issu de la période des indépendances : la
crise de l’Etat ; le développement rapide, voire exponentiel, du mouvement
associatif ; la nouvelle politique du FMI et de la Banque mondiale ; le
mouvement de décentralisation.
1.
La crise de l’Etat. Celle-ci tient, bien sûr, à l’effondrement de
ses recettes mais aussi à un fonctionnement dispendieux et inefficace des
services publics. Cette crise se traduit par l’incapacité des Etats à
assurer à leurs populations les services de base : santé, éducation, eau
potable, mais aussi assainissement et enlèvement des déchets, particulièrement
dans les villes qui rassemblent de plus en plus de population.
2.
Le développement rapide, voire exponentiel, du mouvement associatif. Si
le mouvement associatif (associations de femmes, de jeunes, à base
communautaire ou religieuse, etc.) se développe, c’est d’abord pour faire
entendre la voix de la population dans un champ politique où ses relais
traditionnels (les chefs coutumiers) sont marginalisés et où les représentants
élus (les députés) voient leur parole corsetée par la ligne de partis
uniques, tout dévoués à des pouvoirs de plus en plus autoritaires. Ce
mouvement associatif va être renforcé, voire relayé, par le flux des diplômés
ne trouvant plus place dans la fonction publique, eux-mêmes rejoints par les «
compressés » (personnels licenciés lors des périodes de crise).
L’expression des revendications étant souvent peu suivie d’effets, ces
nouveaux acteurs vont chercher à pallier les défaillances des services publics
en occupant un certain nombre de créneaux vacants. Ils cherchent ainsi à créer,
pour euxmêmes, une activité génératrice de ressources. Ces acteurs, qui se
constituent souvent en ONG, sont en liaison étroite avec les associations de
solidarité internationale qui les inspirent et les soutiennent. Grâce à ce
soutien et à l’accès qu’il permet à des financements extérieurs, ce
mouvement d’auto-organisation s’est imposé comme un interlocuteur majeur et
a probablement été le secteur le plus créateur d’emplois durant les vingt
dernières années.
3.
La nouvelle politique du FMI et de la Banque mondiale. Après plusieurs décennies
d’appui financier aux Etats et tout particulièrement aux services publics,
les grands bailleurs de fonds internationaux constatent l’échec de cette
politique. Le FMI et la Banque Mondiale formulent alors une nouvelle politique.
Deux grands postulats sont arrêtés :
–
une « gouvernance » au plus près des populations. Elle implique leur
participation et celle des organisations que ces populations se sont données,
ainsi qu’une décentralisation des lieux de décision ;
– la privatisation / libéralisation des services publics. Elle induit une substitution de la norme municipale du « faire » – la régie municipale qui a été le mode de faire le plus répandu les premières années des indépendances par celle du « faire faire » : délégation, concession, affermage. La préférence semble même aller à une privatisation complète du service. Dans ce dernier cas, un encadrement réglementaire doit, certes, subsister mais l’opérateur privé fixe, en totale liberté, le prix du service qu’il rend.
4.
Le processus de décentralisation en cours, bien que partiellement engagé
dans la période précédente, s’est accéléré en réponse pour partie au
bref sursaut démocratique (conférences nationales, fin des partis uniques) et
pour partie au positionnement nouveau des bailleurs de fonds internationaux. Il
établit les communes comme l’échelon de base de la nouvelle organisation des
responsabilités. Dans ce mouvement, l’Etat cède aux communes la
responsabilité de mettre en œuvre un certain nombre de services publics de
base, en particulier dans le champ qui nous intéresse : le service de
l’assainissement et des déchets.
Toutefois,
ce mouvement présente bien des ambiguïtés. Outre l’annonce de la volonté
de mettre en place une organisation du territoire efficace car plus proche des
habitants, le discours officiel présente la décentralisation comme une étape
importante dans la démocratisation de la vie publique. Les municipalités sont
de plus en plus nombreuses à être élues, mais c’est encore loin d’être
la norme. Encore aujourd’hui l’Etat continue d’exercer le pouvoir au
niveau communal soit par ses représentants directs (délégués du
gouvernement, sous préfets, etc.), soit en nommant les « maires ».
La
liberté de décision et de gestion de l’action municipale est proclamée
totale, mais le principe de « l’unicité de caisse » se traduit par la
perception par l’Etat des impôts locaux – quand ils existent. C’est
toujours le pouvoir central qui attribue les budgets communaux selon des règles
bien souvent obscures et rarement négociées. Les ressources directement prélevées
par les communes sont marginales (taxes de marché, etc.). Les ressources pour
agir dépendent donc du bon vouloir de l’Etat. Les travaux déjà anciens menés
pour établir les assises d’une base d’imposition municipale (adressage, SIG,
registre foncier) commencent seulement à être mis en œuvre (Cotonou, Yaoundé),
ce qui permet à des budgets municipaux de bénéficier d’un accroissement de
leurs recettes.
2.
La commune et le service de l’assainissement et des déchets aujourd’hui
2.1.
Un acteur politique faible, en permanence contourné mais avec lequel il faut
compter
En
Afrique comme ailleurs, la commune n’est pas une entité désincarnée. Ce
n’est pas une instance neutre, investie de l’intérêt général par la
miraculeuse onction du suffrage. Elle se trouve investie par un ou des groupes
porteurs d’intérêts divers (notables locaux, hommes politiques en quête de
base locale, grands commerçants ou industriels, etc.).
D’autres
groupes issus du mouvement associatif investissent aussi le champ du politique
et du social local (ONG, lobbies et associations diverses, etc.). Ils s’auto-proclament,
souvent, représentants de la population et porteurs de l’intérêt général.
Leurs soutiens extérieurs contribuent à cette « légitimité ».
La
conjonction des intérêts des uns et des autres n’est pas le garant «
automatique » de l’intérêt général. Dans certains secteurs de la vie
municipale, en particulier ceux dont nous traitons (assainissement et déchets),
ces groupes, mais aussi des intérêts privés, ont occupé des créneaux des
filières laissés en vacance. Ils revendiquent assurer des services urbains ou
des segments de service « traditionnellement » de la responsabilité de
l’autorité municipale. Ils veulent d’autant moins en bouger qu’ils en
tirent des revenus et pour beaucoup ceux de leur survie. La confrontation des
intérêts des uns et des autres est au cœur de la question municipale
aujourd’hui. La commune, par sa place dans l’architecture politique et
administrative, est un des acteurs du champ politique.
La
commune est aussi, elle-même, un champ politique : c’est le premier niveau où
peuvent s’exprimer les intérêts des différents acteurs sociaux ou
politiques. Cependant, la commune apparaît aujourd’hui encore comme une
institution faible. Son apparition est, somme toute, récente. Les conditions et
les raisons de cette émergence comportent bien des ambiguïtés. La définition
de ses missions est très large et donc peu précise. La recherche autonome de
ses moyens lui est quasiment toujours refusée et leur allocation par la
puissance publique chichement mesurée. Elle est dépossédée de certaines de
ses prérogatives par ces groupes et intérêts privés qui monnayent
directement leurs services auprès des habitants. Dès lors, elle n’a pas accès
à des ressources qu’il apparaîtrait utile qu’elle puisse mobiliser pour
financer le service qu’elle est censée rendre. Par-là même, elle voit
remise en cause la légitimité du prélèvement fiscal qui est prévu pour ce
faire et se voit vivement reprocher l’inefficacité de ses actions dans ce
domaine. Des procès en légitimité lui sont faits par les habitants et par les
acteurs locaux.
Chaque
fois que ses intérêts sont en jeu, l’Etat tient peu compte de son existence.
Face à l’Etat, les communes en Afrique commencent seulement à se constituer
en groupe de pression (Cf. la résolution des communes africaines lors d’Africités
3 à Yaoundé en décembre 2003 pour la constitution du « Conseil des communes
et régions africaines »).
Toutefois,
dans le champ politique local, celui de son exercice et celui qui nous intéresse,
elle est un acteur imposé et imposant. A ce double titre, quelles que soient
les critiques qu’elle subit, elle est, aujourd’hui, un acteur avec lequel
les groupes et intérêts locaux doivent compter. Il est significatif que tous
les équipes de recherche, dans leurs analyses, s’y réfèrent comme à un
acteur majeur, voire incontournable.
 2.2.
Un service à rendre mais lequel ?
2.2.
Un service à rendre mais lequel ?
La
gestion des déchets et de l’assainissement urbain est, probablement, le
service urbain sur lequel quasiment tout le monde (populations, experts,
bailleurs, opérationnels, etc.) s’accorde à reconnaître une responsabilité
aux collectivités locales et, en premier rang, aux communes. Même si, au cours
des dernières décennies, leurs compétences et leurs prérogatives dans ce
secteur ont été mises en doute, contestées, voire contournées (« les
expériences de la collecte domiciliaire se sont fondées sur le contournement
de la coercition publique pour lui préférer le recours au marché »,
IRD-D08).
Ici,
un clivage apparaît entre la perception de ce domaine d’intervention par le
monde des « experts » (chercheurs, techniciens, décideurs, bailleurs) d’une
part, et par les municipalités[1]
d’autre part.
Les
matériaux à traiter ont conduit, depuis fort longtemps, les ingénieurs à
identifier deux filières : celle des déchets solides et celle des déchets
liquides – au départ essentiellement les excréta. La nature des déchets a
conduit les ingénieurs à appliquer des procès techniques de traitement différents
dans ces deux filières[2].
La
technique du réseau d’égouts, privilégiée pour l’évacuation des excréta
dans les premières grandes villes équipées (Londres, Paris), a fait école. Nécessitant
un apport important d’eau, c’est bien naturellement que la question de
l’assainissement (les excréta et eaux usées) a été étroitement liée à
celle de la distribution de l’eau.
Dans
le cadre du présent programme, l’opportunité de rapprocher ces deux filières
(déchets liquides, déchets solides) a été saisie[3]
par les rédacteurs (Comité scientifique) de l’appel à propositions. Cette
approche nouvelle a permis des avancées dans l’analyse comparée du
fonctionnement des deux filières (cf. dans cet ouvrage « Une autre approche
possible de l’assainissement urbain » par TA Thu Thuy, ci-avant). Mais cette
approche, nécessitée par les besoins de la recherche, ne correspond pas à
celle des municipalités, pas plus que l’approche filières d’ailleurs. La
perception de cette question par les municipalités diffère. Les procès
techniques ne déterminent pas l’approche des autorités municipales.
La
question que se posent les municipalités et qui leur apparaît de leur
responsabilité est celle de la mise en œuvre d’un service de nettoiement de
la ville.
Si
on s’attache à cette approche, on constate que les deux filières
assainissement et déchets n’ont pas la même place dans les préoccupations
des autorités municipales. L’évacuation des déchets solides, peut-être
parce que c’est la partie la plus visible de la « saleté » de la ville, est
une préoccupation majeure des municipalités. Elle est souvent associée au
balayage de la voirie. L’objectif, ici, est celui de la propreté de la ville,
propreté qui ne s’arrête pas au seul enlèvement des ordures ménagères.
L’appel
à propositions ne faisait pas référence à cette entrée de la propreté dans
la ville. Même si quelques équipes relèvent le lien : déchets ménagers /
balayage, aucune équipe n’a traité de ce lien. Toutefois, l’une d’entre
elles (Shadyc-A04) s’est intéressée à la salissure de la ville et l’Etude-AfD
évoque la question du nettoiement.
Quant
à l’assainissement, il ne semble pas être une préoccupation de premier rang
pour les autorités municipales. Certes, un certain nombre de villes disposent
d’un réseau d’égouts. Mais celui-ci dessert toujours une portion
d’espace des plus limitées. Pour les communes qui en disposent, le
fonctionnement et la maintenance de ce réseau et des stations de traitement
font toujours problème.
Très
vite, il est apparu que les villes n’avaient pas et n’auront pas les moyens
de développer le réseau à la vitesse du développement exponentiel de leur
espace habité. Devant cette impossibilité, c’est le modèle de
l’assainissement autonome qui a été reconnu dès les années 70 comme le
seul capable de résoudre le problème des excréta et des eaux usées sur
l’ensemble de l’espace urbain. L’immense majorité de l’espace urbain
relève de l’assainissement autonome installé sur la parcelle. Dans les
situations les meilleures, l’évacuation de ces excréta a suscité un service
privé de vidange, manuel ou mécanique. Ce système semblant fonctionner sans
trop de heurts, les municipalités ne se trouvent saisies de la question qu’au
dernier segment de la filière lorsque le devenir de ces excréta pose la
question du lieu de leur dépotage et de leur traitement. Toutefois, le déversement
des eaux usées dans l’environnement de proximité (eaux sales, stagnantes sur
la voie publique, rejets dans le réseau hydrographique) comme la pollution des
nappes par les infiltrations participent de cette dégradation de
l’environnement de plus en plus ressentie par les habitants.
Ainsi,
pour les municipalités, si l’enlèvement des déchets est au cœur du service
de nettoiement, l’assainissement ne l’est pas. Par contre, dans un grand
nombre de villes, l’évacuation des eaux pluviales est une des préoccupations
majeures. Les risques que représentent les pluies torrentielles sont bien
connus et redoutés : ravinement des talwegs, dégradation de la voirie,
inondations, pollution des sources d’eau potable, ponceaux et maisons emportées,
voire mort d’homme.
Cette
différence de perception ne va pas sans poser de problème. Les bailleurs, en
particulier, n’interviennent presque toujours que sur les segments les plus
techniques de l’une ou de l’autre filière (camions bennes, station de
traitement, etc.).
La
question de l’assainissement (sensu lato :
non seulement excréta, eaux usées, déchets liquides et eaux pluviales, mais
aussi déchets solides et nettoiement) est rarement envisagée dans sa globalité.
Il
paraît important que cette approche globale soit prise en compte dans des
travaux ultérieurs.
Le
processus de décentralisation en cours a comme fondement un transfert de
responsabilités vers les collectivités locales et plus particulièrement en
direction des communes pour un certain nombre de services de base, dont
l’assainissement et l’enlèvement des déchets. Ce transfert doit être
accompagné du transfert des moyens correspondant aux besoins des collectivités
locales.
3.1.
Le virage des années 90 et ses retombées sur la gestion des services
Le
contexte nouveau, décrit plus haut, s’est traduit, au niveau des communes,
par une série d’effets.
Le
désengagement de l’Etat
Avant
le mouvement de décentralisation, l’Etat exerçait l’ensemble des
responsabilités. Il mettait en œuvre des moyens qui se sont très vite révélés
insuffisants face à la croissance de la population et de ses besoins. Ces
moyens étaient répartis par la puissance publique sur des critères
politiques, les capitales d’Etat étaient toujours mieux dotées que les
autres villes, le poids politique des notables jouait.
L’idéologie
libérale qui fonde la nouvelle politique impose aux Etats de se cantonner à
leurs fonctions régaliennes. Les économistes ont démontré que, dans ces économies
en voie de développement, l’accumulation primitive du capital se fait dans la
sphère de l’Etat. Son périmètre devenu plus restreint ainsi que
l’appauvrissement de ses ressources ne le conduisent-il pas à renvoyer
l’objet « ville » hors de la sphère de l’action publique ? Il n’est pas
étonnant que le Pouvoir mesure si chichement l’allocation de ressources aux
communes, quand ces ressources sont si nécessaires au niveau central. Si un
nouvel espace politique est bien ouvert aux ambitions, c’est la cour de récréation
des petits et celle des petits moyens.
Les
responsabilités sont décentralisées mais les moyens sont toujours attribués
par la puissance publique sans que des règles claires soient fixées et que les
besoins des communes fassent l’objet d’une évaluation sérieuse.
L’émergence
de l’exigence
Le
nouveau mode de « gouvernance » qui impose de faire appel à la participation
des habitants ne se manifeste pas toujours au départ par un dialogue
constructif, mais ouvre quelquefois la porte à une contestation de l’autorité
municipale et de ses actions. Cette liberté de parole se traduit tout
naturellement par l’émergence d’exigences. Le champ politique local devient
alors le champ clos des dissensions. La commune n’en est pas l’arbitre, elle
n’est qu’un des combattants.
La
prise en charge par les opérateurs associatifs et le secteur privé de parties
du service
Il
s’agit : pour les ordures ménagères, essentiellement de la pré-collecte qui
est assurée par des opérateurs associatifs dans les quartiers populaires
difficiles d’accès ou d’extension récente (souvent en périphérie) ; pour
les eaux usées et les excréta, du créneau de l’évacuation (transport et évacuation
des boues de vidange par exemple) assuré par les petites entreprises privées.
Un
changement dans le mode de « Faire »
L’idéologie
de privatisation/libéralisation induit une substitution de la doctrine
municipale du « faire soi-même » (régie municipale) par celle du « faire
faire » (délégation, concession, privatisation).
Ce
contexte impose l’apprentissage d’un « savoir-faire » nouveau, non
seulement technique, mais aussi, et surtout, politique et institutionnel
(IRD-D08).
3.2.
Faire soi-même, faire-faire ou contrôler ?
Son
statut de collectivité décentralisée permet à la commune d’assurer un rôle
de maître d’ouvrage d’un service urbain. Pour assumer cette responsabilité
nouvelle, on doit en effet se rappeler que la municipalité peut choisir :
–
de réaliser elle-même : en régie directe ou par un organisme public communal
;
–
de faire faire : par délégation, concession, affermage (passation de marché
avec cahier des charges) ou par un contrat de service (par exemple, un contrat
de sous-traitance d’une partie du service).
Mais
elle peut aussi se cantonner à exercer un rôle de contrôle de l’activité
des opérateurs privés en édictant normes sanitaires, conditions d’exercice,
règlements de santé publique. Elle n’entretient pas de lien juridique avec
ces opérateurs privés, ni de dialogue institutionnel et ne dispose alors que
du seul pouvoir de verbalisation. Cette situation se rencontre encore fréquemment
en Afrique, chaque fois que les communes n’ont pas mis en place de modus
operandi avec les acteurs du service.
En
fait, ces trois solutions sont théoriques.
Faire
soi-même
Aucune
municipalité ne peut, semble-t-il aujourd’hui, quels que soient ses moyens,
prendre en charge l’ensemble du secteur assainissement/déchets. Ceci pour
plusieurs raisons :
–
la première est la diversité même des modes d’assainissement et d’enlèvement
des déchets ;
–
la seconde est la diversité, toujours grandissante, des effluents et déchets
à traiter (déchets et effluents domestiques, déchets industriels de tous
types, déchets hospitaliers, effluents chimiques de tous ordres). Cette
diversité se traduit par un éventail élargi des dangerosités mais aussi par
des possibilités accrues de recyclage à différents niveaux (domestiques ou
industriels).
Dès
lors, cette diversité nouvelle impose une spécialisation de la prise en charge
et du traitement. Il ne s’agit plus du seul ramassage des déchets ménagers
mais d’une série de services spécialisés à mettre en œuvre.
Cette
spécialisation selon le déchet ou l’effluent impose des investissements spécifiques
et des compétences particulières qui ne sont plus à la portée des services
municipaux.
Faire-Faire
Dans
le secteur des déchets et de l’assainissement, l’apparition des opérateurs
de services urbains, quelle que soit leur forme (ONG, associations, petites
entreprises, mais aussi grands groupes industriels) est un phénomène
relativement récent dans les pays qui nous concernent (les années 80, même si
certains grands groupes ont obtenu des concessions de service public dès les
indépendances).
Ce
phénomène est, certes, porté ou amplifié par la vague de l’idéologie libérale
mais, outre les raisons développées plus haut (diversification et spécialisation),
il faut bien admettre qu’il correspond à un échec du « Faire soi même ».
Le
principe même de l’économie libérale implique que le service ainsi rendu
soit suffisamment rémunérateur. Quel que soit celui qui paye le service
(commune, entreprises, citadins), il faut que l’opérateur du service puisse
financer l’ensemble de ses coûts, son effort permanent d’adaptation à la
demande, ses investissements et leur renouvellement et générer, éventuellement,
du profit. Certes, les logiques de ces opérateurs sont diverses : certains
cherchent à aider les populations à s’organiser et à vivre dans un meilleur
environnement, d’autres, les entreprises, recherchent légitimement un bénéfice
financier, d’autres encore défendent des intérêts collectifs, voire
corporatistes.
Or,
dans les pays qui nous occupent, il est notoire que seules certaines parties très
précises de la demande ont un taux de solvabilité suffisant. Ce sont
d’ailleurs ces créneaux qui ont été occupés lorsque la demande est devenue
solvable. L’exemple le plus illustratif est celui des camionneurs vidangeurs.
D’autres séquences du secteur commencent à peine à être solvables (la pré-collecte)
tandis que d’autres ne le sont pas du tout (la gestion des dépôts intermédiaires,
le traitement final, etc.).
Ainsi,
aujourd’hui, si aux yeux de tous et tout particulièrement des citadins, la
municipalité est responsable de l’ensemble du secteur, les parties solvables
de la demande sont de fait déjà prises en charge par ces opérateurs privés
ou issus du monde associatif.
Les
municipalités se sont trouvées dépassées par l’émergence de ces acteurs
nouveaux qui ont la particularité de demander directement au citadin la rémunération
de leurs services. Elles tentent aujourd’hui de les organiser et de les
encadrer (attribution des zones de pré collecte, fixation des tarifs appliqués
aux usagers, ce qui revient à fixer les termes d’une mini concession).
Contrôler
Les
municipalités pourraient exercer un contrôle si l’édiction des normes
sanitaires ou des règlements de santé publique étaient de leur autorité. Or,
ces normes et règlements appartiennent, pour leur établissement ou leur rénovation/adaptation,
à des services de l’Etat souvent bien loin du terrain municipal. Ce corpus
existe quelque part, enfoui dans les couches sédimentées de
l’administration. Il semble bien oublié ou considéré comme bien peu
efficace. Des lois récentes, comme la loi cadre sur l’environnement au
Cameroun (1994), attendent toujours leurs décrets d’application.
Certes,
les communes devraient constituer un code de salubrité qui permettrait de
sanctionner les infractions. Peu de communes en disposent et plus rares encore
sont celles qui ont les moyens de le faire appliquer. Certaines villes ont créé
ou laissé s’installer des polices de l’environnement (Zangbéto vs
Police environnementale à Porto Novo,
IRD-D08). Certaines ont suscité des groupes de surveillance (comités de
surveillance des dépotoirs à Lomé, Eamau-D10).
Toutefois,
la question des déchets et de l’assainissement ne peut être résolue par la
seule sanction. Aucune équipe de recherche n’a mis en avant ce type de
politique. Personne ne s’en réclame, ni même n’envisage ce code de
salubrité comme outil ou comme contrainte. L’absence totale dans les travaux
du programme de référence à des approches, voire à des actions de santé
publique, est de ce point de vue aussi, significative.
4.
Vrais et faux débats, premiers enseignements
Un
premier faux débat peut être tranché : il n’y a pas antinomie entre service
public et opérateurs privés. Dans la plupart des pays du Nord, un grand nombre
de services publics urbains (eau, déchets, transports) sont assurés par des
sociétés privées. C’est le contrat entre la collectivité publique et
l’opérateur qui fixe les règles de fonctionnement du service.
Il n’y a pas incompatibilité mais complémentarité entre les trois approches : « faire soi même », « faire faire », « contrôler ».
Nous
avons vu que la collectivité locale ne pouvait pas tout faire elle-même. Dans
le partage des tâches qui s’impose, elle peut prendre à sa charge une ou
plusieurs des séquences du secteur ou une partie de l’espace urbain. Il
serait souhaitable qu’elle ne le fasse que si, et uniquement si,
l’efficience de ses services est la meilleure sur cette séquence. Certaines régies
municipales agissent avec efficacité sur des parties du secteur et à un coût
très comparable au secteur privé (Cf. Etude-AfD).
La
commune devra continuer à prendre en charge le service là où aucun opérateur
privé n’est présent. La stratégie de la commune pourrait être de se dégager
des séquences ou des terrains sur lesquels des opérateurs privés seraient
plus compétents et plus compétitifs.
D’autre
part, elle a besoin de s’appuyer sur des opérateurs privés pour toute une série
de tâches spécialisées, pour lesquelles ils disposent de compétences spécifiques.
Elle se doit de créer un environnement favorable à l’émergence et au
fonctionnement de ces opérateurs privés. Il va de soi qu’au-delà du contrat
à établir avec l’opérateur, il est nécessaire qu’elle fixe, et fasse
respecter par tous, un code de salubrité. La responsabilité de la commune
n’est pas d’assurer le service public de l’assainissement et des déchets
mais de faire en sorte que ce service soit assuré avec une efficacité
maximale, au moindre coût et de façon pérenne. A elle de trouver les
meilleurs outils et la bonne combinaison du « faire soi-même », du « faire
faire » et du « contrôle ».
4.2.
Quel positionnement pour la commune ?
Cette
responsabilité « faire assurer le service public » implique que l’ensemble
du secteur et son organisation soient sous son autorité.
Deux
conditions doivent être réunies pour qu’elle puisse exercer cette
responsabilité :
–
une édiction claire et publique de son autorité sur le secteur. Cette énonciation
ne peut venir que de la puissance publique. Elle doit être admise et relayée
par tous les acteurs du secteur (en particulier bailleurs et ONG) ;
–
les municipalités doivent disposer de l’ingénierie technique, financière et
juridique du contrat. A ce titre, elles ont plus besoin d’appui dans ce
domaine (capacity building)
que de propositions techniques.
Dans
la mise en œuvre au quotidien de cette responsabilité, le positionnement de la
commune fait débat. Faut-il qu’elle se positionne comme l’autorité
contractante ou qu’elle délègue ce rôle à une structure publique ou
semi-publique ? L’intérêt d’une telle structure serait de :
–
construire, rassembler et concentrer les compétences techniques dans un
organisme auquel la maîtrise d’ouvrage est déléguée ;
–
donner un interlocuteur compétent aux différents acteurs du secteur ;
–
traiter de l’ensemble de l’agglomération, en allant ainsi au-delà des découpages
administratifs nuisibles à la continuité du service ;
–
décharger les autorités municipales des tâches techniques ou de gestion pour
leur garder leur rôle politique : la définition d’une stratégie et de
politiques dans le secteur de l’assainissement et de l’enlèvement des déchets
;
–
positionner les autorités municipales comme arbitre.
A
la « réussite » de la MUWSA de la ville de Moshi (Tanzanie, Moshi-A05b) on
peut opposer les aléas à Dakar d’abord de l’Agetip (Agence d’Exécution
des Travaux d’Intérêt Public), puis de l’Aprodak (Agence pour la propreté
de Dakar).
Toutefois,
si la mise en place de telles structures peut se révéler efficiente dans les
grandes agglomérations, elle est, très certainement, beaucoup plus difficile
dans des villes petites ou moyennes (difficulté à rassembler des compétences,
etc.).
5.
Aujourd’hui, des objectifs, une stratégie, des points d’application
La
description de la situation, brossée à grands traits, peut paraître sévère,
voire pessimiste. Or, les avancées sont certaines :
–
le mouvement communal progresse et on voit mal aujourd’hui comment il pourrait
être arrêté, même si l’État cherche, dans de nombreux pays, à le freiner
en gardant la haute main sur l’exécutif communal et les moyens, voire même
à rogner les responsabilités concédées ;
–
la mise en place des conseils municipaux génère un corps de notables attachés
à améliorer le cadre de vie de leur commune ;
–
l’autonomie de décision se conforte avec l’élection du maire et la
possibilité pour la commune d’être maître d’ouvrage ;
–
les habitants, même s’ils sont encore très sceptiques, ont des
interlocuteurs et des représentants locaux, relais de leurs desiderata
vers le pouvoir central.
La
commune en Afrique est bien, maintenant, la composante de base de
l’organisation politique, institutionnelle et administrative du territoire.
D’autre part, la situation actuelle n’est qu’un moment dans une évolution
de longue durée, le monde développé a connu aussi le charretier et le
vidangeur.
Les
objectifs de la commune doivent être aujourd’hui :
1.
de renouer un dialogue confiant avec la population à travers le mouvement
associatif ;
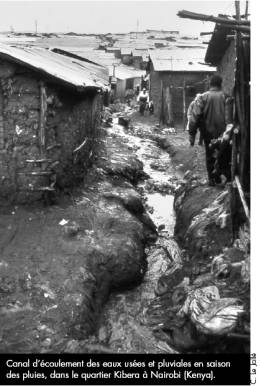 2.
de trouver un modus operandi avec
les opérateurs associatifs et privés du secteur (ONG mais aussi entreprises de
toutes tailles) ;
2.
de trouver un modus operandi avec
les opérateurs associatifs et privés du secteur (ONG mais aussi entreprises de
toutes tailles) ;
3.
et ainsi d’acquérir une légitimité en tant qu’autorité maître
d’ouvrage du service et structure politique représentative des intérêts des
citadins.
5.2.
L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique de gestion des déchets
solides et liquides
Pour
tous les acteurs du secteur, c’est bien la commune qui doit concevoir le plan
global d’élimination des déchets. A ce niveau, son rôle de maître
d’ouvrage de l’ensemble du service public n’est pas contesté, même si un
certain nombre d’opérateurs développent des stratégies d’évitement ou de
contournement.
Ce plan stratégique se doit d’être, d’abord, un outil de concertation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs. Il s’agit de se projeter dans l’avenir en prévoyant des objectifs atteignables avec des rendez-vous fixes qui permettent à l’ensemble des acteurs de faire le point et de vérifier l’état de réalisation des objectifs qu’on s’est donnés collectivement. Il doit proposer des orientations de travail sur chacune des séquences du secteur tout en étant attentif à la cohérence de l’ensemble des actions, y compris spatialement. Il doit porter
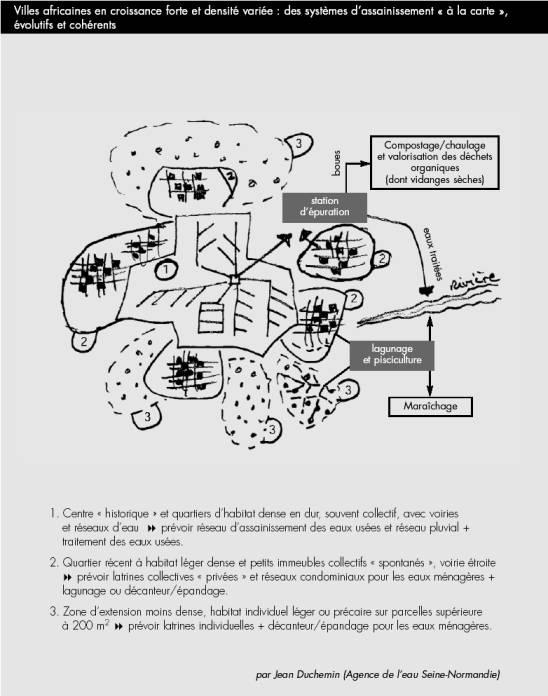
sur l’ensemble de
l’agglomération. Il arrête des choix de politiques, voire, éventuellement,
des choix techniques. Ces choix de politiques à mener, s’ils ont été
soigneusement réfléchis, ne devraient pas être remis en cause tout au long du
plan. Toutefois, il doit rester souple et adaptable, les rendez-vous périodiques
entre tous les acteurs devant servir à confirmer ces choix ou à les infirmer.
Lors de ce bilan d’étape, des changements de politiques doivent être
possibles lorsqu’elles se révèlent erronées ou inefficaces. Ces rendez-
vous doivent aussi servir à affiner les orientations de travail prises. Le plan
définit les modes de relation entre la collectivité locale comme maître
d’ouvrage et les différents acteurs.
Pour
cet exercice, la filière « déchets solides » est généralement découpée
en segments : 1) collecte ; 2) transport ; 3) traitement et élimination ; et
l’espace est découpé en secteurs (Era-D05, Tenmiya-D07, TechDev-D09). Il est
proposé d’utiliser un découpage plus ou moins similaire pour traiter de
l’assainissement (cf. dans cet ouvrage « Une
autre approche possible de l’assainissement urbain »).
L’exercice
d’élaboration d’un tel plan a été évoqué par l’action TechDev-D09 à
Cotonou où la Municipalité a piloté l’étude et la mise en place d’un
système d’évacuation des déchets solides fondé sur le principe de la
gestion partagée. La ville moyenne de Debre-Berhan (Gret-A07) a expérimenté
une planification stratégique concertée pour l’assainissement. Il serait, là,
intéressant de repérer les mécanismes de concertation avec les différents
acteurs et groupes concernés pour impulser cette dynamique de gestion partagée,
maintenant si souvent avancée.
L’action
Moshi-A05b a montré comment dans la collectivité locale de Moshi en Tanzanie,
un office communal autonome, la MUWSA, a reçu mission de planifier l’eau et
l’assainissement en réseau avec l’objectif d’étendre le service. Un
autre exemple de planification est le plan stratégique d’assainissement de
Ouagadougou qui a été élaboré par l’Onea. On peut analyser, à travers
cette opération, les relations entre une collectivité locale et un office
national spécialisé. Ce plan stratégique doit s’imposer comme cadre de
l’action en particulier pour les bailleurs de fonds et les coopérations.
C’est dans ce cadre que doivent s’inscrire les projets financés. Le moment
pourrait être enfin venu de mettre en œuvre un autre mode opératoire que le
« projet », si cher aux bailleurs de fonds.
Comme
les autres acteurs et en respectant les orientations et les choix de la commune,
les bailleurs sollicités pourraient être associés à l’élaboration du
plan. Leur engagement serait alors de la durée du plan, y compris ses étapes
d’évaluation et de bilan. Même limitée par les moyens qu’ils peuvent
mobiliser, leur action aurait la force de la continuité et de la cohérence.
Ils participeraient ainsi à la définition et au financement de politiques et
non plus de projets, toujours ponctuels.
Certes
l’élaboration de ce type de Plan stratégique ne suffit pas à arrêter une
politique publique. Il en forme toutefois le cadre. Si, au moins dans sa première
phase, il est accompagné de la définition des actions visant à sa mise en œuvre,
il en est l’amorce.
5.3.
La question des niveaux spatiaux pertinents
La
question des niveaux spatiaux, mais aussi organisationnels, auxquels devraient
se situer et se traiter les problèmes de l’assainissement et des déchets a
été peu abordée dans les travaux et, en corollaire, la question de l’espace
sur lequel doit s’appliquer le plan n’a pas été posée.
Les
travaux ont montré que le terme « commune » s’appliquait à des espaces très
différents, du quartier de la ville érigé en « commune » à l’ensemble de
la ville, voire à la conurbation urbaine. D’autre part, le découpage en
trois séquences a bien mis en exergue les différents niveaux spatiaux en jeu :
le local, l’intermédiaire et le global.
Un
premier enseignement est que les questions de l’assainissement et de l’enlèvement
des déchets doivent être traitées en recherchant les niveaux pertinents selon
les séquences.
Un
second enseignement est que l’évolution des tissus urbains et en particulier
leur densification imposent à la collectivité territoriale de rechercher des
systèmes évolutifs. (cf. le schéma de Jean Duchemin, autre membre du comité
scientifique, page précédente).
Au
plan local, l’assainissement autonome dans ses diverses formes, de
l’individuel au semi-collectif, est un moment dans la mise en place
progressive d’un système d’assainissement global. Le système
d’assainissement doit en permanence viser à répondre aux différentes
situations et aux besoins, et s’adapter à l’évolution de l’urbanisation.
De même, la pré-collecte des déchets ménagers est, dans certaines
situations, une étape nécessaire. Le plan stratégique doit attacher une
importance particulière à cet amont. On pressent bien que de la qualité de
son fonctionnement dépend (1) le fonctionnement des séquences intermédiaire
et aval, et (2) l’efficacité de l’ensemble du secteur.
L’efficacité
du segment intermédiaire de la filière déchets semble être à rechercher
dans la réduction du temps de séjour des déchets entre l’amont et l’aval.
Le plan devra se préoccuper non seulement de la répartition des dépôts mais
aussi et surtout de prévoir et de mettre en œuvre un système de gestion
courte des déchets à ce niveau intermédiaire.
Çà
et là, d’autres solutions sont proposées : mini condominiums, petites unités
de lagunage, valorisation sur place, etc. Certains font valoir que tout
traitement local minimise les quantités à déplacer et donc le coût des
transports et du traitement final. La recherche devrait continuer à explorer et
à tester des solutions de ce type. Comment la collectivité territoriale
peut–elle traiter autrement la question du traitement ? De nombreux résultats
insistent, à juste titre nous semble-t-il, sur la nécessité d’un traitement
global à l’échelle de la tache urbaine.
Des
raisons techniques sont souvent avancées pour faire valoir que le traitement
final des déchets impose le site unique de traitement (décharge). Pour les
effluents liquides, on peut envisager une approche mixte associant des unités
de traitement décentralisées pour des lotissements ou condominiums, à des
sites de dépotage et de traitement (mini-lagunages) suffisamment proches pour
les camions vidangeurs mais isolés des zones d’habitat, et à des plus
grosses unités pour les réseaux d’égouts centralisés, à la condition impérative
que ces installations soient soumises au contrôle de leur fonctionnement par
une autorité ayant un pouvoir d’injonction indiscuté.
Il
est reconnu la nécessité pour les agglomérations d’une approche concertée
pour la gestion des déchets liquides et solides. Le territoire pertinent pour
une gestion globale est rarement celui de la commune, voire même celui de
l’agglomération. Les décharges et les sites de dépotage ou de traitement se
situent quasiment toujours hors du territoire communal ou de l’agglomération.
Parce qu’il était impossible de les implanter sur le territoire communal,
plusieurs recherches ont relevé la difficulté de trouver de nouveaux lieux de
décharges, de dépotage et de traitement. Pour le moins, l’implantation de
ces sites impose une concertation large des autorités gérant les espaces
concernés. Quant à l’assainissement des eaux pluviales et, pour partie, des
déchets liquides, le territoire pertinent est celui du bassin versant (qui dans
certains cas peut être infra communal).
Au
plan global, plus que des controverses byzantines sur le bon découpage
institutionnel à prendre en compte (commune, district, bassin versant, etc.),
ne devrait-on pas considérer plus simplement que c’est l’ensemble de la
zone de production des déchets et des effluents qui doit être prise en compte
? Même si le volume des déchets et effluents de tous types peut être réduit
au niveau amont, voire au niveau intermédiaire, il restera que c’est à ce
niveau global que se fera le traitement ultime. Des instances traitant
d’espaces plus larges commencent à être mises en place pour gérer ces
questions : communautés urbaines de Dakar, Yaoundé, etc.Ne devrait-on pas
chercher à mettre en œuvre le principe de subsidiarité en recherchant les
niveaux spatiaux et organisationnels les plus efficients ?
Deux
points d’application :
•
l’organisation et la coordination des séquences amont (pré-collecte et
assainissement sur la parcelle) ;
•
la prise en charge directe ou indirecte des séquences intermédiaire
(regroupement, transport) et aval (traitement, élimination).
L’organisation
et la coordination des séquences amont
L’intervention
de la commune dans le segment amont de l’assainissement doit viser à
promouvoir des systèmes d’assainissement individuels améliorés et si
possible évolutifs (latrines collectives, mini-condominiums, raccordement
possible à un réseau, etc.).
Dans
la filière « déchets », l’émergence, la spécialisation et l’intégration
des petits opérateurs de pré-collecte dans les schémas organisationnels ont
permis une certaine maîtrise technique et un relatif équilibre financier de
l’amont de la filière. Toutefois, à moins qu’un encadrement par la
municipalité ne fasse peser sur eux des exigences quant au service rendu, les
conditions d’intervention de ces petits opérateurs indépendants ne
garantissent ni l’équité d’accès aux services, ni la qualité et la
continuité du service, ni les coûts les plus justes pour les populations
concernées.
C’est
pourquoi il apparaît nécessaire que la commune exerce un droit de contrôle
sur cette séquence (édiction et application de règles et de normes). Il lui
appartient aussi d’en assurer la coordination (droit d’exploitation et
zonage), ainsi que la régulation (contractualisation, tarification). Il faut «
faire de la municipalisation et du
renforcement de la capacité municipale, l’objectif prioritaire et préalable
ou au moins parallèle à la multiplication d’initiatives privées »
: « la cohérence générale de la filière,
du domicile jusqu’à la décharge finale et le traitement, impose une action
publique coercitive de conception, d’arbitrage et d’évaluation à la fois
technique et économique » (IRD-D08).

Les recherches et actions pilotes sont riches en expériences et recommandations sur le mode de fonctionnement des petits opérateurs (Comités d’assainissement, ONG, GIE, etc.) et sur leur gestion économique (Hydroconseil-A01, N’Djaména-D01, Era-D05, Tenmiya-D07, TechDev-D09). Ils mettent en avant des modalités de coordination technique et économique de ces petits opérateurs de la pré-collecte dans les quartiers peu accessibles.
•
Les expériences de Cotonou et Lomé montrent l’intérêt que trouvent les
autorités municipales à dialoguer avec des organisations professionnelles
regroupant ces petits opérateurs (TechDev-D09, Eamau-D10).
•
Cet encadrement et cette organisation des petits opérateurs peuvent se faire
efficacement dans le cadre d’un projet avec une ONG jouant un rôle de
facilitation et de médiation avec les pouvoirs publics (Era-D05, Tenmiya-D07).
Mais cela pose la question cruciale de la pérennisation du système à la fin
du projet.
•
Cette organisation par la municipalité au niveau de l’agglomération peut
amener à effectuer un zonage, avec affectation de zones de collecte aux opérateurs,
assorti d’une réglementation d’exploitation et d’une tarification comme
cela est fait à Cotonou (TechDev-D09) et Porto Novo (IRD-D08). Cette question
reste en débat : le zonage ne supprime-t-il pas une compétition dans la
recherche du client, facteur d’une amélioration du service rendu ?
•
Les contrats de services avec les pré-collecteurs peuvent être passés
directement par la municipalité (les charretiers à Nouakchott, Tenmiya-D07) ou
indirectement par le biais d’un projet (Era-D05).
La
prise en charge directe ou indirecte des séquences intermédiaire et aval
Dans
les grandes agglomérations d’Afrique, s’il existe des régies municipales,
rares sont celles qui gèrent l’ensemble des services (assainissement et déchets).
Par contre, ces services peuvent faire l’objet, en totalité ou partiellement,
de concessions censées couvrir l’ensemble de l’agglomération (Yaoundé,
Era-D05) ou une partie, (Fès Agdal, Cittal-D02). Dans les deux cas
d’ailleurs, il s’agit de la filière « déchets solides », essentiellement
de l’enlèvement des ordures ménagères. Il est, là, intéressant de
s’attarder sur la nature de la contractualisation entre le prestataire et la
municipalité et son évolution, passée d’un contrat de moyens ou de service
rendu (paiement à la tonne, Era-D05) à un contrat d’objectifs plus adaptable
aux évolutions de la demande (Cittal-D02). On s’interrogera nécessairement
sur les capacités et les modalités d’articulation entre ces systèmes
centraux et les systèmes de pré-collecte périphérique (Era-D05).
Si
on exclut la séquence amont, qui dans la plupart des cas fait l’objet d’un
paiement direct, les deux autres séquences génèrent des coûts qui sont censés
être pris en charge par le budget de la collectivité locale et deviennent, de
ce fait, de la responsabilité de gestion de celle-ci. Ces deux systèmes de récupération
des coûts, l’un direct pour la partie amont, l’autre indirect pour
l’aval, induisent, de fait, un positionnement et un rôle différent pour la
municipalité, en particulier tant que les articulations amont/intermédiaire et
intermédiaire/ aval restent incertaines.
Même
si techniquement ces deux dernières séquences, intermédiaire et aval,
paraissent plus faciles à mettre en œuvre, il reste que leur coût pèse
lourdement sur les finances municipales.
Dans
ce schéma, peuvent ainsi être considérés comme demandant une implication
forte de la municipalité, tant en termes d’organisation qu’en termes de
financement, la gestion :
1.
des points de regroupement et dépôts intermédiaires d’ordures ;
2.
des points de dépotage des effluents et de leur traitement ;
3.
des transports des déchets à la décharge ;
4.
de la décharge.
Les
exemples de traitement par la collectivité de ces séquences sont riches dans
le programme de recherche. On notera particulièrement :
–
l’aménagement des points de regroupement par la municipalité de Lomé avec
une mise en concession auprès des ONG sous le contrôle des comités
d’habitants (Eamau-D10) ;
–
la mise en appel d’offres du transport, depuis les zones de collecte jusqu’à
la décharge, auprès des transporteurs organisés en syndicats professionnels
à Cotonou (TechDev-D09) ;
–
la valorisation des déchets liquides et solides (co-compostage) à Kumasi, la
ville ayant aménagé la station et créé un consortium pour sa gestion
(Iwmi-A09) ;
–
la création du Cervad par la Ville de N’Djaména et la contractualisation
avec le milieu industriel pour la récupération de déchets spéciaux (N’Djaména-D01)
;
–
la gestion du réseau d’assainissement de Moshi par la MUWSA notamment sous
contrôle de la municipalité (Moshi-A05b).
6.1.
Un préalable : la connaissance des pratiques des habitants, de la nature des déchets
et des quantités produites
Plusieurs
études (N’Djaména-D01, Ceda-D03, IRD-D08) ont insisté sur l’importance au
départ de connaître plusieurs paramètres :
•
Les attentes des habitants
: dans l’édilité de leur lieu de vie, les habitants ont des priorités. Ce
n’est pas nécessairement l’assainissement ou l’enlèvement des déchets
qui arrivent en tête de ces priorités. L’étude Ceda-D03 montre que la régularisation
foncière était la priorité des habitants de Togoudo. Il ne s’agit pas, à
ce stade, de faire émerger une demande mais de voir comment des actions en matière
d’assainissement et de déchets peuvent s’inscrire dans ces attentes et
prendre place dans leurs priorités.
•
Les connaissances des habitants vis-à-vis
de l’assainissement et des déchets :
l’étude Ceda-D03 a bien montré le décalage qui pouvait exister entre le
corpus de connaissances des décideurs et techniciens et celui des habitants.
•
Les pratiques
: les études ont montré qu’une partie importante des déchets et des boues
de vidange était utilisée, voire valorisée : fumure des champs, remblaiement
de type poldérisation (Porto Novo et Mopti), remblaiement des ornières de la
voirie. Dans certaines villes de l’aire soudano-sahélienne, aucun déchet
n’arrive à la décharge.
•
La quantité de déchets à récolter
: elle dépend des pratiques et de la nature des déchets. Dans beaucoup de
villes africaines, l’essentiel des déchets à récolter sont des déchets végétaux,
ceux-là même qui peuvent être facilement utilisés pour la fumure (après
compostage ou non).
Pour
ce faire, les communes peuvent, aujourd’hui, faire appel à une ingénierie
africaine (Grandes écoles, bureaux d’étude, ONG).
6.2.
Des nouveaux métiers à apprendre
L’exigence
mise en avant d’un mode de gouvernance nouveau, impose aussi l’apprentissage
de métiers jusque-là peu pratiqués. Très différents, tant dans les concepts
utilisés que dans les outils maniés, ils sont souvent abusivement présentés
comme une boîte à outils unique et d’usage simple au service de la
collectivité territoriale. Qu’y a-t-il de commun entre animation, réglementation,
encadrement, régulation, édiction de normes, etc. ? Pour exercer ces missions,
il s’agit bien, en effet, de nouveaux métiers à apprendre.
 Devant
travailler avec un grand nombre de partenaires de statuts très divers, on voit
toute l’importance pour les communes d’acquérir une culture du « contrat
»[4]
Ce devrait être une des pistes de renforcement de leurs compétences :
formation à la rédaction du contrat quelles qu’en soient ses formes (délégation,
concession, etc.), formation à la négociation, formation à la gestion de ces
contrats et à l’évaluation de leurs résultats. L’exemple de Fès Agdal
(Cittal-D02) a montré combien pesait la nature du contrat initial et les
efforts nécessaires pour le faire évoluer vers un contrat d’objectifs plus
adapté au site et à la situation à traiter. Dans ce cas il a été nécessaire
qu’interviennent, en médiateurs, des acteurs extérieurs disposant de compétences
Devant
travailler avec un grand nombre de partenaires de statuts très divers, on voit
toute l’importance pour les communes d’acquérir une culture du « contrat
»[4]
Ce devrait être une des pistes de renforcement de leurs compétences :
formation à la rédaction du contrat quelles qu’en soient ses formes (délégation,
concession, etc.), formation à la négociation, formation à la gestion de ces
contrats et à l’évaluation de leurs résultats. L’exemple de Fès Agdal
(Cittal-D02) a montré combien pesait la nature du contrat initial et les
efforts nécessaires pour le faire évoluer vers un contrat d’objectifs plus
adapté au site et à la situation à traiter. Dans ce cas il a été nécessaire
qu’interviennent, en médiateurs, des acteurs extérieurs disposant de compétences
autres
(management et sociologie des relations entre acteurs). L’accompagnement du
projet par une équipe de recherche a ainsi démontré l’intérêt d’un
suivi mobilisant des compétences dont ne disposaient pas les deux contractants,
municipalité et opérateur.
Dans
l’exercice de la responsabilité de la commune sur les services urbains, ces
mutations sont déstabilisantes. Elles peuvent avoir pour effet de rendre moins
lisible par le citoyen l’action de la municipalité. De ce fait, sa
contribution à la fiscalité locale et l’exercice de l’autorité municipale
en matière d’hygiène et de propreté peuvent lui apparaître mal justifiés.
Dans
un certain nombre de pays coexistent aujourd’hui une redevance, acceptée car
paiement du service immédiatement visible rendu par les petits opérateurs privés
et un prélèvement fiscal lointain sans justifications visibles. Cette
cohabitation ambiguë est-elle viable à long terme ? Est-elle déontologiquement
acceptable ? Le citadin a l’impression de payer deux fois pour un service
somme toute encore très médiocre. D’autant plus que les quartiers de
standing disposent généralement d’un service gratuit (réseau d’égouts et
camion à benne tassante) alors que les habitants des quartiers les plus pauvres
doivent payer pour un service bien moins performant. L’iniquité de cette
situation est flagrante.
Un
point positif maintenant bien établi (Cereve-A05a) est la volonté de payer
pour un service effectivement rendu, que ce soit pour la vidange des fosses ou
pour l’enlèvement des ordures ménagères. Les études menées ont même
permis de calculer l’effort financier que les populations acceptent de faire
en fonction de leur niveau de vie, même des populations à faibles revenus
indiquant être prêtes à fournir un effort.
Toutefois,
cette redevance payée directement par l’habitant a une caractéristique très
particulière : elle rémunère un service partiel, celui de l’enlèvement, et
uniquement celui-là. Le citadin paye, en quelque sorte, pour voir disparaître
de sa parcelle ou de devant sa porte ses excréta et ses déchets. A partir du
moment où il ne les voit plus, leur devenir ne le soucie plus. Il ne réagira
à nouveau que si ces déchets réapparaissent dans le cercle d’espace plus
large qu’il fréquente au quotidien (dépotage dans des caniveaux ou des fossés,
dépôts intermédiaires persistants). Le financement des segments en aval
n’est pas assuré par ce type de paiement direct.
Si
cette redevance existe, les opérateurs privés qui occupent une partie du
secteur ne devraient-il pas, à leur tour, en verser une au segment immédiatement
en aval qui enlève et/ou traite les excréta et déchets? Un système de
cascade de versements, dans une filière fonctionnant sur un modèle marchand,
ne devrait pas être inconcevable. On n’en est, semble-t-il, pas loin dans le
système de la vidange mécanique. Certaines entreprises de vidange à Yaoundé
acceptent de verser 5 000 FCFA par camion de 4 m3 déversé dans un site privé
de dépotage. Des ONG de pré-collecte se déclarent prêtes à prendre en
charge les sites de dépôts intermédiaires. Dans certaines conventions
(Nouakchott, Tenmiya-D07), il est prévu qu’une partie de la redevance perçue
par l’ONG soit versée à la municipalité pour financer l’aval. Dans un
système marchand, le rôle de l’autorité municipale serait simplifié : édiction
de normes sanitaires, police des installations, définition (prescriptive ou
indicative) des niveaux de redevances et surveillance du marché pour éviter
les abus ou les monopoles. Un certain nombre des dysfonctionnements de la filière
pourraient disparaître. Mais nous avons vu que les segments intermédiaire et
aval sont encore loin d’être solvables. Un système de redevance directe ne
suffit pas. Le traitement final des déchets et excréta n’est pas financé, même
pas son fonctionnement.
C’est
pourquoi le financement du secteur s’appuyant pour tout ou partie sur un prélèvement
fiscal mérite un examen plus approfondi. Certes, les communes disposent de
toute une batterie de taxes et recettes réglementaires, mais le taux de
recouvrement est faible. Il en va de même pour le prélèvement par l’impôt.
L’assiette de l’impôt est réduite et l’évasion fiscale importante.
Durant le séminaire de Yaoundé, la quasi totalité des présents souhaitait
qu’en préalable à toute taxe nouvelle un sérieux effort soit fait, d’une
part pour que les règles de reversement aux communes soient transparentes et
permanentes, d’autre part, pour que l’assiette et le taux de recouvrement
des recettes actuelles soient élargis. L’identité des contributeurs actuels
n’est pas à ignorer. Il s’agit des entreprises et des gros contribuables.
Par ce biais une péréquation peut se mettre en place pour développer le
service en direction des plus démunis. L’équipe d’Era-Cameroun (Era-D05)
cite les conclusions de la commission interministérielle sur l’enlèvement
des ordures ménagères de 1995, qui proposaient l’instauration d’une taxe
d’enlèvement des ordures ménagères indexée sur les factures d’électricité.
Ceci permettrait à la ville de Yaoundé de collecter entre 1 et 1,5 milliard de
FCFA de recette par an, ce qui représenterait déjà 40 à 60 % du coût du
service. Des solutions de ce type existent soit sur la base des factures d’eau
pour l’assainissement (Moshi-A05b ou PSAO au Burkina Faso), soit sur la base
des factures d’électricité pour les déchets solides (cf. « Le financement
de l’assainissement solide et liquide en Afrique. Considérations générales
», par Alain Mathys ci-avant). Ce prélèvement sur la facture d’électricité
ou d’eau est généralement proportionnel à la consommation. Il permet ainsi
une répartition des contributions en rapport, certes indirect, avec les niveaux
de vie. Il faut noter que ce type de prélèvement ne fait que se substituer, de
par son automatisme, à l’incapacité de l’Etat à faire rentrer les impôts
locaux.
Il
restera aussi à savoir si les sommes dégagées par le biais de ces taxes
pourront couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement et
d’investissement nécessaires pour assurer le service. Les exemples actuels
rassemblés dans l’étude AfD montrent que c’est loin d’être le cas : «
à Dakar, la dépense est 2,4 fois supérieure au montant de la TEOM, au Burkina
les recettes de la redevance pour les ordures ménagères sont nulles à
Bobo-Dioulasso et quasi nulles à Ouagadougou ».
Le
prélèvement par l’impôt donne de bien meilleurs résultats lorsque les
communes peuvent appuyer le prélèvement de leurs recettes fiscales sur une
base d’imposition foncière (Cotonou).
Deux
orientations pourraient être données à ces taxes et recettes :
–
la couverture de l’ensemble de l’espace urbain et, en particulier, des
quartiers les plus démunis ;
–
la couverture du fonctionnement du secteur.
Ces
ressources devraient donc être des ressources affectées. Une répartition
entre fonctionnement et équipement sous la forme d’un pourcentage fixe
devrait être arrêtée afin que l’extension du service ne soit pas sacrifiée.
Par
contre, il faudrait continuer à rechercher les investissements lourds, qui représentent
des sommes souvent très importantes, auprès de bailleurs de fonds
internationaux ou par le biais d’une banque d’équipement des collectivités
locales. La séquence aval (mise en décharge et traitement), actuellement très
mal dotée, doit être la première bénéficiaire de ces investissements. Il
faudra convaincre les bailleurs, toujours séduits par la technicité,
d’accepter de financer les stations de lagunage et autres systèmes rustiques
adaptés à chaque contexte ; systèmes qui se révèlent opérationnels à
faible coût et ne nécessitent qu’une maintenance légère.
La
séquence aval, moins directement visible, doit devenir dans les prochaines années
une préoccupation importante des municipalités. Une fois de plus, il ne
s’agit pas de « faire soi-même » mais de chercher à « faire faire », de
rechercher des solutions faisant appel à l’initiative privée. Il existe
ainsi des exemples d’entreprises mettant en œuvre des stations de traitement
à Yaoundé, Cotonou, etc. décharges, lagunages), ou Kumasi (compostage). Le rôle
de la commune est alors de piloter un système de financement qui permet à la séquence
de la mise en décharge et du traitement de ne plus être le parent pauvre du
secteur. Plus qu’ailleurs peut-être, le financement du fonctionnement de
cette séquence aval doit chercher à associer, autant que possible, recettes
fiscales et redevances payées par les utilisateurs de cet aval. L’acceptation
par les vidangeurs de payer pour dépoter dans des sites prévus à cet effet
montre la voie.
Certains
proposent de continuer à faire coexister redevance directe pour les segments
pris en charge par les petits opérateurs privés et prélèvement fiscal au
profit de la commune (ENSP-A08). Cette coexistence n’a de sens que si les
citadins constatent de visu l’intervention
de la commune, en particulier une amélioration rapide des segments intermédiaires
(dépôts intermédiaires et transports).
D’autres
pistes doivent être suivies. Le principe « pollueur payeur » pourrait être
affirmé au niveau national. Il pourrait être appliqué aux entreprises
industrielles et aux entreprises de service, importantes productrices de déchets.
Des filières spécialisées pourraient être mises en place pour traiter ces déchets
spécifiques. Elles devraient être financées directement par les entreprises.
A ce sujet, on ne saurait trop insister sur la création d’une filière spécialisée
pour les déchets hospitaliers, financée par les producteurs de ces déchets
particulièrement dangereux.
Dans
les villes africaines, un marché foncier et immobilier existe et il est très
lucratif. Il est quelque part anormal qu’il ne contribue pas financièrement
à l’équipement de la ville alors qu’il participe à son extension
(logements, voiries) et suscite une consommation accrue en services urbains.
Enfin,
toutes les possibilités de cofinancement entre commune et « collectifs usagers
»[5]
doivent être recherchées. Le raccordement payant au réseau des systèmes de
mini-condominium ou systèmes semi-collectifs a été donné en exemple. De même,
les sociétés immobilières créant des lotissements doivent prendre en charge
l’installation des systèmes d’assainissement et le raccordement au réseau
s’il est prévu ou envisagé à plus long terme, voire son développement ou
son prolongement. Elles doivent prévoir les conditions nécessaires pour une
maintenance pérenne de ces systèmes ou, si le transfert de la maintenance est
prévu vers la collectivité locale, les responsabilités et obligations des
deux parties doivent être clairement établies dans les modalités de ce
transfert. Ces obligations pourraient être négociées et inscrites dans le
permis de construire et la commune se doit de vérifier qu’elles ont été
remplies. Si ces sociétés immobilières gèrent des ensembles locatifs, un prélèvement
sur les loyers (dans le cadre des charges) permettrait de contribuer au
fonctionnement de l’ensemble du secteur.
Des
mécanismes financiers sont à inventer pour construire progressivement un
service permanent, durable, couvrant les besoins de l’ensemble de la
population, en sachant que, comme partout, des subventions seront encore
longtemps nécessaires.
6.4.
La mobilisation sociale et la participation des usagers
Les
changements dans les approches et les pratiques de gestion du secteur intervenus
avec l’émergence de nouveaux acteurs semblent désigner le citoyen
consommateur, usager, payeur et … contribuable comme élément- clé de tous
les dispositifs organisationnels et financiers (TechDev-D09).
Cet
acteur a besoin d’être informé, sensibilisé et motivé pour répondre aux
nombreuses sollicitations dont il est l’objet. Aussi les collectivités
locales sont-elles amenées à initier ou à s’associer à des programmes
d’information et communication qui visent à susciter l’adhésion des
habitants aux schémas organisationnels. Les communes mettent en œuvre des
programmes d’éducation et de marketing social visant le changement des
comportements et des pratiques d’hygiène et de salubrité indispensable à la
réussite des programmes d’élimination des déchets. L’efficacité de ces
programmes d’IEC (Information – Education - Communication) est contestée.
La réussite n’est pas toujours au rendez-vous, surtout quand on néglige de
prendre en compte les connaissances et surtout les pratiques des habitants et
quand on ne tient pas compte de leurs priorités (Ceda-D03).
La
légitimité des instances municipales passe, au-delà de l’élection, par la
capacité à assurer des services à la communauté des citadins. Le nettoiement
est souvent une attente. Cette légitimité est-elle systématiquement renforcée,
comme le veut la bonne gouvernance, par la capacité de contrôle par le citoyen
de l’action municipale ? (comité de quartier, Tenmiya-D07 ; comité de
surveillance de rue, Eamau-D10 ; etc.)
Il
est intéressant de constater qu’à travers les expériences relatées apparaît
une certaine reconnaissance du droit de contrôle par les usagers du service qui
leur est rendu et qu’ils rémunèrent directement. Par là même apparaît le
droit d’exercer un contrôle de l’action municipale à travers les systèmes
et les services qu’elle met en place et gère directement ou indirectement.
Comités
de quartiers à Nouakchott, Amicales à Fès, structures relais à Yaoundé,
comité de surveillance de rue à Lomé, ces organisations d’habitants
exercent un pouvoir de veille sur l’effectivité du service par les opérateurs
et également une sorte de pouvoir de dissuasion sur les comportements déviants
des habitants concernant la salubrité. Elles jouent un rôle d’arbitre et de
contrôle qui ne saurait être confondu avec une participation au dispositif de
recouvrement des coûts (Tenmiya-D07) faute de les dévoyer de leur mission.
On
doit toutefois s’interroger sur la « génération spontanée » de certaines
de ces organisations. Combien d’entre elles sont suscitées par des
intervenants de toutes sortes : coopérations extérieures, ONG, acteurs locaux
en recherche de pouvoir, lobbies divers ? Dans certains cas, ne peut-on parler
d’instrumentalisation au profit d’intérêts particuliers ? Le rôle, confié
à d’autres ou qu‘elles s’arrogent, ne prend-t-il pas quelquefois la désagréable
couleur du contrôle tatillon de la population, voire de la délation et même
de la violence auto-administrée ?
La
présence des associations dans les instances de décision, de suivi et d’évaluation
des programmes paraît toutefois nécessaire. Elle permet de mieux diffuser les
innovations et d’éviter ou d’atténuer d’éventuels conflits qui
pourraient naître de l’application de nouvelles mesures (Era-D05). Leur présence
dans ces instances suffit- elle cependant à créer de la solidarité ?
Quid
des quartiers les plus pauvres ? Quelles autres solutions pour ceux qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas payer ? Payer est-il le seul geste citoyen ?
N’est-ce pas antinomique avec l’antienne sur la participation et
l’implication des citadins dans la vie de leur cité et tout particulièrement
à travers l’image qu’ils souhaitent en donner ?
La
question du service public minimum est posée. Certains proposent comme une
avancée que l’évacuation des déchets soit assurée sur tout l’espace
urbain. Cette proposition montre à quel point le service est encore très inégalitaire.
Qui, de la commune ou des ONG, doit porter l’utopie de la réduction des inégalités
dont on voit bien que favoriser l’accès de tous aux services est un des
vecteurs ? Quelle alliance peut être envisagée aujourd’hui?
Nous
croyons avoir montré combien l’évolution actuelle est le fruit d’une
histoire non maîtrisée ; histoire qui se manifeste aujourd’hui par des
configurations complexes et toutes diverses. La recherche d’une intelligence
de ces configurations nous a conduit, à partir des travaux du programme, à
dessiner comme avenir pour la « commune » les quatre rôles analysés plus
haut :
1.
l’élaboration et la mise en œuvre d’un ou de plans stratégiques de
gestion des déchets solides et liquides ;
2.
en amont, la promotion de systèmes d’assainissement individuels améliorés
et si possible évolutifs, l’organisation et la coordination de la pré-collecte
des déchets ;
3.
la prise en charge directe ou indirecte (organisation et coordination) des séquences
intermédiaire et aval (regroupement, transport, traitement, élimination) ;
4.
la mobilisation sociale et la participation des usagers.
Cet
avenir dessiné, qui n’est après tout que le prolongement d’un constat,
est-il totalement satisfaisant ? Certainement pas, s’il cantonne la commune
dans un rôle de gestionnaire de l’urgence. Ce nouveau paradigme ne peut être
qu’un moment de cette histoire. Il a vocation à évoluer.
Comment
peut-il s’inscrire dans le long terme ou même dans le moyen terme ? Ce
Programme avait l’ambition de s’inscrire dans le développement durable. Si
l’ambition est plus que de porter un chapeau à la mode, comment ce nouveau
paradigme peut-il contribuer à ce « développement durable » ? Ne doit-on pas
remarquer combien la régénération des déchets a pris peu de place dans les
travaux ? Ne reste-t-on pas marqué par l’obsession de l’évacuation ?
L’absence totale de l’approche sanitaire n’est-elle pas, ici, révélatrice
?
Décréter
que la commune aura la responsabilité finale de cette ambition : « le développement
durable », la chose la plus difficile à réaliser, est-ce une phraséologie
obligatoire en direction des mandements de l’extérieur ou une nouvelle utopie
mobilisatrice ?
S’il
s’agit de l’utopie de demain, elle ne peut l’être qu’en mobilisant
l’ensemble du pays, de sa population, de ses responsables politiques, de ses
organisations et de ses structures étatiques à tous les niveaux. Ce pourrait
être un objectif scellant une nouvelle alliance entre l’Etat, ses représentants
et ses populations. Cela paraît bien prématuré en Afrique comme ailleurs. Le
développement durable n’apparaît-il pas aujourd’hui plus comme une
nouvelle contrainte que comme une grande ambition ?
La
fonction première de la commune n’est-elle pas d’abord de créer de la
citoyenneté, voire de l’urbanité ?
La
légitimité de la municipalité est, certes, de créer les conditions du mieux
vivre – et on voit bien comment un bon fonctionnement du secteur peut y
contribuer. Mais son rôle est aussi, et peut-être d’abord, de créer du «
vivre ensemble » : faire émerger une communauté de citoyens partageant avec
ses élus les mêmes objectifs pour leur cadre de vie et les mêmes ambitions
pour leur ville. C’est ainsi que les communes retrouveront une légitimité et
un capacité d’agir et de peser, un peu écornées ces dernières années.
Études
citées dans cette synthèse
Hydroconseil-A01.
Les entreprises de vidange mécanique des systèmes d’assainissement autonome
dans les grandes villes africaines (Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Bénin,
Tanzanie, Ouganda)
Shadyc-A04.
Une anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques
sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine (Burkina Faso)
Moshi-A05b
(Université de Dar es Salam / Université de Pau et des pays de l’Adour).
L’amélioration des services d’assainissement de la ville de Moshi. Analyse
de la demande et régulation du secteur (Tanzanie)
Gret-A07.
Planification concertée pour la gestion des excreta (Mauritanie, Éthiopie)
ENSP-A08.
Gestion et valorisation des eaux usées dans les zones d’habitat planifié et
leurs périphéries (Cameroun, Tchad)
Iwmi-A09.
Co-compostage des boues de vidange et des déchets
organiques pour l’agriculture urbaine et périurbaine : un projet pilote à
Kumasi (Ghana)
N’Djaména-D01.
Tri sélectif et valorisation des déchets urbains de la Ville de N’Djaména
(Tchad)
Cittal-D02.
Réflexion concertée pour une gestion intégrée de la propreté entre
population, puissance publique et opérateur privé : le cas de Fès (Maroc)
Ceda-D03.
Recherche d’espaces pour le dialogue, la prise de conscience et
l’organisation en vue de l’action dans la commune urbaine (Bénin)
Era-D05.
Mise en place de structures de pré collecte et de traitement des déchets
solides urbains dans une capitale tropicale, Yaoundé (Cameroun)
Tenmiya-D07.
Projet d’appui aux petits opérateurs «transporteurs des déchets solides»
du quartier de BASRA à Nouakchott (Mauritanie)
IRD-D08.
Gestion des déchets et aide à la décision municipale : Municipalité de Mopti
et Circonscription Urbaine de Porto Novo (Mali, Bénin)
TechDev-D09.
Maîtrise de l’amont de la filière déchets solides dans la ville de Cotonou
: pré-collecte et valorisation (Bénin)
Eamau-D10.
Opportunités et contraintes de la gestion des déchets à Lomé : les dépotoirs
intermédiaires (Togo)
Etude-AfD.
« Revue comparative des modes de gestion des
déchets urbains adoptés dans différents pays de la ZSP », réalisée pour
l’AfD
[1] Le terme « municipalité » recouvre ici l’ensemble des personnes qui administrent une commune.
[2] Pour notre part, nous utiliserons le terme de « secteur » en référence à l’ensemble « assainissement et déchets », ce secteur pouvant être analysé dans ses différentes séquences. Le terme « filière » sera utilisé chaque fois que nous traiterons d’une des deux filières techniques « assainissement : excréta et eaux usées » et « déchets solides », filières qui peuvent être analysées dans leurs différents segments. A noter que le glissement sémantique entre séquences puis segments et surtout maillons n’est pas innocent. On passe ainsi d’un service public dont les séquences ne sont que le découpage analytique d’un tout à des segments voire des maillons à confier à des opérateurs privés dans le cadre du marché.
[3] Un précédent programme de recherche et d’action avait porté sur « Eau potable et assainissement dans les quartiers périurbains et les petits centres » (1995-1998). D’emblée le Comité scientifique, pourtant conscient de l’importance de la question de l’assainissement, avait choisi de ne pas se disperser et de concentrer l’essentiel des travaux sur l’eau potable. A l’issue de ce programme, les équipes impliquées ont insisté sur la nécessité de poursuivre cette démarche de recherche-action. Dans le même temps, une réflexion était en cours sur la gestion des déchets solides : aussi a-t-il été décidé avec le ministère des Affaires étrangères de lancer un programme associant ces deux thématiques.
[4] On recommande vivement de lire la note de Henri Coing : « Contrat et régulation » qui fait une analyse très fouillée de cette question, in « Analyse comparative des performances de divers systèmes de gestion déléguée des points d’eau collectif » (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Namibie, Niger, Sénégal), J. Etienne, H. Coing, H. Conan, S. Jaglin, A. Morel à l’Huissier, M. Tamiatto, Programme « Eau potable et assainissement dans les quartiers périurbains et les petits centres », Avril 98 (www.pseau.org/epa/epaqppc/rapports/rapports/AR2RapFi.pdf).
[5] « Collectifs » non soumis en tant que tels aux prélèvements fiscaux.